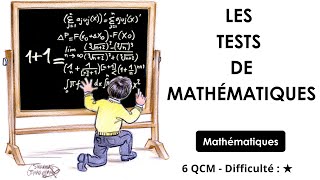Vendée, guerre de
Publié le 13/02/2013

Extrait du document
| 1 | PRÉSENTATION |
Vendée, guerre de, soulèvement contre-révolutionnaire opposé au gouvernement de la Ire République qui a agité, entre 1793 et 1796, la Vendée, le Maine-et-Loire et une partie de l'Anjou et du Poitou.
| 2 | AUX ORIGINES DU SOULÈVEMENT : VENDÉE BLANCHE CONTRE VENDÉE BLEUE |
Particulièrement attachée à la foi catholique depuis la prédication de Louis Grignon de Montfort (début du XVIIIe siècle), la paysannerie vendéenne n’adhère pas aux idéaux révolutionnaires et se sent plutôt proche du bas clergé et de la noblesse, désormais considérés comme des ennemis de la République. De surcroît, en entamant la rupture entre l'Église et les instances révolutionnaires, la Constitution civile du clergé promulguée en juillet 1790 a engendré l'émergence d'un important clergé réfractaire en Vendée. Aussi, le vote par la Convention nationale d'une levée en masse de 300 000 hommes pour combattre les ennemis de la Révolution française, le 24 février 1793, provoque-t-il un soulèvement populaire.
| 3 | L’INSURRECTION VENDÉENNE |
Le 10 mars 1793, des révoltes éclatent dans la région de Cholet. Les insurgés prennent Machecoul (11 mars), Tiffauges (12 mars) et Chemillé (13 mars). Le 14 mars, le sacristain Jacques Cathelineau s’empare de Cholet avant d’être rejoint par le garde-chasse Jean Stofflet (le jour même), puis par l’ancien officier de marine François de Charette de La Contrie (le 15). À cette date, Challans, Montaigu et La Roche-sur-Yon sont tombées également aux mains des Vendéens. Le 25 mai, l’armée contre-révolutionnaire occupe Fontenay-le-Comte (reprise en juillet par les républicains). Maîtres de la région comprise entre Nantes, Niort, les Sables-d’Olonne et Parthenay, l’armée des « blancs « cherche à s’emparer de Saumur.
Le 12 juin 1793, les troupes vendéennes commandées par Cathelineau prennent le nom d'« armée catholique et royale «. Celle-ci s'empare de Bressuire, de Thouars et de Saumur. En revanche, l’attaque de Nantes (ou Cathelineau trouve la mort) est un échec.
Le gouvernement révolutionnaire semble sérieusement menacé par cette insurrection, d'autant que d'autres soulèvements se produisent simultanément en Normandie, à Lyon et à Marseille et que l'armée républicaine vient de subir un revers retentissant à Neerwinden (18 mars). Le 1er août 1793, le Comité de salut public décide de regrouper ses troupes dans une « Armée de l'Ouest «, bientôt commandée par les généraux Léchelle et Kléber. Le 17 octobre 1793, après plusieurs défaites, les « bleus « écrasent pour la première fois 40 000 insurgés à Cholet.
Commence alors pour les blancs l’épisode de la « Virée de Galerne « qui mène les troupes vendéennes au nord de la Loire, vers Granville, où elles espèrent obtenir un soutien anglais. Les 4 et 5 décembre 1793, les Vendéens échouent devant Angers, puis sont défaits le 13, au Mans. À Savenay, le 23, l'armée vendéenne qui tente de refranchir la Loire est anéantie : 15 000 hommes sur 18 000 sont tués et les prisonniers sont exécutés.
| 4 | LA GUÉRILLA DES « BLANCS « |
Néanmoins, l’insurrection n’est pas pour autant matée. Alors que la Vendée reste parcourue par la Colonne infernale du républicain Turreau de Garambouville — politique de terre brûlée et exécution de près de 160 000 civils —, les chefs vendéens Charette, Sapinaud et Stofflet mènent des actions de guérilla. Afin de limiter les tensions, la Convention thermidorienne vote une amnistie en décembre 1794 et, le 17 février 1795, les généraux Charette et Canclaux signent à La Jaunais une paix accordant aux Vendéens la liberté de culte et l'exemption de la conscription.
Pourtant, Charette ne cesse pas ses actions de guérilla. Le 27 juin 1795, une armée d'émigrés appuyée par la flotte anglaise débarque à Quiberon et enflamme la Bretagne (voir Chouannerie) ; ce « débarquement de Quiberon « réveille le mouvement vendéen, sur l'initiative de Charette et de Stofflet. Mais la capture et l'exécution de Stofflet (25 février 1796) puis de Charette (25 mars 1796) mettent un terme à toute résistance vendéenne organisée. Une dernière flambée, en 1799-1800, est finalement contenue par Napoléon Bonaparte grâce à une politique conciliatrice.
| 5 | CONSÉQUENCES DE LA GUERRE DE VENDÉE |
La Vendée, dépeuplée et ruinée, a mis près d'un siècle à se rétablir. La guerre, marquée par une très grande cruauté de part et d’autre, a eu un coût humain considérable ; pour exemple, à Nantes en octobre 1793, le républicain Jean-Baptiste Carrier a exécuté 4 800 suspects par noyade dans la Loire. Certains historiens ont été jusqu'à parler d'un génocide. En fait, si la volonté d'extermination apparaît dans la rhétorique enflammée de certains conventionnels, elle n’a jamais été ordonnée.
Dissidente, religieuse, antirépublicaine, la mémoire vendéenne a été entretenue tout au long du XIXe siècle et d’importantes insurrections ont eu lieu au point de parler de deuxième et troisième guerres de Vendée (respectivement en 1814-1815 et 1831-1834).
Liens utiles
- CADOUDAL, Georges (1er janvier 1771-25 juin 1804) Conspirateur Il est l'un des chefs des Chouans, lors de la guerre de Vendée.
- La guerre de Vendée Le maquis de la Révolution.
- LA GUERRE DE VENDÉE (1793-1801) - HISTOIRE.
- La guerre de Vendée
- La guerre de Vendée (1793-1801)