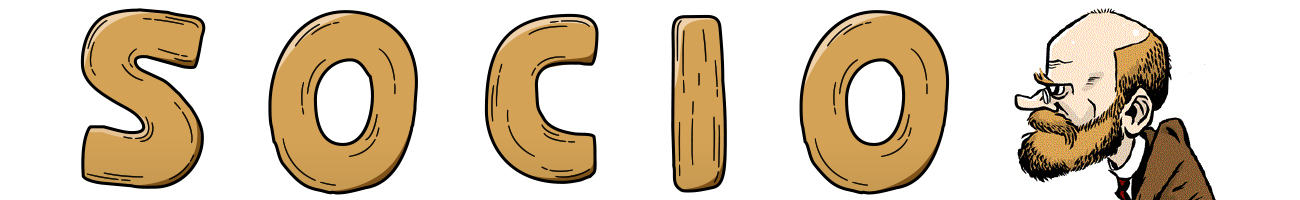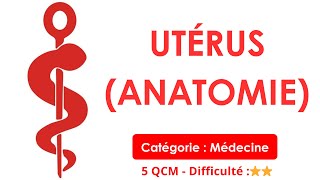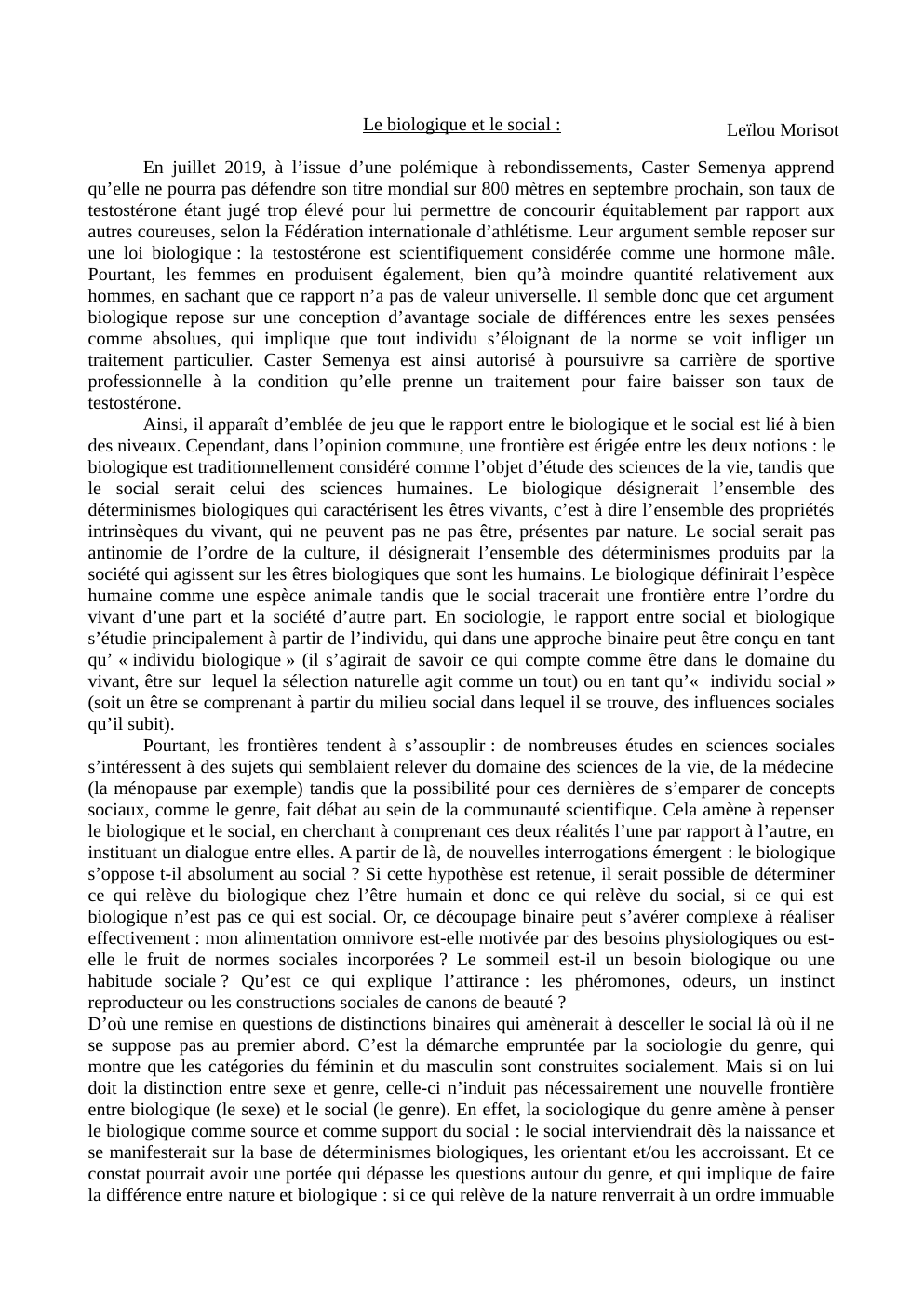DM de sociologie : Le biologique et le social
Publié le 03/11/2025
Extrait du document
«
Le biologique et le social :
En juillet 2019, à l’issue d’une polémique à rebondissements, Caster Semenya apprend
qu’elle ne pourra pas défendre son titre mondial sur 800 mètres en septembre prochain, son taux de
testostérone étant jugé trop élevé pour lui permettre de concourir équitablement par rapport aux
autres coureuses, selon la Fédération internationale d’athlétisme.
Leur argument semble reposer sur
une loi biologique : la testostérone est scientifiquement considérée comme une hormone mâle.
Pourtant, les femmes en produisent également, bien qu’à moindre quantité relativement aux
hommes, en sachant que ce rapport n’a pas de valeur universelle.
Il semble donc que cet argument
biologique repose sur une conception d’avantage sociale de différences entre les sexes pensées
comme absolues, qui implique que tout individu s’éloignant de la norme se voit infliger un
traitement particulier.
Caster Semenya est ainsi autorisé à poursuivre sa carrière de sportive
professionnelle à la condition qu’elle prenne un traitement pour faire baisser son taux de
testostérone.
Ainsi, il apparaît d’emblée de jeu que le rapport entre le biologique et le social est lié à bien
des niveaux.
Cependant, dans l’opinion commune, une frontière est érigée entre les deux notions : le
biologique est traditionnellement considéré comme l’objet d’étude des sciences de la vie, tandis que
le social serait celui des sciences humaines.
Le biologique désignerait l’ensemble des
déterminismes biologiques qui caractérisent les êtres vivants, c’est à dire l’ensemble des propriétés
intrinsèques du vivant, qui ne peuvent pas ne pas être, présentes par nature.
Le social serait pas
antinomie de l’ordre de la culture, il désignerait l’ensemble des déterminismes produits par la
société qui agissent sur les êtres biologiques que sont les humains.
Le biologique définirait l’espèce
humaine comme une espèce animale tandis que le social tracerait une frontière entre l’ordre du
vivant d’une part et la société d’autre part.
En sociologie, le rapport entre social et biologique
s’étudie principalement à partir de l’individu, qui dans une approche binaire peut être conçu en tant
qu’ « individu biologique » (il s’agirait de savoir ce qui compte comme être dans le domaine du
vivant, être sur lequel la sélection naturelle agit comme un tout) ou en tant qu’« individu social »
(soit un être se comprenant à partir du milieu social dans lequel il se trouve, des influences sociales
qu’il subit).
Pourtant, les frontières tendent à s’assouplir : de nombreuses études en sciences sociales
s’intéressent à des sujets qui semblaient relever du domaine des sciences de la vie, de la médecine
(la ménopause par exemple) tandis que la possibilité pour ces dernières de s’emparer de concepts
sociaux, comme le genre, fait débat au sein de la communauté scientifique.
Cela amène à repenser
le biologique et le social, en cherchant à comprenant ces deux réalités l’une par rapport à l’autre, en
instituant un dialogue entre elles.
A partir de là, de nouvelles interrogations émergent : le biologique
s’oppose t-il absolument au social ? Si cette hypothèse est retenue, il serait possible de déterminer
ce qui relève du biologique chez l’être humain et donc ce qui relève du social, si ce qui est
biologique n’est pas ce qui est social.
Or, ce découpage binaire peut s’avérer complexe à réaliser
effectivement : mon alimentation omnivore est-elle motivée par des besoins physiologiques ou estelle le fruit de normes sociales incorporées ? Le sommeil est-il un besoin biologique ou une
habitude sociale ? Qu’est ce qui explique l’attirance : les phéromones, odeurs, un instinct
reproducteur ou les constructions sociales de canons de beauté ?
D’où une remise en questions de distinctions binaires qui amènerait à desceller le social là où il ne
se suppose pas au premier abord.
C’est la démarche empruntée par la sociologie du genre, qui
montre que les catégories du féminin et du masculin sont construites socialement.
Mais si on lui
doit la distinction entre sexe et genre, celle-ci n’induit pas nécessairement une nouvelle frontière
entre biologique (le sexe) et le social (le genre).
En effet, la sociologique du genre amène à penser
le biologique comme source et comme support du social : le social interviendrait dès la naissance et
se manifesterait sur la base de déterminismes biologiques, les orientant et/ou les accroissant.
Et ce
constat pourrait avoir une portée qui dépasse les questions autour du genre, et qui implique de faire
la différence entre nature et biologique : si ce qui relève de la nature renverrait à un ordre immuable
qui s’impose de lui même, ce qui relève du biologique relèverait d’une dimension malléable,
ouverte à des potentialités travaillées par le social.
Ainsi, comment repenser les rapports entre social et biologique en croisant les approches des
sciences de la vie et sciences humaines, afin d’éclairer les phénomènes à l’origine de l’être et du
devenir des individus ? Nous réfléchirons dans un premier temps à la manière dont la sociologie
remet en cause la toute puissance du biologique.
Nous analyserons ensuite la façon dont le
biologique peut constituer la matière du social, avant de montrer pourquoi le social et le biologique
peuvent être pensés comme deux réalités intrinsèquement liées.
I) Dévoiler le social derrière le biologique :
A) Une dénaturalisation du social
Idée : Des différences perçues comme naturelles sont construites socialement.
Exemple : Héléna G.
Belotti, Du côté des petites filles (1974) : réprobation plus forte de la part des parents envers
leurs filles relativement à leurs garçons quand celles-ci manifestent des comportements considérés comme masculins
(cris, colère, agitation).
Il y a performation du genre, ce qui met en valeur une naturalisation de caractéristiques
genrées.
Exemple : Sylvie Ayral : la fabrique des garçons : sanction et genre au collège : elle montre comment les garçons
sont maintenus dans une identité masculine stéréotypée (à travers la sanction scolaire notamment)
B) Le relativisme culturel pour résoudre l’amalgame entre biologique et social :
Idée : En étudiant chaque culture dans sa spécificité, dans une approche comparatiste, nous pouvons mettre en avant
que ce qui pouvait être pensé comme universel relève d’une construction sociale dans la société en question.
Cf
travaux de Ruth Benedict, Patterns of culture et Margaret Mead, Moeur et sexualité en occident.
Exemple : Cécile Charlap : la fabrique de la ménopause (2019) : ménopause construite socialement, le terme
n’existe pas dans la langue maya, elle ne fait pas exister ce phénomène que les pays occidentaux associent
aujourd’hui de manière péjorative au vieillissement des femmes.
C) Nuancer le déterminisme biologique :
Idée : Il s’agit ici de traiter du devenir des individus : sommes-nous déterminés par les caractéristiques biologiques
avec lesquelles nous naissons ou sommes-nous déterminés par le social ? Sélection naturelle ou sélection sociale ?
Exemple : En 2005, une expertise collective publiée sous l’égide de L’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) présente la déviance comme le résultat d’une maladie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Du biologique au social de C. HAGÈGE
- La sociologie dépend-elle du contexte social qu'elle étudie ?
- lien social - sociologie.
- darwinisme social - sociologie.
- contrôle social - sociologie.