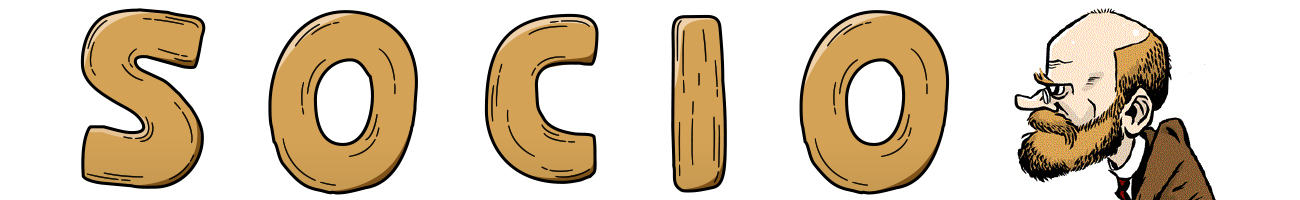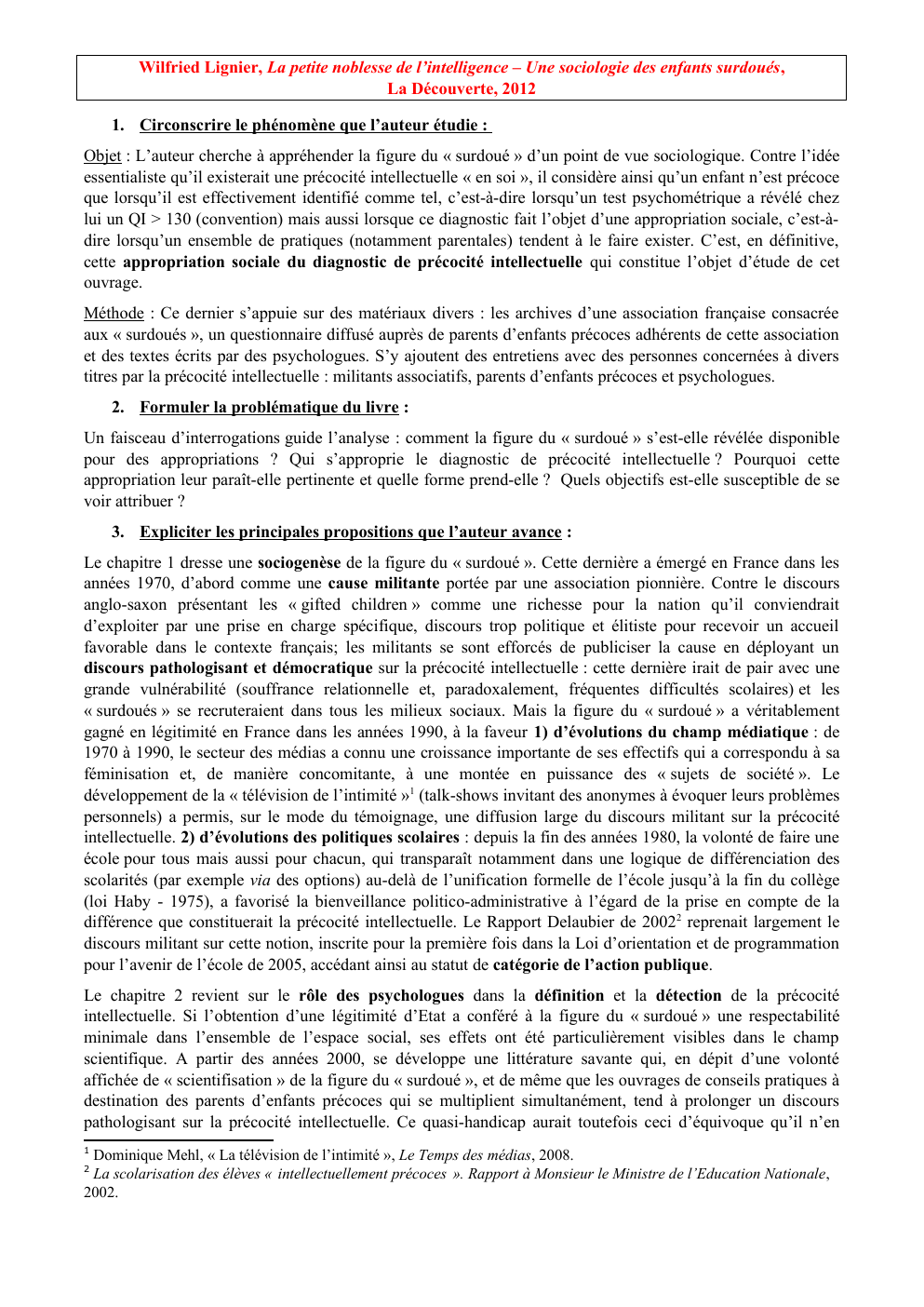W. Lignier, La petite noblesse de l'intelligence - fiche de lecture
Publié le 21/04/2025
Extrait du document
«
Wilfried Lignier, La petite noblesse de l’intelligence – Une sociologie des enfants surdoués,
La Découverte, 2012
1.
Circonscrire le phénomène que l’auteur étudie :
Objet : L’auteur cherche à appréhender la figure du « surdoué » d’un point de vue sociologique.
Contre l’idée
essentialiste qu’il existerait une précocité intellectuelle « en soi », il considère ainsi qu’un enfant n’est précoce
que lorsqu’il est effectivement identifié comme tel, c’est-à-dire lorsqu’un test psychométrique a révélé chez
lui un QI > 130 (convention) mais aussi lorsque ce diagnostic fait l’objet d’une appropriation sociale, c’est-àdire lorsqu’un ensemble de pratiques (notamment parentales) tendent à le faire exister.
C’est, en définitive,
cette appropriation sociale du diagnostic de précocité intellectuelle qui constitue l’objet d’étude de cet
ouvrage.
Méthode : Ce dernier s’appuie sur des matériaux divers : les archives d’une association française consacrée
aux « surdoués », un questionnaire diffusé auprès de parents d’enfants précoces adhérents de cette association
et des textes écrits par des psychologues.
S’y ajoutent des entretiens avec des personnes concernées à divers
titres par la précocité intellectuelle : militants associatifs, parents d’enfants précoces et psychologues.
2.
Formuler la problématique du livre :
Un faisceau d’interrogations guide l’analyse : comment la figure du « surdoué » s’est-elle révélée disponible
pour des appropriations ? Qui s’approprie le diagnostic de précocité intellectuelle ? Pourquoi cette
appropriation leur paraît-elle pertinente et quelle forme prend-elle ? Quels objectifs est-elle susceptible de se
voir attribuer ?
3.
Expliciter les principales propositions que l’auteur avance :
Le chapitre 1 dresse une sociogenèse de la figure du « surdoué ».
Cette dernière a émergé en France dans les
années 1970, d’abord comme une cause militante portée par une association pionnière.
Contre le discours
anglo-saxon présentant les « gifted children » comme une richesse pour la nation qu’il conviendrait
d’exploiter par une prise en charge spécifique, discours trop politique et élitiste pour recevoir un accueil
favorable dans le contexte français; les militants se sont efforcés de publiciser la cause en déployant un
discours pathologisant et démocratique sur la précocité intellectuelle : cette dernière irait de pair avec une
grande vulnérabilité (souffrance relationnelle et, paradoxalement, fréquentes difficultés scolaires) et les
« surdoués » se recruteraient dans tous les milieux sociaux.
Mais la figure du « surdoué » a véritablement
gagné en légitimité en France dans les années 1990, à la faveur 1) d’évolutions du champ médiatique : de
1970 à 1990, le secteur des médias a connu une croissance importante de ses effectifs qui a correspondu à sa
féminisation et, de manière concomitante, à une montée en puissance des « sujets de société ».
Le
développement de la « télévision de l’intimité »1 (talk-shows invitant des anonymes à évoquer leurs problèmes
personnels) a permis, sur le mode du témoignage, une diffusion large du discours militant sur la précocité
intellectuelle.
2) d’évolutions des politiques scolaires : depuis la fin des années 1980, la volonté de faire une
école pour tous mais aussi pour chacun, qui transparaît notamment dans une logique de différenciation des
scolarités (par exemple via des options) au-delà de l’unification formelle de l’école jusqu’à la fin du collège
(loi Haby - 1975), a favorisé la bienveillance politico-administrative à l’égard de la prise en compte de la
différence que constituerait la précocité intellectuelle.
Le Rapport Delaubier de 20022 reprenait largement le
discours militant sur cette notion, inscrite pour la première fois dans la Loi d’orientation et de programmation
pour l’avenir de l’école de 2005, accédant ainsi au statut de catégorie de l’action publique.
Le chapitre 2 revient sur le rôle des psychologues dans la définition et la détection de la précocité
intellectuelle.
Si l’obtention d’une légitimité d’Etat a conféré à la figure du « surdoué » une respectabilité
minimale dans l’ensemble de l’espace social, ses effets ont été particulièrement visibles dans le champ
scientifique.
A partir des années 2000, se développe une littérature savante qui, en dépit d’une volonté
affichée de « scientifisation » de la figure du « surdoué », et de même que les ouvrages de conseils pratiques à
destination des parents d’enfants précoces qui se multiplient simultanément, tend à prolonger un discours
pathologisant sur la précocité intellectuelle.
Ce quasi-handicap aurait toutefois ceci d’équivoque qu’il n’en
1
Dominique Mehl, « La télévision de l’intimité », Le Temps des médias, 2008.
La scolarisation des élèves « intellectuellement précoces ».
Rapport à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,
2002.
2
serait un qu’en lien avec un environnement (notamment scolaire) inadapté car trop ordinaire et ne
correspondrait pas à une constitution psychologique déficiente.
Quant aux pratiques de cabinet, l’auteur
souligne que les psychologues susceptibles d’établir un diagnostic de précocité intellectuelle sont
rares (manque de formation, technique peu valorisée dans la profession).
La « spécialisation » dans ce
diagnostic fonctionne alors comme une niche professionnelle dans un contexte concurrentiel et engage le
praticien dans un type particulier d’interaction clinique avec les patients concernés.
Les parents viennent en
effet chercher la confirmation d’une intuition de précocité de leur enfant et cette demande est intériorisée par
les psychologues qui tendent à être plutôt arrangeants dans l’établissement du diagnostic, cela leur permettant
d’entretenir un flux de patients spécifiques.
Dans le chapitre 3, l’auteur s’attache à décrire les propriétés sociales et scolaires des enfants précoces à
partir de son échantillon.
Il montre que si les « surdoués » se recrutent pour l’essentiel dans des milieux
sociaux favorisés économiquement et culturellement, certaines caractéristiques propres à certaines fractions
des classes dominantes renforcent la propension à s’approprier le diagnostic de précocité intellectuelle.
Ainsi
de la proximité avec l’univers médico-psychologique en lien avec un effet d’information, qui explique la
surreprésentation des professions libérales médicales et des professions intermédiaires de la santé (les seules
n’appartenant pas aux CSP+) parmi les parents d’enfants précoces.
Ainsi également de la proximité avec le
monde de l’entreprise en lien avec une disposition à appréhender les compétences intellectuelles dans des
termes autres que scolaires, qui explique quant à elle la surreprésentation importante des chefs d’entreprises et
a contrario la surreprésentation contenue des enseignants et des cadres du secteur public parmi cette même
population.
Quant à l’école, les « surdoués » ne sont, objectivement, que rarement en difficulté : ils
connaissent au contraire des taux d’avance scolaire élevés (65% dans l’échantillon de l’auteur contre moins de
2% dans une population d’enfants « classique »3) ; mais leur excellence est appréhendée en des termes non
scolaires.
Les filles étant justement décrites comme scolaires et se voyant attribuer une autonomie qui leur
permettrait de masquer les « symptômes » de la précocité intellectuelle, on comprend dès lors pourquoi elles
suscitent moins de démarches de détection et sont ainsi fortement sous-représentées parmi les enfants
précoces.
Dans le chapitre 4, l’auteur montre comment la précocité d’un enfant prend consistance (c’est-à-dire acquiert
une réalité et trouve un sens) aux yeux des parents.
Il avance que le recours à l’évaluation psychométrique
constitue pour ces derniers un moyen de réduire l’incertitude qu’ils éprouvent vis-à-vis de l’école.
Cette
incertitude renvoie, en particulier pour ceux ayant fait les frais de la massification scolaire et de la dévaluation
subséquente des diplômes obtenus, qui ne leur ont pas permis d’accéder à la position socioprofessionnelle
espérée, à une méfiance à l’égard de la valeur de la certification scolaire de l’intelligence et une volonté de
s’en distancer.
Plus fréquemment, elle correspond à....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PROSE DU TRANSSIBÉRIEN ET DE LA PETITE JEHANNE DE FRANCE (La) de Blaise Cendrars : Fiche de lecture
- PETITE FADETTE (La) : George Sand : Fiche de lecture
- Petite Fadette, la [George Sand] - Fiche de lecture.
- Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, la [Blaise Cendrars] - Fiche de lecture.
- Petite Sirène, la [Hans Christian Andersen] - fiche de lecture.