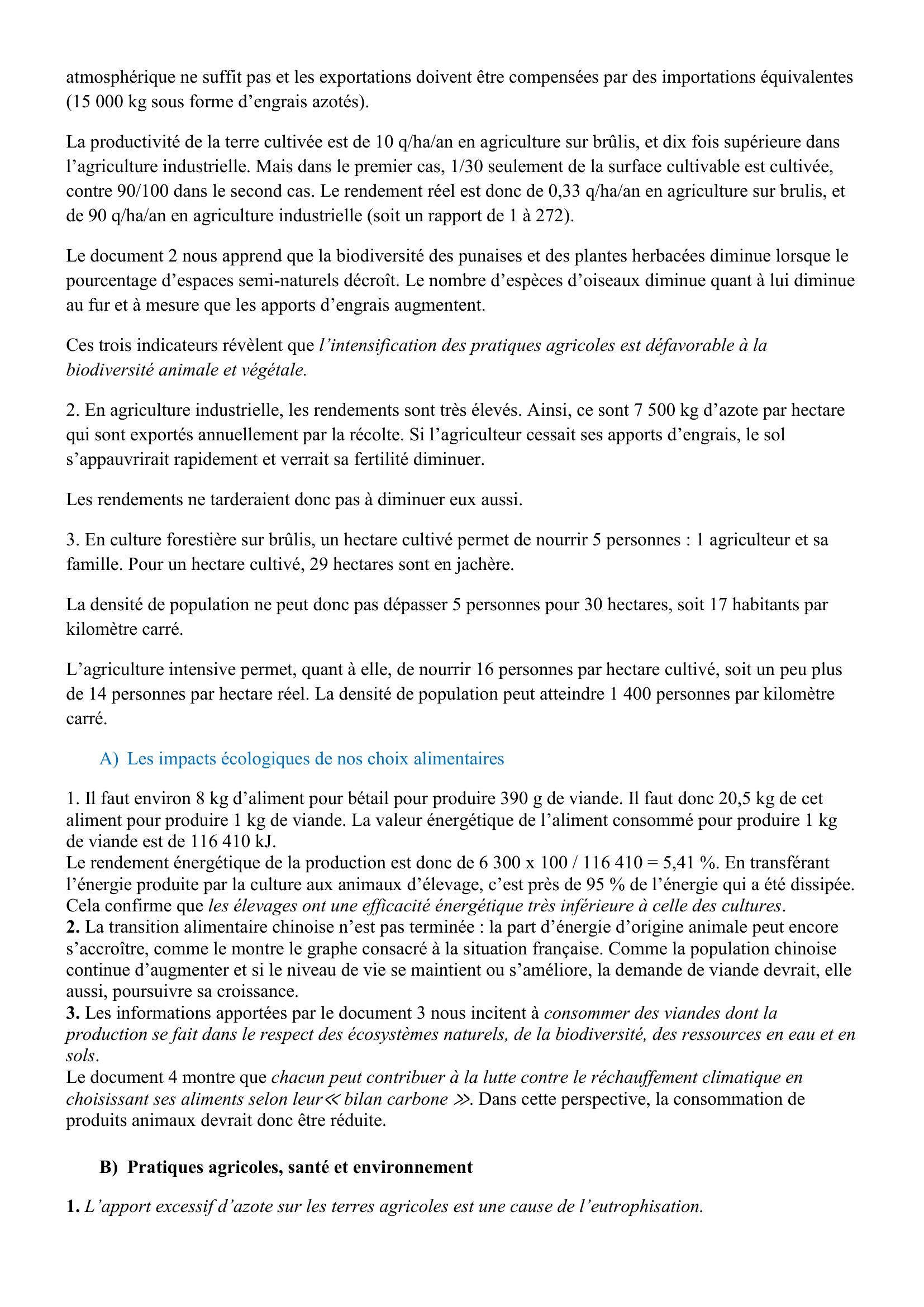Nourrir l'humanité 1e ES
Publié le 28/01/2013

Extrait du document
«
atmosphérique ne suffit pas et les exportations doivent être compensées par des importations équivalentes
(15 0 00 kg sous forme d’engrais azoté s).
La productivité de la terre cultivée est de 1 0 q/ha/an en agriculture sur brû lis, et dix fois supérieure dans
l’agriculture industrielle.
Mais dans le premier cas, 1/30 seulement de la surface cultivable est cultivée,
contre 90/100 dans le second cas.
Le rendement réel est donc de 0,33 q/ha/an en agriculture sur brulis, et
de 90 q/ha/an en agriculture indu strielle (soit un rapport de 1 à 272).
Le document 2 nous apprend que la biodiversité des punaises et des plantes herbacées diminue lorsque le
po urcentage d’espaces semi -naturels décroît.
Le nombre d’e spèces d’oiseaux diminue quant à lui diminue
au fur et à mesure que les apports d’engrais augmentent.
Ces trois indicateurs révèlent que l’intensification des pratiques agricoles est défavorable à la
biodiversité animale et végétale.
2.
En agriculture industrielle, les rendements sont très élevés.
Ainsi, ce sont 7 500 kg d’azote par hectare
qui sont exportés annuellement par la récolte.
Si l’agriculteur cessait ses apports d’engrais, le sol
s’appauvrirait rapidement et verrait sa fertilité diminuer.
Les rendements ne tarderaient donc pas à diminuer eux aussi.
3.
En culture forestière sur brû lis, un hectare cultivé permet de nourrir 5 personnes : 1 agriculteur et sa
famille .
Pour un hectare cultivé, 29 hectares sont en jachère.
La densité de population ne peut donc pas dépasser 5 personnes pour 30 hectares, soit 17 habitants par
kilomètre carré.
L’agriculture intensive permet, quant à elle, de nourrir 16 personnes par hectare cultivé, soit un peu plus
de 14 personnes par hectare réel.
La densité de population peut atteindre 1 400 personnes par kilomètre
carré.
A) Les impacts écologiques de nos choix alimentaires
1.
Il faut environ 8 kg d’aliment pour bétail pour produire 390 g de viande.
Il faut donc 20,5 kg de cet
aliment pour produire 1 kg de viande.
La valeur é nergétique de l’aliment consommé pour produire 1 kg
de viande est de 116 410 kJ.
Le rendement énergétique de la production est donc de 6 300 x 10 0 / 116 410 = 5,41 %.
En transfé rant
l’é nergie produit e par la culture aux animaux d’élevage, c’est prè s de 95 % de l’énergie qui a été dissipée.
Cela confirme que les é levages ont une efficacité énergé tique très infé rieure à celle des cultures .
2.
La transition alimen taire chinoise n’est pas terminée : la part d’é nergie d’origine animale peut encore
s’accroître, comme le montre le graphe consacré à la situation franç aise.
Comme la population chinoise
continue d’augmenter et si le niveau de vie se maintient ou s’amé liore, la demande de viande d evrait, elle
aussi, poursuivre sa croissance.
3.
Les informations apporté es p ar le document 3 nous incitent à consommer des viandes dont la
production se fait dans le respect des écosystèmes naturels, de la biodiversité, des ressources en eau et en
sols .
Le document 4 montre que chacun peut contribuer à la lutte contre le ré chauffement climatique en
choisissant ses aliments selon leur ≪ bilan carbone ≫ .
Dans cette perspective, la consommation de
produits animaux devrait donc être ré duite.
B) Pratiques agricol es, santé et environnement
1.
L’apport excessif d’azote sur les terres agricoles est une cause de l’eutrophisation..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nourrir l'Humanité
- Nourrir l'humanité 1ES
- Chine nourrir le quart de l'humanité ?
- En analysant les documents,en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, vous vous interrogerez sur ce qu’apportent les procès à la connaissance historique des crimes contre l’humanité commis par les nazis au cours de la Seconde Guerre Mondiale
- La violence de la guerre fait-elle perdre aux hommes leur humanité?