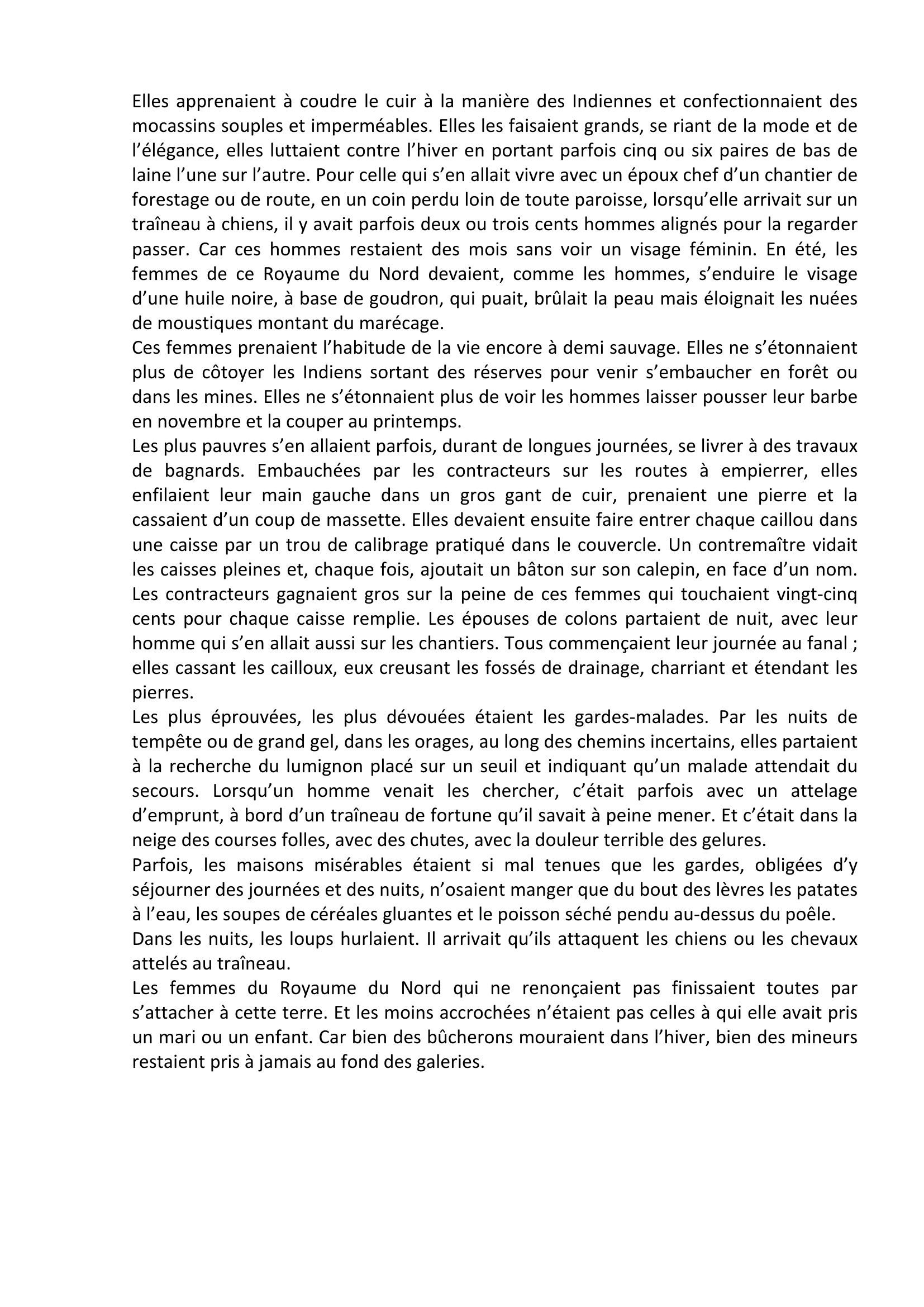38 Paysans venus d'autres contrées ou colons arrachés à leurs bureaux, leurs usines, leurs ateliers par la crise, ils n'avaient qu'un lien entre eux : la terre.
Publié le 15/12/2013

Extrait du document
«
Elles
apprenaient àcoudre lecuir àla manière desIndiennes etconfectionnaient des
mocassins souplesetimperméables.
Elleslesfaisaient grands,seriant delamode etde
l’élégance, ellesluttaient contrel’hiverenportant parfoiscinqousix paires debas de
laine l’une surl’autre.
Pourcellequis’en allait vivreavecunépoux chefd’un chantier de
forestage ouderoute, enun coin perdu loindetoute paroisse, lorsqu’elle arrivaitsurun
traîneau àchiens, ilyavait parfois deuxoutrois cents hommes alignéspourlaregarder
passer.
Carceshommes restaient desmois sansvoirunvisage féminin.
Enété, les
femmes deceRoyaume duNord devaient, commeleshommes, s’enduire levisage
d’une huilenoire, àbase degoudron, quipuait, brûlait lapeau maiséloignait lesnuées
de moustiques montantdumarécage.
Ces femmes prenaient l’habitude delavie encore àdemi sauvage.
Ellesnes’étonnaient
plus decôtoyer lesIndiens sortantdesréserves pourvenir s’embaucher enforêt ou
dans lesmines.
Ellesnes’étonnaient plusdevoir leshommes laisserpousser leurbarbe
en novembre etlacouper auprintemps.
Les plus pauvres s’enallaient parfois, durantdelongues journées, selivrer àdes travaux
de bagnards.
Embauchées parlescontracteurs surlesroutes àempierrer, elles
enfilaient leurmain gauche dansungros gant decuir, prenaient unepierre etla
cassaient d’uncoup demassette.
Ellesdevaient ensuitefaireentrer chaque cailloudans
une caisse paruntrou decalibrage pratiquédanslecouvercle.
Uncontremaître vidait
les caisses pleines et,chaque fois,ajoutait unbâton surson calepin, enface d’un nom.
Les contracteurs gagnaientgrossurlapeine deces femmes quitouchaient vingt-cinq
cents pourchaque caisseremplie.
Lesépouses decolons partaient denuit, avecleur
homme quis’en allait aussi surleschantiers.
Touscommençaient leurjournée aufanal ;
elles cassant lescailloux, euxcreusant lesfossés dedrainage, charriantetétendant les
pierres.
Les plus éprouvées, lesplus dévouées étaientlesgardes-malades.
Parlesnuits de
tempête oudegrand gel,dans lesorages, aulong deschemins incertains, ellespartaient
à la recherche dulumignon placésurunseuil etindiquant qu’unmalade attendait du
secours.
Lorsqu’un hommevenaitleschercher, c’étaitparfois avecunattelage
d’emprunt, àbord d’untraîneau defortune qu’ilsavait àpeine mener.
Etc’était dansla
neige descourses folles,avecdeschutes, avecladouleur terribledesgelures.
Parfois, lesmaisons misérables étaientsimal tenues quelesgardes, obligées d’y
séjourner desjournées etdes nuits, n’osaient mangerquedubout deslèvres lespatates
à l’eau, lessoupes decéréales gluantes etlepoisson séchépendu au-dessus dupoêle.
Dans lesnuits, lesloups hurlaient.
Ilarrivait qu’ilsattaquent leschiens oules chevaux
attelés autraîneau.
Les femmes duRoyaume duNord quinerenonçaient pasfinissaient toutespar
s’attacher àcette terre.
Etles moins accrochées n’étaientpascelles àqui elle avait pris
un mari ouunenfant.
Carbien desbûcherons mouraientdansl’hiver, biendesmineurs
restaient prisàjamais aufond desgaleries..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quels sont, dans la littérature française, les romanciers qui vous ont paru parler de la terre et des paysans avec le plus de sympathie et de vérité ?
- Les colons francs en Terre sainte
- Les colons francs en Terre sainte
- La recette de Hollywood pour sortir de la crise : des metteurs en scène venus d'Europe et des stars à leur mesure
- THÈME 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant Thème 1A : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique Chapitre 1 : Les divisions cellulaires, transmission du programme génétique chez les eucaryotes