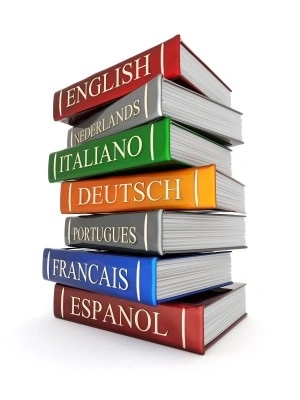Abbé Grégoire, sur l'unification de la langue (1790)
Le 13 août 1790, l’abbé Grégoire lance un questionnaire ayant pour objet d’étudier la diversité des patois et la nature des mœurs linguistiques de la France rurale. Il présente les résultats de cette enquête comme un indispensable matériau d’analyse préalable au lancement d’une stratégie éducative favorisant l’accès de tous au français. Il juge en effet que la maîtrise du français peut renforcer l’unité nationale (via l’unité linguistique) et favoriser l’accès à une raison citoyenne profitable à la Révolution — notamment par la transmission des textes politiques révolutionnaires et de la pensée héritée des Lumières.
Enquête sur l’unification de la langue française de l’abbé Grégoire
1. — L’usage de la langue française est-il universel dans votre contrée ? Y parle-t-on un ou plusieurs patois ? 2. — Ce patois a-t-il une origine ancienne et connue ? 3. — A-t-il beaucoup de termes radicaux, beaucoup de termes composés ? 4. — Y trouve-t-on des mots dérivés du celtique, du grec, du latin, et en général des langues anciennes et modernes ? 5. — A-t-il une affinité marquée avec le français, avec le dialecte des contrées voisines, avec celui de certains lieux éloignés, où des émigrants, des colons de votre contrée, sont allés anciennement s’établir ? 6. — En quoi s’éloigne-t-il le plus de l’idiome national ? N’est-ce pas spécialement pour les noms des plantes, des maladies, les termes des arts et métiers, des instruments aratoires, des diverses espèces de grains, du commerce et du droit coutumier ? On désirerait avoir cette nomenclature. 7. — Y trouve-t-on fréquemment plusieurs mots pour désigner la même chose ? 8. — Pour quels genres de choses, d’occupations, de passions, ce patois est-il plus abondant ? 9. — A-t-il beaucoup de mots pour exprimer les nuances des idées et les objets intellectuels ? 10. — A-t-il beaucoup de termes contraires à la pudeur ? Ce que l’on doit en inférer relativement à la pureté ou à la corruption des mœurs ? 11. — A-t-il beaucoup de jurements et d’expressions particulières aux grands mouvements de colère ? 12. — Trouve-t-on dans ce patois des termes, des locutions très énergiques, et même qui manquent à l’idiome français ? 13. — Les finales sont-elles plus communément voyelles que consonnes ? 14. — Quel est le caractère de la prononciation ? Est-elle gutturale, sifflante, douce, peu ou fortement accentuée ? 15. — L’écriture de ce patois a-t-elle des traits, des caractères autres que le français ? 16. — Ce patois varie-t-il beaucoup de village à village ? 17. — Le parle-t-on dans les villes ? 18. — Quelle est l’étendue territoriale où il est usité ? 19. — Les campagnards savent-ils également s’énoncer en français ? 20. — Prêchait-on jadis en patois ? Cet usage a-t-il cessé ? 21. — A-t-on des grammaires et des dictionnaires de ce dialecte ? 22. — Trouve-t-on des inscriptions patoises dans les églises, les cimetières, les places publiques, etc. ? 23. — Avez-vous des ouvrages en patois, imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, comme droit coutumier, actes publics, chroniques, prières, sermons, livres ascétiques, cantiques, chansons, almanachs, poésie, traductions, etc. ? […] 26. — Avez-vous beaucoup de proverbes patois particuliers à votre dialecte et à votre contrée ? 27. — Quelle est l’influence respective du patois sur les mœurs, et de celles-ci sur votre dialecte ? 28. — Remarque-t-on qu’il se rapproche insensiblement de l’idiome français, que certains mots disparaissent, et depuis quand ? […] 31. — Dans les écoles de campagne, l’enseignement se fait-il en français ? Les livres sont-ils uniformes ? 32. — Chaque village est-il pourvu de maîtres et de maîtresses d’école ? 33. — Outre l’art de lire, d’écrire, de chiffrer et le catéchisme, enseigne-t-on autre chose dans ces écoles ? 34. — Sont-elles assidûment surveillées par MM. les Curés et Vicaires ? 35. — Ont-ils un assortiment de livres pour prêter à leurs paroissiens ? 36. — Les gens de la campagne ont-ils le goût de la lecture ? 37. — Quelles espèces de livres trouve-t-on plus communément chez eux ? 38. — Ont-ils beaucoup de préjugés, et dans quel genre ? 39. — Depuis un vingtaine d’années, sont-ils plus éclairés ? Leurs mœurs sont-elles plus dépravées ? Leurs principes religieux ne sont-ils pas affaiblis ? 40. — Quelles sont les causes et quels seraient les remèdes à ces maux ? 41. — Quels effets moraux produit chez eux la révolution actuelle ? […]
Source : Certeau (Michel de), Julia (Dominique) & Revel (Jacques), Une politique de la langue : la Révolution française et les patois, l'enquête de Grégoire, Paris, Gallimard, 1975.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.