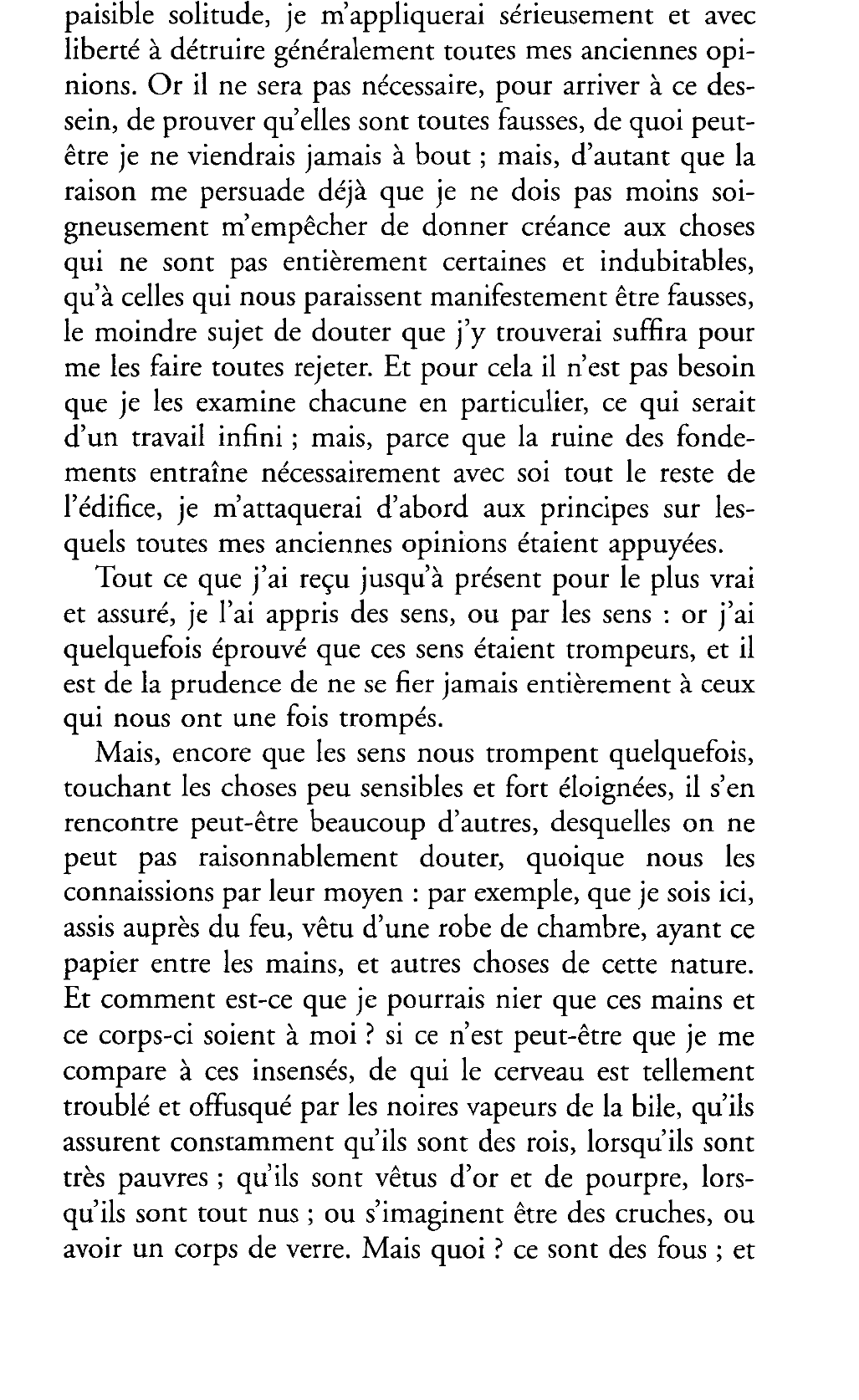Anthologie philosophique: DESCARTES
Publié le 25/03/2015

Extrait du document

EXTRAITS
1. Le doute radical
Descartes, Méditations métaphysiques,
« Première méditation : des choses que l'on peut
révoquer en doute «, GF-Flammarion, 1979,
p. 57-69.
Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés, ne pouvait être que fort douteux et incertain ; de façon qu'il me fallait entre¬prendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusques alors en ma créance, et commencer tout de nouveau dès les fon¬dements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Mais cette entreprise me semblant être fort grande, j'ai attendu que j'eusse atteint un âge qui fût si mûr, que je n'en pusse espérer d'autre après lui, auquel je fusse plus propre à l'exécuter ; ce qui m'a fait différer si longtemps, que désormais je croirais commettre une faute, si j'employais encore à délibérer le temps qui me reste pour agir.
Maintenant donc que mon esprit est libre de tous soins, et que je me suis procuré un repos assuré dans une
paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opi¬nions. Or il ne sera pas nécessaire, pour arriver à ce des¬sein, de prouver qu'elles sont toutes fausses, de quoi peut-être je ne viendrais jamais à bout ; mais, d'autant que la raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soi¬gneusement m'empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables, qu'à celles qui nous paraissent manifestement être fausses, le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela il n'est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait d'un travail infini ; mais, parce que la ruine des fonde¬ments entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur les¬quels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées.
Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens, ou par les sens : or j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés.
Mais, encore que les sens nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leur moyen : par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains, et autres choses de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ? si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois, lorsqu'ils sont très pauvres ; qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre, lors¬qu'ils sont tout nus ; ou s'imaginent être des cruches, ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? ce sont des fous ; et
je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs exemples.
Toutefois j'ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent que j'ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou quelque¬fois de moins vraisemblables, que ces insensés, lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans mon lit ? Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier ; que cette tête que je remue n'est point assoupie ; que c'est avec dessein et de propos délibéré que j'étends cette main, et que je la sens : ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Mais, en y pensant soigneusement, je me ressouviens d'avoir été souvent trompé, lorsque je dormais, par de semblables illusions. Et m'arrêtant sur cette pensée, je vois si manifestement qu'il n'y a point d'indices concluants, ni de marques assez certaines par où l'on puisse distinguer nettement la veille d'avec le sommeil, que j'en suis tout étonné ; et mon étonnement est tel, qu'il est presque capable de me per¬suader que je dors.
Supposons donc maintenant que nous sommes endor¬mis, et que toutes ces particularités-ci, à savoir, que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous étendons les mains, et choses semblables, ne sont que de fausses illusions ; et pensons que peut-être nos mains, ni tout notre corps, ne sont pas tels que nous les voyons. Toutefois il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans le sommeil sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être formées qu'à la ressemblance de quelque chose de réel et de véri¬table ; et qu'ainsi, pour le moins, ces choses générales, à savoir, des yeux, une tête, des mains, et tout le reste du corps, ne sont pas choses imaginaires, mais vraies et
existantes. Car de vrai les peintres, lors même qu'ils s'étu¬dient avec le plus d'artifice à représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux ; ou bien, si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau, que jamais nous n'ayons rien vu de semblable, et qu'ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes à tout le moins les couleurs dont ils le composent doivent-elles être véritables.
Et par la même raison, encore que ces choses générales, à savoir, des yeux, une tête, des mains, et autres sem¬blables, pussent être imaginaires, il faut toutefois avouer qu'il y a des choses encore plus simples et plus univer¬selles, qui sont vraies et existantes, du mélange desquelles, ni plus ni moins que de celui de quelques véritables cou¬leurs, toutes ces images des choses qui résident en notre pensée, soit vraies et réelles, soit feintes et fantastiques, sont formées. De ce genre de choses est la nature corpo¬relle en général, et son étendue ; ensemble la figure des choses étendues, leur quantité ou grandeur, et leur nombre ; comme aussi le lieu où elles sont, le temps qui mesure leur durée, et autres semblables.
C'est pourquoi peut-être que de là nous ne conclurons pas mal, si nous disons que la physique, l'astronomie, la médecine, et toutes les autres sciences qui dépendent de la considération des choses composées, sont fort dou¬teuses et incertaines ; mais que l'arithmétique, la géomé¬trie, et les autres sciences de cette nature, qui ne traitent que de choses fort simples et fort générales, sans se mettre beaucoup en peine si elles sont dans la nature, ou si elles n'y sont pas, contiennent quelque chose de certain et d'indubitable. Car, soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le
nombre de cinq, et le carré n'aura jamais plus de quatre côtés ; et il ne semble pas possible que des vérités si appa¬rentes puissent être soupçonnées d'aucune fausseté ou d'incertitude.
Toutefois il y a longtemps que j'ai dans mon esprit une certaine opinion, qu'il y a un Dieu qui peut tout, et par qui j'ai été créé et produit tel que je suis. Or qui me peut avoir assuré que ce Dieu n'ait point fait qu'il n'y ait aucune terre, aucun ciel, aucun corps étendu, aucune figure, aucune grandeur, aucun lieu, et que néanmoins j'aie les sentiments de toutes ces choses, et que tout cela ne me semble point exister autrement que je le vois ? Et même, comme je juge quelquefois que les autres se méprennent, même dans les choses qu'ils pensent savoir avec le plus de certitude, il se peut faire qu'il ait voulu que je me trompe toutes les fois que je fais l'addition de deux et de trois, ou que je nombre les côtés d'un carré, ou que je juge de quelque chose encore plus facile, si l'on se peut imaginer rien de plus facile que cela. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte, car il est dit souverainement bon. Toutefois, si cela répu¬gnerait à sa bonté, de m'avoir fait tel que je me trompasse toujours, cela semblerait aussi lui être aucunement contraire, de permettre que je me trompe quelquefois, et néanmoins je ne puis douter qu'il ne le permette.
Il y aura peut-être ici des personnes qui aimeront mieux nier l'existence d'un Dieu si puissant que de croire que toutes les autres choses sont incertaines. Mais ne leur résistons pas pour le présent, et supposons, en leur faveur, que tout ce qui est dit ici d'un Dieu soit une fable. Toute¬fois, de quelque façon qu'ils supposent que je sois parvenu à l'état et à l'être que je possède, soit qu'ils l'attribuent à quelque destin ou fatalité, soit qu'ils le réfèrent au hasard, soit qu'ils veuillent que ce soit par une continuelle suite et liaison des choses, il est certain que, puisque faillir et se tromper est une espèce d'imperfection, d'autant moins
puissant sera l'auteur qu'ils attribueront à mon origine, d'autant plus sera-t-il probable que je suis tellement imparfait que je me trompe toujours. Auxquelles raisons je n'ai certes rien à répondre, mais je suis contraint d'avouer que, de toutes les opinions que j'avais autrefois reçues en ma créance pour véritables, il n'y en a pas une de laquelle je ne puisse maintenant douter, non par aucune inconsidération ou légèreté, mais pour des raisons très fortes et mûrement considérées : de sorte qu'il est nécessaire que j'arrête et suspende désormais mon juge¬ment sur ces pensées, et que je ne leur donne pas plus de créance, que je ferais à des choses qui me paraîtraient évidemment fausses, si je désire trouver quelque chose de constant et d'assuré dans les sciences.
Mais il ne suffit pas d'avoir fait ces remarques, il faut encore que je prenne soin de m'en souvenir ; car ces anciennes et ordinaires opinions me reviennent encore souvent en la pensée, le long et familier usage qu'elles ont eu avec moi leur donnant droit d'occuper mon esprit contre mon gré, et de se rendre presque maîtresses de ma créance. Et je ne me désaccoutumerai jamais d'y acquies¬cer, et de prendre confiance en elles, tant que je les consi¬dérerai telles qu'elles sont en effet, c'est à savoir en quelque façon douteuse, comme je viens de montrer, et toutefois fort probables, en sorte que l'on a beaucoup plus de raison de les croire que de les nier. C'est pourquoi je pense que j'en userai plus prudemment, si, prenant un parti contraire, j'emploie tous mes soins à me tromper moi-même, feignant que toutes ces pensées sont fausses et imaginaires ; jusques à ce qu'ayant tellement balancé mes préjugés, qu'ils ne puissent faire pencher mon avis plus d'un côté que d'un autre, mon jugement ne soit plus désormais maîtrisé par de mauvais usages et détourné du droit chemin qui le peut conduire à la connaissance de la vérité. Car je suis assuré que cependant il ne peut y avoir de péril ni d'erreur en cette voie, et que je ne saurais
aujourd'hui trop accorder à ma défiance, puisqu'il n'est pas maintenant question d'agir, mais seulement de médi¬ter et de connaître.
Je supposerai donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je pen¬serai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons, ne sont que des illusions et tromperies, dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerai moi-même comme n'ayant point de mains, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée ; et si, par ce moyen, il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C'est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne point recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur, que, pour puissant et rusé qu'il soit, il ne me pourra jamais rien imposer.
Mais ce dessein est pénible et laborieux, et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire. Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il com¬mence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint d'être réveillé, et conspire avec ces illusions agréables pour en être plus longuement abusé, ainsi je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions, et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement, de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelque jour et quelque lumière dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour
éclaircir toutes les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées.
2. La première formulation du cogito (1637)
Descartes, Discours de la méthode, IV,
GF-Flammarion, 2000, p. 65-66.
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières médi-tations que j'y ai faites ' ; car elles sont si métaphysiques et si peu communes, qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. J'avais dès longtemps remarqué que, pour les moeurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubi¬tables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; mais, pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus sup¬poser qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Et pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir, autant qu'aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit, n'étaient non plus vraies que
1. Descartes s'est alors retiré en Hollande.
les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pen¬sais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pou¬vais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie, que je cherchais.
3. La seconde formulation du cogito (1641)
Descartes, Méditations métaphysiques, «Méditation
seconde : de la nature de l'esprit humain ;
et qu'il est plus aisé à connaître que le corps «,
op. cit., p. 71-73.
La Méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes, qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant je ne vois pas de quelle façon je les pourrai résoudre ; et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement sur¬pris, que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m'efforcerai néan¬moins, et suivrai derechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrai imagi¬ner le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux ; et je continuerai toujours dans ce chemin, jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement, qu'il n'y a rien au monde de certain.
Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré. Ainsi j'aurai droit de conce¬voir de hautes espérances, si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit certaine et indubitable.
Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses ; je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me repré¬sente ; je pense n'avoir aucun sens ; je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain.
Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celles que je viens de juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute ? N'y a-t-il point quelque Dieu, ou quelque autre puissance, qui me met en l'esprit ces pensées ? Cela n'est pas nécessaire ; car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Moi donc à tout le moins ne suis-je pas quelque chose ? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là ? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens, que je ne puisse être sans eux ? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps ; ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point ? Non certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seule¬ment si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe ; et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé, et avoir soigneusement examiné toutes choses, enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette proposition : Je suis, j'existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit.
4. La critique du cogito chez Kant
Kant, Critique de la raison pure, «Des paralogismes
de la raison pure «, trad. Main Renaut,
GF--Flammarion, 2006, p. 402-406.
Pour commencer, une remarque générale peut servir à rendre plus aiguë l'attention que nous allons porter à ce type de raisonnement. Je ne connais pas un objet du simple fait que je pense, mais c'est uniquement dans la mesure où je détermine une intuition donnée du point de vue de l'unité de la conscience — en quoi consiste toute pensée — que je peux connaître un quelconque objet. Donc, je ne me connais pas moi-même par la conscience que j'ai de moi comme être pensant, mais si je suis conscient de l'intuition que j'ai de moi-même comme se trouvant déterminée relativement à la fonction de la pensée. Tous les modes de la conscience de soi dans la pensée ne sont pas encore en eux-mêmes des concepts de l'entendement s'appliquant à des objets (catégories), mais de simples fonctions logiques qui ne donnent à la pensée absolument aucun objet à connaître et par consé¬quent ne me donnent pas moi-même à connaître comme objet. Ce n'est pas la conscience du Moi déterminant qui constitue l'objet : bien plutôt est-ce uniquement la conscience du Moi déterminable, c'est-à-dire de mon intuition intérieure (dans la mesure où le divers qui s'y trouve contenu peut être synthétiquement lié conformé¬ment à la condition universelle de l'unité de l'aperception dans la pensée).
1. Cela étant, dans tous les jugements, je suis toujours le sujet déterminant du rapport qui définit le jugement. Mais que le Moi, le Je pense, doive toujours dans la pensée avoir valeur de sujet, de quelque chose qui ne puisse être simplement considéré comme un prédicat venant s'attacher à la pensée, c'est une proposition apo
constructions et, chacun selon la manière dont sa bonne étoile le favorise, d'en prendre possession. Car la proposi¬tion selon laquelle tout être pensant est, en tant que tel, une substance simple est une proposition synthétique a priori, puisque, premièrement, elle va au-delà du concept qui lui sert de principe et ajoute à la pensée en général la modalité de l'existence, et que, deuxièmement, elle adjoint à ce concept un prédicat (celui de la simplicité) qui ne peut être donné dans la moindre expérience. Dès lors, les propositions synthétiques a priori pourraient être pratiquées et acceptées, non pas simplement, comme nous l'avons affirmé, par rapport à des objets d'une expé¬rience possible, en constituant plus précisément les prin¬cipes de la possibilité de cette expérience, mais elles pourraient porter aussi sur des choses en général et en soi : conséquence qui met un terme à toute la critique entreprise et imposerait d'en rester à la situation ancienne. Toutefois, le danger n'est ici pas si grand, si l'on considère la chose de plus près.
Dans le procédé de la psychologie rationnelle, ce qui domine, c'est un paralogisme que présente le syllogisme suivant :
Ce qui ne peut être pensé que comme sujet n'existe pas non plus autrement que comme sujet et est donc substance.
Or, un être pensant, considéré simplement comme tel, ne peut être pensé autrement que comme sujet.
Donc, il n'existe aussi que comme tel, c'est-à-dire comme substance.
Dans la majeure, il est question d'un être qui peut être pensé en général, sous tous les rapports, par conséquent aussi tel qu'il peut être donné dans l'intuition. En revanche, dans la mineure, il n'est question du même être que dans la mesure où il se considère lui-même comme sujet uniquement par rapport à la pensée et à l'unité de la conscience, mais non pas en même temps relativement à l'intuition par laquelle il est donné comme objet à la
pensée. C'est donc per sophisma figurée dictionis, par conséquent par un raisonnement trompeur, que la conclusion est obtenue.
Que cette réduction du célèbre argument à un paralo¬gisme soit tout à fait juste, cela devient clair et transpa¬rent dès lors que l'on veut bien examiner la remarque générale sur la représentation systématique des principes et la section traitant des noumènes, où il a été démontré que le concept d'une chose qui peut exister en soi comme sujet, et non pas simplement comme prédicat, ne contient encore en lui aucune réalité objective — ce qui veut dire que l'on ne peut pas savoir s'il pourrait se trou¬ver quelque part un objet qui lui corresponde, étant donné que l'on n'aperçoit pas la possibilité d'un tel mode d'existence, et que par conséquent un tel concept ne fournit absolument aucune connaissance. Si ce concept doit donc indiquer, sous le nom de substance, un objet susceptible d'être donné, s'il doit devenir une connais¬sance, il faut qu'il y ait, à sa base, une intuition perma¬nente, condition indispensable de la réalité objective d'un concept, constituant ce par quoi seulement l'objet est donné. Or, nous n'avons, dans l'intuition intérieure, absolument rien qui soit permanent, puisque, de fait, le moi n'est que la conscience de ma pensée ; donc, si nous nous en tenons simplement à la pensée, il nous manque même la condition nécessaire pour nous appliquer à nous-mêmes, comme êtres pensants, le concept de la sub¬stance, c'est-à-dire le concept d'un sujet subsistant pour soi : du même coup, avec la réalité objective de ce concept, disparaît entièrement la simplicité de la sub¬stance qui s'y rattache, laquelle se transforme en une unité purement logique, qualitative, de la conscience de soi dans la pensée en général, et cela, que le sujet soit ou non composé.
5. La reformulation cartésienne
de l'argument ontologique
Descartes, Méditations métaphysiques, « Méditation
cinquième : de l'essence des choses matérielles ;
et, derechef de Dieu, qu'il existe «,
op. cit., p. 155-163.
Il me reste beaucoup d'autres choses à examiner, tou¬chant les attributs de Dieu, et touchant ma propre nature, c'est-à-dire celle de mon esprit : mais j'en repren¬drai peut-être une autre fois la recherche. Maintenant (après avoir remarqué ce qu'il faut faire ou éviter pour parvenir à la connaissance de la vérité), ce que j'ai princi¬palement à faire, est d'essayer de sortir et me débarrasser de tous les doutes où je suis tombé ces jours passés, et voir si l'on ne peut rien connaître de certain touchant les choses matérielles.
Mais avant que j'examine s'il y a de telles choses qui existent hors de moi, je dois considérer leurs idées, en tant qu'elles sont en ma pensée, et voir quelles sont celles qui sont distinctes, et quelles sont celles qui sont confuses.
En premier lieu, j'imagine distinctement cette quantité que les philosophes appellent vulgairement la quantité continue, ou bien l'extension en longueur, largeur et pro¬fondeur, qui est en cette quantité, ou plutôt en la chose à qui on l'attribue. De plus, je puis nombrer en elle plu¬sieurs diverses parties, et attribuer à chacune de ces par¬ties toutes sortes de grandeurs, de figures, de situations, et de mouvements ; et enfin, je puis assigner à chacun de ces mouvements toutes sortes de durée.
Et je ne connais pas seulement ces choses avec distinc¬tion, lorsque je les considère en général ; mais aussi, pour peu que j'y applique mon attention, je conçois une infi
nité de particularités touchant les nombres, les figures, les mouvements, et autres choses semblables, dont la vérité se fait paraître avec tant d'évidence et s'accorde si bien avec ma nature, que lorsque je commence à les découvrir, il ne me semble pas que j'apprenne rien de nouveau, mais plutôt que je me ressouviens de ce que je savais déjà auparavant, c'est-à-dire que j'aperçois des choses qui étaient déjà dans mon esprit, quoique je n'eusse pas encore tourné ma pensée vers elles.
Et ce que je trouve ici de plus considérable, est que je trouve en moi une infinité d'idées de certaines choses, qui ne peuvent pas être estimées un pur néant, quoique peut-être elles n'aient aucune existence hors de ma pensée, et qui ne sont pas feintes par moi, bien qu'il soit en ma liberté de les penser ou ne les penser pas ; mais elles ont leurs natures vraies et immuables. Comme, par exemple, lorsque j'imagine un triangle, encore qu'il n'y ait peut-être en aucun lieu du monde hors de ma pensée une telle figure, et qu'il n'y en ait jamais eu, il ne laisse pas néanmoins d'y avoir une certaine nature, ou forme, ou essence déterminée de cette figure, laquelle est immuable et éternelle, que je n'ai point inventée, et qui ne dépend en aucune façon de mon esprit ; comme il paraît de ce que l'on peut démontrer diverses propriétés de ce triangle, à savoir, que ses trois angles sont égaux à deux droits, que le plus grand angle est soutenu par le plus grand côté, et autres semblables, lesquelles mainte¬nant, soit que je le veuille ou non, je reconnais très claire¬ment et très évidemment être en lui, encore que je n'y aie pensé auparavant en aucune façon, lorsque je me suis imaginé la première fois un triangle ; et partant on ne peut pas dire que je les aie feintes et inventées.
Et je n'ai que faire ici de m'objecter, que peut-être cette idée du triangle est venue en mon esprit par l'entremise de mes sens, parce que j'ai vu quelquefois des corps de figure triangulaire ; car je puis former en mon esprit une
infinité d'autres figures, dont on ne peut avoir le moindre soupçon que jamais elles me soient tombées sous les sens, et je ne laisse pas toutefois de pouvoir démontrer diverses propriétés touchant leur nature, aussi bien que touchant celle du triangle : lesquelles certes doivent être toutes vraies, puisque je les conçois clairement. Et partant elles sont quelque chose, et non pas un pur néant ; car il est très évident que tout ce qui est vrai est quelque chose, et j'ai déjà amplement démontré ci-dessus que toutes les choses que je connais clairement et distinctement sont vraies. Et quoique je ne l'eusse pas démontré, toutefois la nature de mon esprit est telle, que je ne me saurais empêcher de les estimer vraies, pendant que je les conçois clairement et distinctement. Et je me ressouviens que, lors même que j'étais encore fortement attaché aux objets des sens, j'avais tenu au nombre des plus constantes véri¬tés celles que je concevais clairement et distinctement touchant les figures, les nombres, et les autres choses qui appartiennent à l'arithmétique et à la géométrie.
Or maintenant, si de cela seul que je puis tirer de ma pensée l'idée de quelque chose, il s'ensuit que tout ce que je reconnais clairement et distinctement appartenir à cette chose, lui appartient en effet, ne puis-je pas tirer de ceci un argument et une preuve démonstrative de l'exis¬tence de Dieu ? Il est certain que je ne trouve pas moins en moi son idée, c'est-à-dire l'idée d'un être souveraine¬ment parfait, que celle de quelque figure ou de quelque nombre que ce soit. Et je ne connais pas moins claire¬ment et distinctement qu'une actuelle et éternelle exis¬tence appartient à sa nature, que je connais que tout ce que je puis démontrer de quelque figure ou de quelque nombre, appartient véritablement à la nature de cette figure ou de ce nombre. Et partant, encore que tout ce que j'ai conclu dans les méditations précédentes ne se trouvât point véritable, l'existence de Dieu doit passer en mon esprit au moins pour aussi certaine, que j'ai estimé
jusques ici toutes les vérités des mathématiques, qui ne regardent que les nombres et les figures : bien qu'à la vérité cela ne paraisse pas d'abord entièrement manifeste, mais semble avoir quelque apparence de sophisme. Car, ayant accoutumé dans toutes les autres choses de faire distinction entre l'existence et l'essence, je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, que de l'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits, ou bien de l'idée d'une montagne l'idée d'une vallée ; en sorte qu'il n'y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu (c'est-à-dire un être souverainement parfait) auquel manque l'exis¬tence (c'est-à-dire auquel manque quelque perfection), que de concevoir une montagne qui n'ait point de vallée.
Mais encore qu'en effet je ne puisse pas concevoir un Dieu sans existence, non plus qu'une montagne sans vallée, toutefois, comme de cela seul que je conçois une montagne avec une vallée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait aucune montagne dans le monde, de même aussi, quoique je conçoive Dieu avec l'existence, il semble qu'il ne s'ensuit pas pour cela qu'il y en ait aucun qui existe : car ma pensée n'impose aucune nécessité aux choses ; et comme il ne tient qu'à moi d'imaginer un cheval ailé, encore qu'il n'y en ait aucun qui ait des ailes, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence à Dieu, encore qu'il n'y eût aucun Dieu qui existât. Tant s'en faut, c'est ici qu'il y a un sophisme caché sous l'apparence de cette objection : car de ce que je ne puis concevoir une mon¬tagne sans vallée, il ne s'ensuit pas qu'il y ait au monde aucune montagne, ni aucune vallée, mais seulement que la montagne et la vallée, soit qu'il y en ait, soit qu'il n'y en ait point, ne se peuvent en aucune façon séparer l'une
d'avec l'autre ; au lieu que, de cela seul que je ne puis concevoir Dieu sans existence, il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui, et partant qu'il existe véritable-ment : non pas que ma pensée puisse faire que cela soit de la sorte, et qu'elle impose aux choses aucune nécessité ; mais, au contraire, parce que la nécessité de la chose même, à savoir de l'existence de Dieu, détermine ma pensée à le concevoir de cette façon. Car il n'est pas en ma liberté de concevoir un Dieu sans existence (c'est-à-dire un être souverainement parfait sans une souveraine perfection), comme il m'est libre d'imaginer un cheval sans ailes ou avec des ailes.
6. La critique kantienne de l'argument
ontologique
Kant, Critique de la raison pure, «De l'impossibilité
d'une preuve ontologique de l'existence de Dieu «,
op. cit., p. 530-536.
On voit à partir de ce qui précède que le concept d'un être absolument nécessaire est un concept pur de la raison, c'est-à-dire une simple Idée dont la réalité objec¬tive est encore loin de se trouver démontrée par le fait que la raison en a besoin : une Idée qui ne fait au demeu¬rant que nous indiquer une certaine perfection, pourtant inaccessible, et sert proprement plutôt à limiter notre entendement qu'à l'élargir à de nouveaux objets. Or il y a là ceci d'étrange et de paradoxal que le raisonnement qui conduit d'une existence donnée en général à quelque existence absolument nécessaire semble être contraignant et rigoureux, et que nous avons pourtant entièrement contre nous toutes les conditions qu'impose l'entende-ment pour se forger un concept d'une telle nécessité.
On a de tout temps parlé de l'être absolument nécessaire et l'on ne s'est pas donné autant de peine pour com¬prendre si et comment on peut même simplement penser une chose de ce type que pour en prouver l'existence. Or, il est certes tout à fait facile de fournir de ce concept une définition nominale, savoir que c'est quelque chose de tel que sa non-existence est impossible ; mais par là on n'est en rien devenu plus au fait des conditions qui rendent impossible de considérer le non-être d'une chose comme absolument impensable, et qui sont proprement ce que l'on veut savoir, c'est-à-dire si par l'intermédiaire de ce concept nous nous forgeons ou non, en général, la pensée de quelque chose. Car rejeter, en recourant au mot : inconditionné, toutes les conditions dont l'entende
ment a toujours besoin pour considérer quelque chose comme nécessaire ne me fait pas encore comprendre, tant s'en faut, si dès lors, par ce concept d'un être incondi¬tionnellement nécessaire, je pense encore quelque chose ou si, peut-être, je ne pense absolument rien.
Bien plus : ce concept qui avait été risqué à tout hasard et qui est finalement devenu tout à fait courant, on a cru l'expliquer, de surcroît, en recourant à une foule d'exemples, en sorte que toute interrogation ultérieure sur sa compréhensibilité parût totalement inutile. Toute proposition de la géométrie, par exemple qu'un triangle possède trois angles, est absolument nécessaire ; et c'est dans ces termes que l'on se mit à parler d'un objet situé tout à fait en dehors de la sphère de notre entendement, comme si l'on comprenait parfaitement bien ce que l'on voulait dire avec le concept que l'on se faisait de lui.
Tous les exemples avancés sont, sans exception, tirés uniquement de jugements, et non pas de choses et de leur existence. Mais la nécessité inconditionnée des jugements n'est pas une nécessité absolue des choses. Car la nécessité absolue du jugement est seulement une nécessité condi¬tionnée de la chose ou du prédicat présent dans le juge¬ment. La proposition précédemment mentionnée ne disait pas que trois angles sont absolument nécessaires, mais que, sous la condition qu'un triangle existe (soit donné), il existe aussi en lui (de façon nécessaire) trois angles. Cependant, cette nécessité logique a montré une si grande puissance d'illusion que, après s'être forgé d'une chose un concept a priori tel que, selon l'opinion com-mune que l'on en a, il englobe dans sa compréhension l'existence, on crut pouvoir en conclure avec sûreté que, parce que l'existence appartient nécessairement à l'objet de ce concept, c'est-à-dire à la condition que je pose cette chose comme donnée (comme existante), son existence était elle aussi nécessairement posée (d'après la règle de l'identité), et donc que cet être était lui-même absolument
nécessaire parce que son existence se trouvait comprise par la pensée dans un concept arbitrairement admis et sous la condition que je pose l'objet de ce concept.
Si, dans un jugement d'identité, je supprime le prédi¬cat et conserve le sujet, une contradiction surgit, et c'est la raison pour laquelle je dis que le prédicat appartient de manière nécessaire au sujet. Mais si je supprime le sujet en même temps que le prédicat, il ne surgit aucune contradiction ; car il n'y a plus rien avec quoi puisse inter¬venir une contradiction. Poser un triangle et cependant en supprimer les trois angles, c'est contradictoire ; mais supprimer le triangle en même temps que ses trois angles, ce n'est pas une contradiction. Exactement de même en va-t-il avec le concept d'un être absolument nécessaire. Si vous supprimez son existence, vous supprimez la chose elle-même avec tous ses prédicats ; d'où peut provenir alors la contradiction ? Extérieurement, il n'y a rien avec quoi il pût y avoir contradiction, étant donné que la chose ne doit pas être extérieurement nécessaire ; inté¬rieurement, il n'y a non plus rien de tel, puisque, par la suppression de la chose elle-même, vous avez en même temps supprimé toutes ses déterminations intérieures. Dieu est tout-puissant : c'est là un jugement nécessaire. La toute-puissance ne peut être supprimée dès lors que vous posez une divinité, c'est-à-dire un être infini, au concept duquel celui de toute-puissance est identique. Mais si vous dites : Dieu n'est pas, alors ni la toute-puissance, ni nul autre de ses prédicats n'est donné ; car ils sont tous supprimés en même temps que le sujet, et il ne se manifeste dans cette pensée pas la moindre contradiction. [...]
Quand je pense donc une chose, quels que soient les prédicats au moyen desquels je la pense et si nombreux qu'ils soient (même dans la détermination complète), du fait que j'ajoute encore que cette chose existe, je n'ajoute pas le moindre élément à la chose. Car, si tel était le cas,
ce ne serait plus juste la même chose qui existerait, mais plus que ce dont je m'étais forgé la pensée dans mon concept, et je ne pourrais plus dire que c'est exactement l'objet de mon concept qui existe. Si en outre, dans une chose, je pense même toute réalité, à l'exception d'une seule, la réalité manquante ne vient pas s'y ajouter du fait que je dise qu'une telle chose incluant un manque existe ; au contraire existe-t-elle précisément affectée du même manque que lorsque je l'avais pensée, étant donné que, sinon, ce serait quelque chose d'autre que ce que j'ai pensé qui existerait. Si je me forge donc la pensée d'un être que je considère comme la suprême réalité (exempt de tout manque), la question demeure de savoir s'il existe ou non. Car, bien que, dans mon concept, rien ne manque du contenu réel possible d'une chose en général, il manque encore quelque chose au rapport à l'ensemble de tout mon état de pensée, savoir que la connaissance de cet objet soit aussi possible a posteriori. Et c'est ici que se manifeste la cause de la difficulté qui règne à cet égard. S'il s'agissait d'un objet des sens, je ne pourrais confondre l'existence de la chose avec le simple concept de la chose. Par le concept, en effet, l'objet n'est pensé que comme s'accordant avec les conditions universelles d'une connaissance empirique possible en général, alors qu'à travers l'existence il se trouve pensé comme faisant partie du contexte de l'expérience dans sa totalité ; auquel cas, par sa liaison avec le contenu de toute expérience, le concept de l'objet n'est certes pas le moins du monde augmenté, mais notre pensée en reçoit en plus une per¬ception possible. Si nous voulons au contraire penser l'existence uniquement à travers la catégorie pure, il n'est pas étonnant que nous ne puissions fournir aucun critère pour la distinguer de la simple possibilité.
Quel que soit ce que notre concept d'un objet puisse bien contenir, et de quelque ampleur que soit ce contenu, il nous faut pourtant sortir du concept pour attribuer à
ce qu'il contient l'existence. Pour ce qui est des objets des sens, cela s'opère en articulant ce contenu à quel-qu'une de mes perceptions conformément à des lois empiriques ; mais pour des objets de la pensée pure, il n'y a absolument aucun moyen de connaître leur existence, puisqu'il faudrait la connaître totalement a priori. En fait, notre conscience de toute existence (que ce soit de manière immédiate, par la perception, ou à travers des raisonnements qui relient quelque chose à la perception) appartient intégralement à l'unité de l'expérience, et si une existence extérieure à ce champ ne peut certes pas être déclarée absolument impossible, du moins est-ce une supposition que rien ne nous autorise à justifier.
Le concept d'un être suprême est une Idée qui, à maints égards, est très utile ; mais, précisément parce qu'elle est simplement une Idée, elle est totalement incapable d'étendre à elle seule notre connaissance par rapport à ce qui existe. Elle ne nous permet pas même de nous instruire davantage relativement à la possibilité. [...]
En ce sens, on perdrait toute sa peine et tout son tra¬vail en se consacrant à cette preuve ontologique (carté¬sienne) si célèbre qui entend démontrer par des concepts l'existence d'un être suprême, et nul être humain ne sau¬rait davantage devenir plus riche de connaissance à partir de simples Idées qu'un marchand ne le deviendrait en argent si, pour améliorer l'état de la fortune, il voulait ajouter quelques zéros à son relevé de caisse.
7. Cartésianisme et révolution
Tocqueville, De la démocratie en Amérique,
« De la méthode philosophique des Américains «,
tome II, chap. I, GF-Flammarion, 1981, p. 9-12.
Je pense qu'il n'y a pas, dans le monde civilisé, de pays où l'on s'occupe moins de philosophie qu'aux États-Unis.
Les Américains n'ont point d'école philosophique qui leur soit propre, et ils s'inquiètent fort peu de toutes celles qui divisent l'Europe ; ils en savent à peine les noms.
Il est facile de voir cependant que presque tous les habitants des États-Unis dirigent leur esprit de la même manière, et le conduisent d'après les mêmes règles ; c'est-à-dire qu'ils possèdent, sans qu'ils se soient jamais donné la peine d'en définir les règles, une certaine méthode phi-losophique qui leur est commune à tous. [...]
Chacun se renferme donc étroitement en soi-même et prétend de là juger le monde.
L'usage où sont les Américains de ne prendre qu'en eux-mêmes la règle de leur jugement conduit leur esprit à d'autres habitudes.
Comme ils voient qu'ils parviennent à résoudre sans aide toutes les petites difficultés que présente leur vie pratique, ils en concluent aisément que tout dans le monde est explicable, et que rien n'y dépasse les bornes de l'intelligence.
Ainsi, ils nient volontiers ce qu'ils ne peuvent com-prendre : cela leur donne peu de foi pour l'extraordinaire et un dégoût presque invincible pour le surnaturel.
Comme c'est à leur propre témoignage qu'ils ont cou¬tume de s'en rapporter, ils aiment à voir très clairement l'objet dont ils s'occupent ; ils le débarrassent donc, autant qu'ils le peuvent, de son enveloppe, ils écartent tout ce qui les en sépare et enlèvent tout ce qui le cache
aux regards, afin de le voir de plus près et en plein jour. Cette disposition de leur esprit les conduit bientôt à mépriser les formes, qu'ils considèrent comme des voiles inutiles et incommodes placés entre eux et la vérité.
Les Américains n'ont donc pas eu besoin de puiser leur méthode philosophique dans les livres, ils l'ont trouvée en eux-mêmes. J'en dirai autant de ce qui s'est passé en Europe.
Cette même méthode ne s'est établie et vulgarisée en Europe qu'à mesure que les conditions y sont devenues plus égales et les hommes plus semblables.
Considérons un moment l'enchaînement des temps :
Au xvie siècle, les réformateurs soumettent à la raison individuelle quelques-uns des dogmes de l'ancienne foi ; mais ils continuent à lui soustraire la discussion de tous les autres. Au )(vie, Bacon, dans les sciences naturelles, et Descartes, dans la philosophie proprement dite, abo¬lissent les formules reçues, détruisent l'empire des tradi¬tions et renversent l'autorité du maître.
Les philosophes du )(vine siècle, généralisant enfin le même principe, entreprennent de soumettre à l'examen individuel de chaque homme l'objet de toutes ses croyances.
Qui ne voit que Luther, Descartes et Voltaire se sont servis de la même méthode, et qu'ils ne différent que dans le plus ou moins grand usage qu'ils ont prétendu qu'on en fit ?
D'où vient que les réformateurs se sont si étroitement renfermés dans le cercle des idées religieuses ? Pourquoi Descartes, ne voulant se servir de sa méthode qu'en cer¬taines matières, bien qu'il l'eût mise en état de s'appliquer à toutes, a-t-il déclaré qu'il ne fallait juger par soi-même que les choses de philosophie et non de politique ? Comment est-il arrivé qu'au xVIIIe siècle on ait tiré tout à coup de cette même méthode des applications générales que Descartes et ses prédécesseurs n'avaient point
aperçues ou s'étaient refusés à découvrir ? D'où vient enfin qu'à cette époque la méthode dont nous parlons est soudainement sortie des écoles pour pénétrer dans la société et devenir la règle commune de l'intelligence, et qu'après avoir été populaire chez les Français, elle a été ostensiblement adoptée ou secrètement suivie par tous les peuples de l'Europe ?
La méthode philosophique dont il est question a pu naître au XVIe siècle, se préciser et se généraliser au xvile ; mais elle ne pouvait être communément adoptée dans aucun des deux. Les lois politiques, l'état social, les habi¬tudes d'esprit qui découlent de ces premières causes, s'y opposaient.
Elle a été découverte à une époque où les hommes commençaient à s'égaliser et à se ressembler. Elle ne pou¬vait être généralement suivie que dans des siècles où les conditions étaient enfin devenues à peu près pareilles et les hommes presque semblables.
La méthode philosophique du XVIIIe siècle n'est donc pas seulement française, mais démocratique, ce qui explique pourquoi elle a été si facilement admise dans toute l'Europe, dont elle a tant contribué à changer la face. Ce n'est point parce que les Français ont changé leurs anciennes croyances et modifié leurs anciennes moeurs qu'ils ont bouleversé le monde, c'est parce que, les premiers, ils ont généralisé et mis en lumière une méthode philosophique à l'aide de laquelle on pouvait aisément attaquer toutes les choses anciennes et ouvrir la voie à toutes les nouvelles.

«
58 1 DESCARTES : «JE PENSE DONC JE SUIS »
paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec
liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opi
nions.
Or il ne sera pas nécessaire, pour arriver à ce des
sein, de prouver qu'elles sont toutes fausses, de quoi peut
être je ne viendrais jamais à
bout; mais, d'autant que la
raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soi
gneusement m'empêcher de donner créance aux choses
qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables,
qu'à celles qui nous paraissent manifestement être fausses,
le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour
me les faire toutes rejeter.
Et pour cela il n'est pas besoin
que je
les examine chacune en particulier, ce qui serait
d'un travail infini; mais, parce que la ruine des fonde
ments entraîne nécessairement avec soi
tout le reste de
l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur les
quels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées.
Tout
ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai
et assuré, je l'ai appris des sens,
ou par les sens : or j'ai
quelquefois éprouvé que
ces sens étaient trompeurs, et il
est de la prudence de ne
se fier jamais entièrement à ceux
qui nous
ont une fois trompés.
Mais, encore que
les sens nous trompent quelquefois,
touchant
les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en
rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquelles
on ne
peut pas raisonnablement douter, quoique nous les
connaissions par leur moyen : par exemple, que je sois ici,
assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce
papier entre les mains, et autres choses de cette nature.
Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et
ce corps-ci soient à moi
? si ce n'est peut-être que je me
compare à
ces insensés, de qui le cerveau est tellement
troublé et offusqué par
les noires vapeurs de la bile, qu'ils
assurent constamment qu'ils sont des rois, lorsqu'ils sont
très pauvres ; qu'ils sont vêtus
d'or et de pourpre, lors
qu'ils sont
tout nus; ou s'imaginent être des cruches, ou
avoir un corps de verre.
Mais quoi ? ce sont des fous ; et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DISCOURS DE LA MÉTHODE POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON ET CHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES René Descartes. Traité philosophique
- EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
- La rupture philosophique des Méditations métaphysiques de Descartes
- Explication du texte philosophique de Descartes, Lettres à Elizabeth
- La Fontaine avait beaucoup de goût pour les lectures et discussions philosophiques. Il lisait, s'il faut l'en croire, Platon; il discutait le système de Descartes; il s'engouait, grâce à son ami Bernier, de la philosophie de Gassendi, etc. Dans quelle mesure, selon vous, peut-on trouver dans les Fables un intérêt philosophique ?