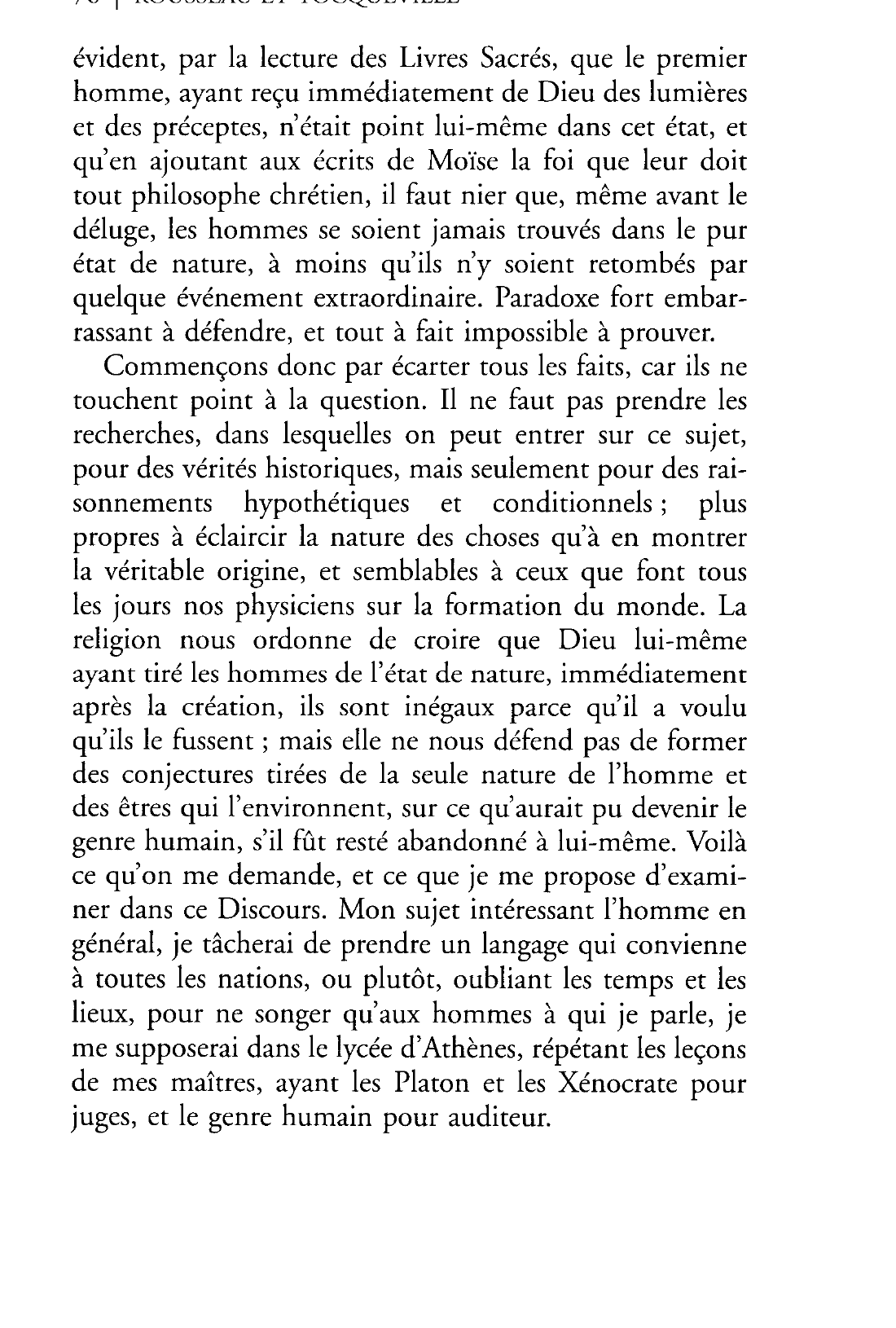Anthologie sur l'art et l'esthétisme (philo)
Publié le 01/04/2015

Extrait du document
EXTRAITS
1. L'état de nature
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Introduction, GF-Flammarion,
2012, p. 64-66.
Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu'à l'état de nature, mais aucun d'eux n'y est arrivé. Les uns n'ont point balancé à supposer à l'homme dans cet état la notion du juste et de l'injuste, sans se soucier de mon¬trer qu'il dût avoir cette notion, ni même qu'elle lui fût utile. D'autres ont parlé du droit naturel que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu'ils entendaient par appartenir ; d'autres, donnant d'abord au plus fort l'autorité sur le plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, sans songer au temps qui dut s'écouler avant que le sens des mots d'autorité et de gou¬vernement pût exister parmi les hommes. Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d'avidité, d'oppression, de désirs et d'orgueil, ont transporté à l'état de nature des idées qu'ils avaient prises dans la société. Ils parlaient de l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil. Il n'est pas même venu dans l'esprit de la plupart des nôtres de douter que l'état de nature eût existé, tandis qu'il est
évident, par la lecture des Livres Sacrés, que le premier homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières et des préceptes, n'était point lui-même dans cet état, et qu'en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, à moins qu'ils n'y soient retombés par quelque événement extraordinaire. Paradoxe fort embar¬rassant à défendre, et tout à fait impossible à prouver.
Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet, pour des vérités historiques, mais seulement pour des rai¬sonnements hypothétiques et conditionnels ; plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes de l'état de nature, immédiatement après la création, ils sont inégaux parce qu'il a voulu qu'ils le fussent ; mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la seule nature de l'homme et des êtres qui l'environnent, sur ce qu'aurait pu devenir le genre humain, s'il fût resté abandonné à lui-même. Voilà ce qu'on me demande, et ce que je me propose d'exami¬ner dans ce Discours. Mon sujet intéressant l'homme en général, je tâcherai de prendre un langage qui convienne à toutes les nations, ou plutôt, oubliant les temps et les lieux, pour ne songer qu'aux hommes à qui je parle, je me supposerai dans le lycée d'Athènes, répétant les leçons de mes maîtres, ayant les Platon et les Xénocrate pour juges, et le genre humain pour auditeur.
2. La pitié
Rousseau, Émile ou de l'éducation, IV,
GF-Flammarion, 2009, p. 318-321.
Il suit de là que nous nous attachons à nos semblables moins par le sentiment de leurs plaisirs que par celui de leurs peines ; car nous y voyons bien mieux l'identité de notre nature et les garants de leur attachement pour nous. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. L'aspect d'un homme heureux inspire aux autres moins d'amour que d'envie ; on l'accuserait volontiers d'usurper un droit qu'il n'a pas en se faisant un bonheur exclusif ; et l'amour-propre souffre encore en nous faisant sentir que cet homme n'a nul besoin de nous. Mais qui est-ce qui ne plaint pas le malheureux qu'il voit souffrir ? Qui est-ce qui ne voudrait pas le délivrer de ses maux s'il n'en coûtait qu'un souhait pour cela ? L'imagination nous met à la place du misérable plutôt qu'à celle de l'homme heu¬reux ; on sent que l'un de ces états nous touche de plus près que l'autre. La pitié est douce, parce qu'en se met¬tant à la place de celui qui souffre, on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. L'envie est amère, en ce que l'aspect d'un homme heureux, loin de mettre l'envieux à sa place, lui donne le regret de n'y pas être. Il semble que l'un nous exempte des maux qu'il souffre, et que l'autre nous ôte les biens dont il jouit. [...]
Les hommes ne sont naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni riches ; tous sont nés nus et pauvres, tous sujets aux misères de la vie, aux chagrins, aux maux, aux besoins, aux douleurs de toute espèce ; enfin, tous sont condamnés à la mort. Voilà ce qui est vraiment de l'homme ; voilà de quoi nul mortel n'est exempt. Com¬mencez donc par étudier de la nature humaine ce qui en est le plus inséparable, ce qui constitue le mieux l'humanité.
À seize ans l'adolescent sait ce que c'est que souffrir ; car il a souffert lui-même ; mais à peine sait-il que d'autres êtres souffrent aussi ; le voir sans le sentir n'est pas le savoir, et, comme je l'ai dit cent fois, l'enfant n'imaginant point ce que sentent les autres ne connaît de maux que les siens : mais quand le premier développement des sens allume en lui le feu de l'imagination, il commence à se sentir dans ses semblables, à s'émouvoir de leurs plaintes et à souffrir de leurs douleurs. C'est alors que le triste tableau de l'huma¬nité souffrante doit porter à son coeur le premier attendris¬sement qu'il ait jamais éprouvé. [...]
Ainsi naît la pitié, premier sentiment relatif qui touche le coeur humain selon l'ordre de la nature. Pour devenir sensible et pitoyable, il faut que l'enfant sache qu'il y a des êtres semblables à lui qui souffrent ce qu'il a souffert, qui sentent les douleurs qu'il a senties, et d'autres dont il doit avoir l'idée, comme pouvant les sentir aussi. En effet, comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n'est en nous transportant hors de nous et nous identi¬fiant avec l'animal souffrant, en quittant, pour ainsi dire, notre être pour prendre le sien ? Nous ne souffrons qu'au¬tant que nous jugeons qu'il souffre ; ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Ainsi nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime et commence à le transporter hors de lui.
3. Liberté de l'homme
Rousseau, Du contrat social, I, I, GF-Flammarion,
2012, p. 42.
L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être
plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.
Si je ne considérais que la force, et l'effet qui en dérive, je dirais : tant qu'un Peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien ; sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux ; car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou l'on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là je dois établir ce que je viens d'avancer.
4. « De l'état civil «
Rousseau, Du contrat social, I, VIII, ibid., p. 56-57.
Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substi¬tuant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se déve¬loppent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'enno¬blissent, son âme tout entière s'élève à tel point, que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient
souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme.
Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la pro-priété qui ne peut être fondée que sur un titre positif.
On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vrai¬ment maître de lui ; car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté.
5. Le pacte social ou le peuple à la fois sujet et souverain
Rousseau, Du contrat social, I, vi, ibid., p. 51-54.
Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obs¬tacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature, l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être.
Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nou¬velles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.
Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs : mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit ? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes.
« Trouver une forme d'association qui défende et pro¬tège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. « Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution.
Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues ; jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.
Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : Car première-ment, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.
De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer : Car s'il restait quelques droits aux
particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge préten-drait bientôt l'être en tous, l'état de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine.
Enfin chacun se donnant à tous ne se donne à per-sonne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes sui¬vants. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indi¬visible du tout.
À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés ils prennent collecti¬vement le nom de peuple, et s'appellent en particulier Citoyens comme participants à l'autorité souveraine, et Sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.
6. De la loi et du législateur
Rousseau, Du contrat social, II, vI, p. 72-74.
Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi ? Tant qu'on se contentera de n'attacher à ce mot que des idées méta-physiques, on continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'État.
J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet cet objet particulier est dans l'État ou hors de l'État. S'il est hors de l'État, une volonté qui lui est étrangère n'est point générale par rapport à lui ; et si cet objet est dans l'État, il en fait partie : Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout moins cette même partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est point le tout, et tant que ce rapport subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties inégales ; d'où il suit que la volonté de l'une n'est point non plus générale par rapport à l'autre.
Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne considère que lui-même, et s'il se forme alors un rap¬port, c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est géné¬rale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi. [...]
J'appelle donc République tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être : car alors seulement l'intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout Gouvernement légitime est républicain' : j'expliquerai ci-après ce que c'est que le Gouvernement.
1. Je n'entends pas seulement par ce mot une Aristocratie ou une Démocratie, mais en général tout gouvernement guidé par la
Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le Peuple soumis aux lois en doit être l'auteur ; il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société : mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d'un commun accord, par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ces volontés ? Qui lui donnera la pré¬voyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance, ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande et aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paraître, lui mon¬trer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des avantages présents et sensibles, par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent : le public veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides : Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison ; il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Alors des lumières publiques résulte l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social, de là l'exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité d'un Législateur.
volonté générale, qui est la loi. Pour être légitime il ne faut pas que le Gouvernement se confonde avec le Souverain, mais qu'il en soit le ministre : alors la monarchie elle-même est république [note de Rousseau].
7. La passion de l'égalité
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, I,
GF-Flammarion, 1981, t. II, p. 119-122.
La première et la plus vive des passions que l'égalité des conditions fait naître, je n'ai pas besoin de le dire, c'est l'amour de cette même égalité. On ne s'étonnera donc pas que j'en parle avant toutes les autres.
Chacun a remarqué que, de notre temps, et spéciale-ment en France, cette passion de l'égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le coeur humain. On a dit cent fois que nos contemporains avaient un amour bien plus ardent et bien plus tenace pour l'égalité que pour la liberté ; mais je ne trouve point qu'on soit encore suffisamment remonté jusqu'aux causes de ce fait. Je vais l'essayer. [...]
Le goût que les hommes ont pour la liberté et celui qu'ils ressentent pour l'égalité sont, en effet, deux choses distinctes, et je ne crains pas d'ajouter que, chez les peuples démocratiques, ce sont deux choses inégales.
Si l'on veut y faire attention, on verra qu'il se rencontre dans chaque siècle un fait singulier et dominant auquel les autres se rattachent ; ce fait donne presque toujours naissance à une pensée mère, ou à une passion principale qui finit ensuite par attirer à elle et par entraîner dans son cours tous les sentiments et toutes les idées. C'est comme le grand fleuve vers lequel chacun des ruisseaux environnants semble courir.
La liberté s'est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes formes ; elle ne s'est point atta¬chée exclusivement à un état social, et on la rencontre autre part que dans les démocraties. Elle ne saurait donc former le caractère distinctif des siècles démocratiques.
Le fait particulier et dominant qui singularise ces siècles, c'est l'égalité des conditions ; la passion principale
qui agite les hommes dans ces temps-là, c'est l'amour de cette égalité.
Ne demandez point quel charme singulier trouvent les hommes des âges démocratiques à vivre égaux, ni les rai¬sons particulières qu'ils peuvent avoir de s'attacher si obs¬tinément à l'égalité plutôt qu'aux autres biens que la société leur présente : l'égalité forme le caractère distinctif de l'époque où ils vivent ; cela seul suffit pour expliquer qu'ils la préfèrent à tout le reste.
Mais, indépendamment de cette raison, il en est plu-sieurs autres qui, dans tous les temps, porteront habituel¬lement les hommes à préférer l'égalité à la liberté.
Si un peuple pouvait jamais parvenir à détruire ou seulement à diminuer lui-même dans son sein l'égalité qui y règne, il n'y arriverait que par de longs et pénibles efforts. Il faudrait qu'il modifiât son état social, abolît ses lois, renouvelât ses idées, changeât ses habitudes, altérât ses moeurs. Mais, pour perdre la liberté politique, il suffit de ne pas la retenir, et elle s'échappe.
Les hommes ne tiennent donc pas seulement à l'égalité parce qu'elle leur est chère ; ils s'y attachent encore parce qu'ils croient qu'elle doit durer toujours.
Que la liberté politique puisse, dans ses excès, compro¬mettre la tranquillité, le patrimoine, la vie des particu¬liers, on ne rencontre point d'hommes si bornés et si légers qui ne le découvrent. Il n'y a, au contraire, que les gens attentifs et clairvoyants qui aperçoivent les périls dont l'égalité nous menace, et d'ordinaire ils évitent de les signaler. Ils savent que les misères qu'ils redoutent sont éloignées, et ils se flattent qu'elles n'atteindront que les générations à venir, dont la génération présente ne s'inquiète guère. Les maux que la liberté amène quelque¬fois sont immédiats ; ils sont visibles pour tous, et tous, plus ou moins, les ressentent. Les maux que l'extrême égalité peut produire ne se manifestent que peu à peu ; ils s'insinuent graduellement dans le corps social ; on ne
les voit que de loin en loin, et, au moment où ils deviennent les plus violents, l'habitude a déjà fait qu'on ne les sent plus.
Les biens que la liberté procure ne se montrent qu'à la longue, et il est toujours facile de méconnaître la cause qui les fait naître.
Les avantages de l'égalité se font sentir dès à présent, et chaque jour on les voit découler de leur source.
La liberté politique donne de temps en temps, à un certain nombre de citoyens, de sublimes plaisirs.
L'égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l'égalité se sentent à tous moments, et ils sont à la portée de tous ; les plus nobles coeurs n'y sont pas insensibles, et les âmes les plus vulgaires en font leurs délices. La passion que l'égalité fait naître doit donc être tout à la fois énergique et générale.
Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l'acheter par quelques sacrifices, et ils ne s'en empa¬rent jamais qu'avec beaucoup d'efforts. Mais les plaisirs que l'égalité procure s'offrent d'eux-mêmes. Chacun des petits incidents de la vie privée semble les faire naître, et, pour les goûter, il ne faut que vivre.
Les peuples démocratiques aiment l'égalité dans tous les temps, mais il est de certaines époques où ils poussent jusqu'au délire la passion qu'ils ressentent pour elle. Ceci arrive au moment où l'ancienne hiérarchie sociale, long¬temps menacée, achève de se détruire, après une dernière lutte intestine, et que les barrières qui séparaient les citoyens sont enfin renversées. Les hommes se précipitent alors sur l'égalité comme sur une conquête, et ils s'y attachent comme à un bien précieux qu'on veut leur ravir. La passion d'égalité pénètre de toutes parts dans le coeur humain, elle s'y étend, elle le remplit tout entier. Ne dites point aux hommes qu'en se livrant aussi aveuglé-ment à une passion exclusive, ils compromettent leurs
intérêts les plus chers ; ils sont sourds. Ne leur montrez pas la liberté qui s'échappe de leurs mains tandis qu'ils regardent ailleurs ; ils sont aveugles, ou plutôt ils n'aper¬çoivent dans tout l'univers qu'un seul bien digne d'envie.
8. Atomisation du social et centralisation
de l'État
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, IV,
ibid., p. 385.
Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans le monde ; nos contem¬porains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souve¬nirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la ren¬ferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despo¬tisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres, ses enfants et ses amis particu¬liers forment pour lui toute l'espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux ; mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là, s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leurs jouissances et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance pater¬nelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance, il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
9. Comment tout concourt à l'égalité
Tocqueville, De la démocratie en Amérique,
Introduction, GF-Flammarion, 2012, t. I, p. 58-59.
Les rois se ruinent dans les grandes entreprises ; les nobles s'épuisent dans les guerres privées ; les roturiers s'enrichissent dans le commerce. L'influence de l'argent commence à se faire sentir sur les affaires de l'État. Le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre à la puissance, et les financiers deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et qu'on flatte.
Peu à peu, les lumières se répandent ; on voit se réveiller le goût de la littérature et des arts ; l'esprit devient alors un élément de succès ; la science est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force sociale ; les lettrés arrivent aux affaires.
À mesure cependant qu'il se découvre des routes nou-velles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au me siècle, la noblesse était d'un prix inestimable ; on l'achète au XIIIe ; le premier anoblisse¬ment a lieu en 1270, et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristocratie elle-même.
Durant les sept cents ans qui viennent de s'écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple.
Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l'État, afin d'abaisser l'aristocratie.
En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles ; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière.
BIBLIOGRAPHIE
Sur Rousseau
Ernst CASSIRER, Le Problème Jean-Jacques Rousseau, Hachette littératures, « Pluriel : philosophie «, 2006.
Robert DERATHÉ, Jean-Jacques Rousseau et la science poli¬tique de son temps, J. Vrin, « Bibliothèque d'histoire de la philosophie «, 1988.
Alexis PHILONENKO, Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, 3 vol., J. Vrin, 1984.
Jean STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle, Gallimard, « Tel «, 1976.
Sur Tocqueville
Raymond ARON, Les Étapes de la pensée sociologique, Gal
limard, « Bibliothèque des sciences humaines «, 1967. Lucien JAUME, Tocqueville : les sources aristocratiques de la
liberté, Fayard, 2008.
Robert LEGROS, L'Avènement de la démocratie, «Le Col¬lège de philosophie «, Grasset, 1999.
Pierre MANENT, Histoire intellectuelle du libéralisme : dix leçons, Hachette littératures, « Pluriel «, 1997.
EXTRAITS
1. La conception classique :
ce qui est beau est ce qui est vrai
Boileau, Satires, Préface pour l'édition de 1701,
in OEuvres poétiques, Firmin-Didot frères, 1853,
p. 30-33.
Je ne saurais attribuer un si heureux succès [de mes oeuvres] qu'au soin que j'ai pris de me conformer tou-jours à ses sentiments [du public], et d'attraper, autant qu'il m'a été possible, son goût en toutes choses. C'est effectivement à quoi il me semble que les écrivains ne sauraient trop s'étudier. Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs, s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un certain sel propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra à la fin que les connaisseurs eux-mêmes avouent qu'ils se sont trompés en lui donnant leur approbation. Que si on me demande ce que c'est que cet agrément et ce sel, je répondrai que c'est un je-ne-sais-quoi, qu'on peut beaucoup mieux sentir que dire. À mon avis néan-moins, il consiste principalement à ne jamais présenter
au lecteur que des pensées vraies et des expressions justes. L'esprit de l'homme est naturellement plein d'un nombre infini d'idées confuses du vrai, que souvent il n'entrevoit qu'à demi ; et rien ne lui est plus agréable que lorsqu'on lui offre quelqu'une de ces idées bien éclaircie et mise dans un beau jour. Qu'est-ce qu'une pensée neuve, brillante, extraordinaire ? Ce n'est point, comme se le persuadent les ignorants, une pensée que personne n'a jamais eue ni dû avoir ; c'est, au contraire, une pensée qui a dû venir à tout le monde, et que quelqu'un s'avise le premier d'exprimer. Un bon mot n'est bon mot qu'en ce qu'il dit une chose que chacun pensait, et qu'il la dit d'une manière vive, fine et nou-velle. [...]
Une pensée n'est belle qu'en ce qu'elle est vraie, et [...] l'effet infaillible du vrai, quand il est bien énoncé, c'est de frapper les hommes, il s'ensuit que ce qui ne frappe point les hommes n'est ni beau ni vrai, ou qu'il est mal énoncé, et que par conséquent un ouvrage qui n'est pas goûté du public est un très méchant ouvrage. Le gros des hommes peut bien durant quelque temps prendre le faux pour le vrai, et admirer de méchantes choses ; mais il n'est pas possible qu'à la longue une bonne chose ne lui plaise ; et je défie tous les auteurs les plus mécontents du public de me citer un bon livre que le public ait jamais rebuté, à moins qu'ils ne mettent en ce rang leurs écrits, de la bonté desquels eux seuls sont persuadés. J'avoue néanmoins, et on ne le saurait nier, que quelquefois, lorsque d'excellents ouvrages viennent à paraître, la cabale et l'envie trouvent moyen de les rabaisser et d'en rendre en appa¬rence le succès douteux ; mais cela ne dure guère, et il en arrive de ces ouvrages comme d'un morceau de bois qu'on enfonce dans l'eau avec la main : il demeure au
fond tant qu'on "y retient ; mais bientôt la main venant à se lasser, il se relève et gagne le dessus. Je pourrais dire un nombre infini de pareilles choses sur ce sujet, et ce serait la matière d'un gros livre ; mais en voilà assez, ce me semble, pour marquer au public ma reconnaissance et la haute idée que j'ai de son goût et de ses jugements.
2. L'ennuyeuse régularité du classicisme
Kant, Critique de la faculté de juger [1790],
trad. Alain Renaut, GF-Flammarion, 1995, I,
Première section, p. 221-223.
Certes, des figures géométriques régulières, un cercle, un carré, un cube, etc., sont citées communé-ment par les critiques du goût comme les plus simples et les plus indubitables exemples de la beauté ; et pour-tant on ne les nomme régulières que parce que l'on ne peut pas se les représenter autrement qu'en les considé-rant comme de simples présentations d'un concept déterminé qui prescrit à cette figure la règle (d'après laquelle seulement cette figure est possible). Aussi faut-il que l'un de ces deux jugements soit erroné : ou bien le jugement du critique, qui consiste à attribuer de la beauté à des figures qui ont ainsi été pensées, ou bien notre jugement, qui trouve une finalité sans concept nécessaire pour la beauté.
Personne n'accordera facilement qu'un homme de goût soit nécessaire pour trouver plus de satisfaction dans la forme d'un cercle que dans un tracé griffonné, dans un quadrilatère à côtés et angles égaux plutôt que dans un quadrilatère de travers aux côtés inégaux et qui est pour ainsi dire bancal ; car cela ne relève que d'un entendement commun et il n'est ici pas besoin de goût. Là où l'on perçoit un but, par exemple celui de juger et d'apprécier la grandeur d'un emplacement, ou de faire saisir, dans une division, le rapport des parties entre elles et avec le tout, alors des figures régulières, et plus précisément celles qui sont de l'espèce la plus simple, sont nécessaires ; et la satisfaction ne repose pas
immédiatement sur l'intuition de la figure, mais sur l'utilité de celle-ci pour toute sorte de projets possibles. Une pièce dont les murs forment des angles obliques, un morceau de jardin de forme semblable, et même tout manque de symétrie, aussi bien dans la configura¬tion des animaux (par exemple le fait qu'ils soient bor¬gnes) que dans celle des édifices ou des parterres de fleurs, déplaît parce que c'est contraire à la finalité, non seulement pratiquement, du point de vue d'un certain usage de ces choses, mais aussi pour leur appréciation de tous les points de vue possibles ; ce n'est pas le cas dans le jugement de goût, lequel, s'il est pur, associe immédiatement la satisfaction ou l'absence de satisfac¬tion à la simple considération de l'objet, sans avoir égard à son usage ou sa fin.
La régularité, qui conduit au concept d'un objet, est assurément la condition indispensable (conditio sine qua non) pour appréhender l'objet dans une représenta¬tion unique et déterminer le divers dans la forme de celui-ci. Cette détermination est une fin, du point de vue de la connaissance ; et, sous ce rapport même, elle est toujours liée à la satisfaction (qui accompagne la réalisation de n'importe quel projet, même simplement problématique). Mais il n'y a là, dès lors, que l'appro¬bation donnée à la solution satisfaisante d'un pro¬blème, et non pas une occupation libre, et sans fin déterminée, des facultés de l'esprit à ce que nous appe¬lons beau, et où l'entendement est au service de l'ima¬gination et non pas l'imagination au service de celui-ci.
Dans une chose, qui n'est possible que par un projet, dans un édifice, dans un animal même, la régularité qui consiste dans la symétrie doit exprimer l'unité de l'intuition qui accompagne le concept de la fin, et elle appartient à la connaissance. Mais là où il ne s'agit
que d'entretenir un libre jeu des facultés représentatives (toutefois sous la condition que l'entendement n'en souffre nulle atteinte), dans les jardins d'agrément, la décoration d'un intérieur, un quelconque ameublement choisi avec goût, etc., la régularité, qui se révèle comme une contrainte, doit être autant que possible évitée ; de là procèdent le goût anglais en matière de jardins, le goût baroque dans le domaine des meubles, qui sans doute poussent la liberté de l'imagination jusqu'à se rapprocher du grotesque, mais qui, à travers cet affran-chissement de toute contrainte appuyée sur des règles, font surgir l'occasion même en laquelle le goût peut montrer, dans les productions de l'imagination, sa plus grande perfection.
Toute régularité rigide (qui se rapproche de la régu-larité mathématique) contient en elle-même ce qui est contraire au goût : elle n'offre pas de quoi s'occuper longuement en sa contemplation, mais, à moins d'avoir expressément pour but la connaissance ou une fin pra-tique déterminée, elle ennuie. En revanche, ce avec quoi l'imagination peut jouer en faisant preuve de spontanéité et d'une manière qui est conforme à une fin est pour nous toujours nouveau et l'on ne se fatigue pas de le regarder.
3. L'empirisme et la « norme du goût «
Hume, De la norme du goût [1757],
in Essais esthétiques, trad. Renée Bouveresse,
GF-Flammarion, 2000, p. 126-127.
Il est naturel pour nous de chercher une norme du goût, une règle par laquelle les sentiments divers des hommes puissent être réconciliés, ou du moins, une proposition de décision, qui confirme un sentiment, et en condamne un autre.
Il y a une espèce de philosophie qui coupe court à tous les espoirs de succès d'une telle tentative, et nous représente l'impossibilité de jamais atteindre aucune norme du goût. La différence, y est-il dit, est très vaste entre le jugement et le sentiment. Tout sentiment est juste, parce que le sentiment ne renvoie à rien au-delà de lui-même et qu'il est toujours réel, partout où un homme en est conscient. Mais toutes les détermina-tions de l'entendement ne sont pas justes, parce qu'elles renvoient à quelque chose au-delà d'elles-mêmes, c'est-à-dire à la réalité, et qu'elles ne sont pas toujours conformes à cette norme. Parmi un millier d'opinions différentes que des hommes divers entretiennent sur le même sujet, il y en a une, et une seulement, qui est juste et vraie. Et la seule difficulté est de la déterminer et de la rendre certaine. Au contraire, un millier de sentiments différents, excités par le même objet, sont justes, parce qu'aucun sentiment ne représente ce qui est réellement dans l'objet. Il marque seulement une certaine conformité ou une relation entre l'objet et les organes ou facultés de l'esprit, et si cette conformité n'existait pas réellement, le sentiment n'aurait jamais
pu, selon toute possibilité, exister. La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. Une per¬sonne peut même percevoir de la difformité là où une autre perçoit de la beauté. Et tout individu devrait être d'accord avec son propre sentiment, sans prétendre régler ceux des autres. Chercher la beauté réelle ou la réelle laideur est une vaine enquête, comme de pré¬tendre reconnaître ce qui est réellement doux ou ce qui est réellement amer. Selon la disposition des organes, le même objet peut être à la fois doux et amer ; et le proverbe a justement déterminé qu'il est vain de discu¬ter des goûts. Il est très naturel, et tout à fait nécessaire, d'étendre cet axiome au goût mental, aussi bien qu'au goût physique. Et ainsi le sens commun, qui est si sou-vent en désaccord avec la philosophie, et spécialement avec la philosophie sceptique, se trouve, sur un exemple au moins, s'accorder avec elle pour prononcer la même décision.
4. Le morceau de cire
Descartes, Méditations métaphysiques [1641],
GF-Flammarion, 2009, Méditation seconde,
p. 101-105.
[...] je ne me puis empêcher de croire que les choses corporelles, dont les images se forment par ma pensée, et qui tombent sous les sens, ne soient plus distincte¬ment connues que cette je ne sais quelle partie de moi-même qui ne tombe point sous l'imagination : quoi¬qu'en effet ce soit une chose bien étrange, que des choses que je trouve douteuses et éloignées, soient plus clairement et plus facilement connues de moi, que celles qui sont véritables et certaines, et qui appar¬tiennent à ma propre nature. Mais je vois bien ce que c'est : mon esprit se plaît de s'égarer, et ne se peut encore contenir dans les justes bornes de la vérité. Relâ¬chons-lui donc encore une fois la bride, afin que, venant ci-après à la retirer doucement et à propos, nous le puissions plus facilement régler et conduire.
Commençons par la considération des choses les plus communes, et que nous croyons comprendre le plus distinctement, à savoir les corps que nous tou-chons et que nous voyons. Je n'entends pas parler des corps en général, car ces notions générales sont d'ordi¬naire plus confuses, mais de quelqu'un en particulier. Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche : il n'a pas encore perdu la dou¬ceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il
rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps, se rencontrent en celui-ci.
Mais voici que, cependant que je parle, on l'approche du feu : ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on toucher, et quoiqu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement ? Il faut avouer qu'elle demeure ; et personne ne le peut nier. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, ou l'odorat, ou la vue, ou l'attouchement, ou l'ouïe, se trouvent changées, et cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire n'était pas ni cette douceur du miel, ni cette agréable odeur des fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait sous ces formes, et qui main¬tenant se fait remarquer sous d'autres. Mais qu'est-ce, précisément parlant, que j'imagine, lorsque je la conçois en cette sorte ? Considérons-le attentivement, et éloignant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or qu'est-ce que cela : flexible et muable ? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde est capable de devenir carrée, et de passer du carré en une figure triangulaire ? Non certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir
cette infinité par mon imagination, et par conséquent cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce maintenant que cette extension ? N'est-elle pas aussi inconnue, puisque dans la cire qui se fond elle augmente, et se trouve encore plus grande quand elle est entièrement fondue, et beaucoup plus encore quand la chaleur augmente davantage ? Et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que c'est que la cire, si je ne pensais qu'elle est capable de recevoir plus de variétés selon l'exten-sion, que je n'en ai jamais imaginé. Il faut donc que je tombe d'accord, que je ne saurais pas même concevoir par l'imagination ce que c'est que cette cire, et qu'il n'y a que mon entendement seul qui le conçoive. Je dis ce morceau de cire en particulier, car pour la cire en géné-ral, il est encore plus évident. Or quelle est cette cire, qui ne peut être conçue que par l'entendement ou l'esprit ? Certes c'est la même que je vois, que je touche, que j'imagine, et la même que je connaissais dès le commencement. Mais ce qui est à remarquer, sa perception, ou bien l'action par laquelle on l'aperçoit, n'est point une vision, ni un attouchement, ni une ima-gination, et ne l'a jamais été, quoiqu'il le semblât ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse, comme elle était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée.
Cependant je ne me saurais trop étonner, quand je considère combien mon esprit a de faiblesse, et de pente qui le porte insensiblement dans l'erreur. Car encore que sans parler je considère tout cela en moi-même, les paroles toutefois m'arrêtent, et je suis
presque trompé par les termes du langage ordinaire ; car nous disons que nous voyons la même cire, si on nous la présente, et non pas que nous jugeons que c'est la même, de ce qu'elle a même couleur et même figure ; d'où je voudrais presque conclure, que l'on connaît la cire par la vision des yeux, et non par la seule inspec-tion de l'esprit, si par hasard je ne regardais d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire ; et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts ? Mais je juge que ce sont de vrais hommes ; et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui réside en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux.
5. « Un art en général est un recueil de
règles «
Abbé Charles Batte«, Les Beaux-Arts réduits
à un même principe [1746], in Cours de Belles
Lettres ou Principes de littérature, Paris,
H. Casterman, 1861, p. 2-9.
Un art en général est une collection ou un recueil de règles pour faire bien, ce qui peut être fait bien ou mal : car ce qui peut être fait que bien ou que mal n'a pas besoin d'art.
Ces règles ne sont que des principes généraux, tirés d'observations particulières plusieurs fois répétées, et toujours vérifiées par la répétition. Par exemple, on a observé qu'un orateur indisposait ses auditeurs, lorsque, en commençant, il montrait de l'orgueil, de l'impudence ; on en a tiré la règle générale qui veut que tout exorde soit modeste. Ainsi toute observation renferme un précepte, et tout précepte naît d'une observation. [...]
La peinture imite la belle nature par les couleurs, la sculpture par les reliefs, la danse par les mouvements et par les attitudes du corps ; la musique l'imite par les sons inarticulés, et la poésie enfin par la parole mesu¬rée. Voilà les caractères distinctifs des arts principaux.
[ ..]
Il y a ici une chose à remarquer : c'est que, de même que les arts doivent choisir les dessins de la nature et les perfectionner, ils doivent choisir aussi et perfection¬ner les expressions qu'ils empruntent de la nature. Ils ne doivent point employer toutes sortes de couleurs, ni toutes sortes de sons : il faut en faire un juste choix et
un mélange exquis ; il faut les allier, les proportionner, les nuancer, les mettre en harmonie. Les couleurs et les sons ont entre eux des sympathies et des répugnances : la nature a droit de les unir selon ses volontés, mais l'art doit le faire selon les règles. Il faut non seulement qu'il ne blesse point le goût, mais qu'il le flatte, et le flatte autant qu'il peut être flatté.
6. Le coeur contre la raison
Dominique Bouhours, La Manière de bien penser
dans les ouvrages d'esprit [1687], Paris,
Les Libraires associés, 1771,
« Premier dialogue «, p. 1-4.
Eudoxe et Philante, qui parlent dans ces Dialogues, sont deux hommes de lettres que la science n'a point gâtés, et qui n'ont guère moins de politesse que d'érudi¬tion. Quoiqu'ils aient fait les mêmes études, et qu'ils sachent à peu près les mêmes choses, le caractère de leur esprit est bien différent. Eudoxe a le goût très bon, et rien ne lui plaît dans les ouvrages ingénieux qui ne soit raisonnable et naturel. Il aime fort les Anciens, surtout les auteurs du siècle d'Auguste, qui, selon lui, est le siècle du bon sens. Cicéron, Virgile, Tite-Live, Horace, sont ses héros.
Pour Philante, tout ce qui est fleuri, tout ce qui brille, le charme. Les Grecs et les Romains ne valent pas à son gré les Espagnols et les Italiens. Il admire, entre autres, Lope de Vega et Le Tasse ; et il est si entêté de La Jérusalem délivrée qu'il la préfère sans façon à l'Iliade et à l'Énéide. À cela près, il a de l'esprit, il est honnête homme, et il est même ami d'Eudoxe. Leur amitié ne les empêche pas de se faire souvent la guerre [.. .].
Philante alla voir [Eudoxe] l'automne dernier, selon sa coutume. Il le trouva se promenant seul dans un petit bois et lisant les Doutes sur la langue française, proposés à Messieurs de l'Académie par un gentilhomme de Province 1.
1. Un ouvrage écrit par l'abbé Bouhours lui-même et publié en 1674.
Philante, qui sait plus la langue par l'usage que par les règles, fit d'abord la guerre à Eudoxe sur sa lecture.
« Que voulez-vous faire de ce Provincial ? lui dit-il. Un homme comme vous n'a qu'à suivre son génie pour bien parler et pour bien écrire. «
« Je vous assure, répondit Eudoxe, que le génie tout seul ne va pas loin, et qu'on est en danger de faire cent fautes contre l'usage si on ne fait des réflexions sur l'usage même. Les doutes du Provincial sont raison-nables, et plus je les lis, plus ils me semblent nécessaires. «
« Pour moi, dit Philante, j'aimerais mieux ses réflexions sur les pensées des auteurs ; car il est, ce me semble, encore plus nécessaire de bien penser que de bien parler ; ou plutôt on ne peut parler, ni écrire cor-rectement, à moins qu'on ne pense juste. « [...]
« En examinant les choses de près, [reprit Eudoxe], il m'a paru que les pensées qui ont quelquefois le plus d'éclat dans les compositions spirituelles, ne sont pas toujours fort solides. «
« je meurs de peur, interrompit brusquement Phi-lante, qu'à force de lire le livre des Doutes, vous n'ayez appris à douter de tout, et que ce Provincial délicat jusqu'au scrupule, ne vous ait communiqué quelque chose de son esprit. «
« Ce n'est pas sur le Provincial que je me suis réglé, repartit Eudoxe, c'est sur le bon sens qu'il prend lui-même pour la règle, dans ce qui ne dépend pas précisé-ment de l'usage : car il ne faut que consulter la raison, pour n'approuver pas certaines pensées que tout le monde presque admire. «
7. La « querelle des Bouffons «
Rousseau, Lettre sur la musique française,
Avertissement à la seconde édition (1753),
GF-Flammarion, 1993, p. 137-139.
La querelle excitée l'année dernière à l'Opéra n'ayant abouti qu'a des injures, dites d'un côté avec beaucoup d'esprit, et de l'autre avec beaucoup d'animosité, je n'y voulus prendre aucune part, car cette espèce de guerre ne me convenait en aucun sens, et je sentais bien que ce n'était pas le temps de ne dire que des raisons. Main-tenant que les Bouffons sont congédiés, ou près à l'être, et qu'il n'est plus question de cabales, je crois pouvoir hasarder mon sentiment, et je le dirai avec ma franchise ordinaire, sans craindre en cela d'offenser personne : il me semble même que, sur un pareil sujet, toute précau¬tion serait injurieuse pour les lecteurs ; car j'avoue que j'aurais fort mauvaise opinion d'un peuple qui donne¬rait à des chansons une importance ridicule, qui ferait plus de cas de ses musiciens que de ses philosophes, et chez lequel il faudrait parler de musique avec plus de circonspection que des plus graves sujets de morale.
C'est par la raison que je viens d'exposer que, quoique quelques-uns m'accusent, à ce qu'on dit, d'avoir manqué de respect à la musique française dans ma première édition, le respect beaucoup plus grand et l'estime que je dois à la nation m'empêchent de rien changer à cet égard dans celle-ci.
Une chose presque incroyable, si elle regardait tout autre que moi, c'est qu'on ose m'accuser d'avoir parlé de la langue avec mépris dans un ouvrage où il n'en peut être question que par rapport à la musique. Je n'ai
pas changé là-dessus un seul mot dans cette édition ; ainsi, en la parcourant de sens froid, le lecteur pourra voir si cette accusation est juste. Il est vrai que, quoique nous ayons eu d'excellents poètes, et même quelques musiciens qui n'étaient pas sans génie, je crois notre langue peu propre à la poésie, et point du tout à la musique. Je ne crains pas de m'en rapporter sur ce point aux poètes mêmes ; car, quant aux musiciens, chacun sait qu'on peut se dispenser de les consulter sur toute affaire de raisonnement. En revanche, la langue française me paraît celle des philosophes et des sages : elle semble faite pour être l'organe de la vérité et de la raison. Malheur à quiconque offense l'une ou l'autre dans des écrits qui la déshonorent ! Quant à moi, le plus digne hommage que je croie pouvoir rendre à cette belle et sage langue, dont j'ai le bonheur de faire usage, est de tâcher de ne la point avilir.
Quoique je ne veuille et ne doive point changer de ton avec le public, que je n'attende rien de lui, et que je me soucie tout aussi peu de ses satires que de ses éloges, je crois le respecter beaucoup plus que cette foule d'écrivains mercenaires et dangereux qui le flattent pour leur intérêt. Ce respect, il est vrai, ne consiste pas dans de vains ménagements qui marquent l'opinion qu'on a de la faiblesse de ses lecteurs, mais à rendre hommage à leur jugement, en appuyant par des raisons solides le sentiment qu'on leur propose ; et c'est ce que je me suis toujours efforcé de faire. Ainsi, de quelque sens qu'on veuille envisager les choses, en appréciant équitablement toutes les clameurs que cette lettre a excitées, j'ai bien peur qu'à la fin mon plus grand tort ne soit d'avoir raison ; car je sais trop que celui-là ne me sera jamais pardonné.
8. Rousseau et Rameau : deux théories
musicales au XVIIIe siècle
Rousseau, Examen de deux principes avancés
par Monsieur Rameau dans sa brochure intitulée
« Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie «
[1755], GF-Flammarion, 1993,
p. 193495 et 203-206.
C'est toujours avec plaisir que je vois paraître de nouveaux écrits de M. Rameau : de quelque manière qu'ils soient accueillis du public, ils sont précieux aux amateurs de l'art, et je me fais honneur d'être de ceux qui tâchent d'en profiter. Quand cet illustre artiste relève mes fautes, il m'instruit, il m'honore, je lui dois des remerciements ; et comme en renonçant aux que-relles qui peuvent troubler ma tranquillité, je ne m'interdis point celles de pur amusement, je discuterai par occasion quelques points qu'il décide, bien sûr d'avoir toujours fait une chose utile, s'il en peut résulter de sa part de nouveaux éclaircissements. C'est même entrer en cela dans les vues de ce grand musicien, qui dit qu'on ne peut contester les propositions qu'il avance que pour lui fournir les moyens de les mettre dans un plus grand jour ; d'où je conclus qu'il est bon qu'on les conteste. [...]
Je remarque dans les Erreurs sur la musique deux [...] principes importants. Le premier, qui a guidé M. Rameau dans tous ses écrits, et qui pis est dans toute sa musique, est que l'harmonie est l'unique fon¬dement de l'art, que la mélodie en dérive, et que tous les grands effets de la musique naissent de la seule harmonie.
L'autre principe, nouvellement avancé par M. Rameau, et qu'il me reproche de n'avoir pas ajouté à ma définition de l'accompagnement, est que cet accompagnement représente le corps sonore. J'examinerai séparément ces deux principes. Commençons par le premier et le plus important, dont la vérité ou la faus-seté démontrée doit servir en quelque manière de base à tout l'art musical. [...]
M. Rameau prétend que tout le charme, toute l'énergie de la musique est dans l'harmonie, que la mélodie n'y a qu'une part subordonnée et ne donne à l'oreille qu'un léger et stérile agrément. Il faut l'entendre raisonner lui-même. Ses preuves perdraient trop à être rendues par un autre que lui.
Tout choeur de musique, dit-il, qui est lent et dont la succession harmonique est bonne, plaît toujours sans le secours d'aucun dessin, ni d'une mélodie qui puisse affecter d'elle-même ; et ce plaisir est tout autre que celui qu'on éprouve ordinairement d'un chant agréable ou simplement vif et gai. (Ce parallèle d'un choeur lent et d'un air vif et gai me paraît assez plaisant.) L'un se rapporte directe¬ment à l'âme (notez bien que c'est le grand choeur à quatre parties), l'autre ne passe pas le canal de l'oreille. (C'est le chant, selon M. Rameau.) J'en appelle encore à L'Amour triomphe 1, déjà cité plus d'une fois. (Cela est vrai.) Que l'on compare le plaisir qu'on éprouve à celui que cause un air, soit vocal, soit instrumental. J'y consens. Qu'on me laisse choisir la voix et l'air sans me restreindre au seul mouvement vif et gai, car cela n'est pas juste, et que M. Rameau vienne de son côté avec son choeur L'Amour triomphe, et tout ce terrible appa¬reil d'instruments et de voix : il aura beau se choisir
1. Choeur du Pygmalion de Rameau.
des juges qu'on n'affecte qu'à force de bruit, et qui sont plus touchés d'un tambour que du rossignol, ils seront hommes enfin. Je n'en veux pas davantage pour leur faire sentir que les sons les plus capables d'affecter l'âme ne sont point ceux d'un choeur de musique.
L'harmonie est une cause purement physique ; l'impression qu'elle produit reste dans le même ordre ; des accords ne peuvent qu'imprimer aux nerfs un ébranlement passager et stérile ; ils donneraient plutôt des vapeurs que des passions. [...]
Les plus beaux accords, ainsi que les plus belles cou-leurs, peuvent porter aux sens une impression agréable et rien de plus. Mais les accents de la voix passent jus-qu'à l'âme, car ils sont l'expression naturelle des pas-sions et, en les peignant, ils les excitent. C'est par eux que la musique devient oratoire, éloquente, imitative, ils en forment le langage ; c'est par eux qu'elle peint à l'imagination les objets, qu'elle porte au coeur les senti-ments. La mélodie est dans la musique ce qu'est le dessin dans la peinture, l'harmonie n'y fait que l'effet des couleurs. C'est par le chant, non par les accords, que les sons ont de l'expression, du feu, de la vie ; c'est le chant seul qui leur donne les effets moraux qui font toute l'énergie de la musique. En un mot, le seul phy-sique de l'art se réduit à bien peu de chose, et l'harmo-nie ne passe pas au-delà. [...]
Le second principe avancé par M. Rameau, et duquel il me reste à parler, est que l'harmonie représente le corps sonore. [...]
L'harmonie représente le corps sonore ! Ce mot de corps sonore a un certain éclat scientifique, il annonce un physicien dans celui qui l'emploie : mais en musique que signifie-t-il ? Le musicien ne considère pas le corps sonore en lui-même, il ne le considère qu'en action.
Or, qu'est-ce que le corps sonore en action ? C'est le son : l'harmonie représente donc le son. Mais l'harmo¬nie accompagne le son. Le son n'a donc pas besoin qu'on le représente, puisqu'il est là. Si ce galimatias paraît risible, ce n'est pas ma faute assurément.
«
76 1 ROUSSEAU ET TOCQUEVILLE
évident, par la lecture des Livres Sacrés, que le premier
homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières
et des préceptes, n'était
point lui-même dans cet état, et
qu'en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit
tout philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le
déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur
état de nature, à moins qu'ils n'y soient retombés par
quelque événement extraordinaire.
Paradoxe fort embar
rassant à défendre, et
tout à fait impossible à prouver.
Commençons donc par écarter tous
les faits, car ils ne
touchent
point à la question.
Il ne faut pas prendre les
recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet,
pour des vérités historiques, mais seulement pour des rai
sonnements hypothétiques et conditionnels ; plus
propres à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer
la véritable origine, et semblables à ceux que font tous
les jours nos physiciens sur la formation du monde.
La
religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même
ayant tiré
les hommes de l'état de nature, immédiatement
après la création,
ils sont inégaux parce qu'il a voulu
qu'ils
le fussent ; mais elle ne nous défend pas de former
des conjectures tirées de la seule nature de
l'homme et
des êtres qui l'environnent, sur
ce qu'aurait pu devenir le
genre humain, s'il fût resté abandonné à lui-même.
Voilà
ce qu'on me demande, et ce que je me propose d' exami
ner dans
ce Discours.
Mon sujet intéressant l'homme en
général, je tâcherai de prendre
un langage qui convienne
à toutes
les nations, ou plutôt, oubliant les temps et les
lieux, pour ne songer qu'aux hommes à qui je parle, je
me supposerai dans
le lycée d'Athènes, répétant les leçons
de mes maîtres, ayant
les Platon et les Xénocrate pour
juges, et le genre humain pour auditeur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- philo art Pascal: “Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par l’imitation des choses dont on admire point les originaux”
- COURS EC1 PREPA PHILO (art société conscient inconscient)
- PHILO ART
- cours philo sur l'art
- Delluc et l'art du cinéma - anthologie du cinéma.