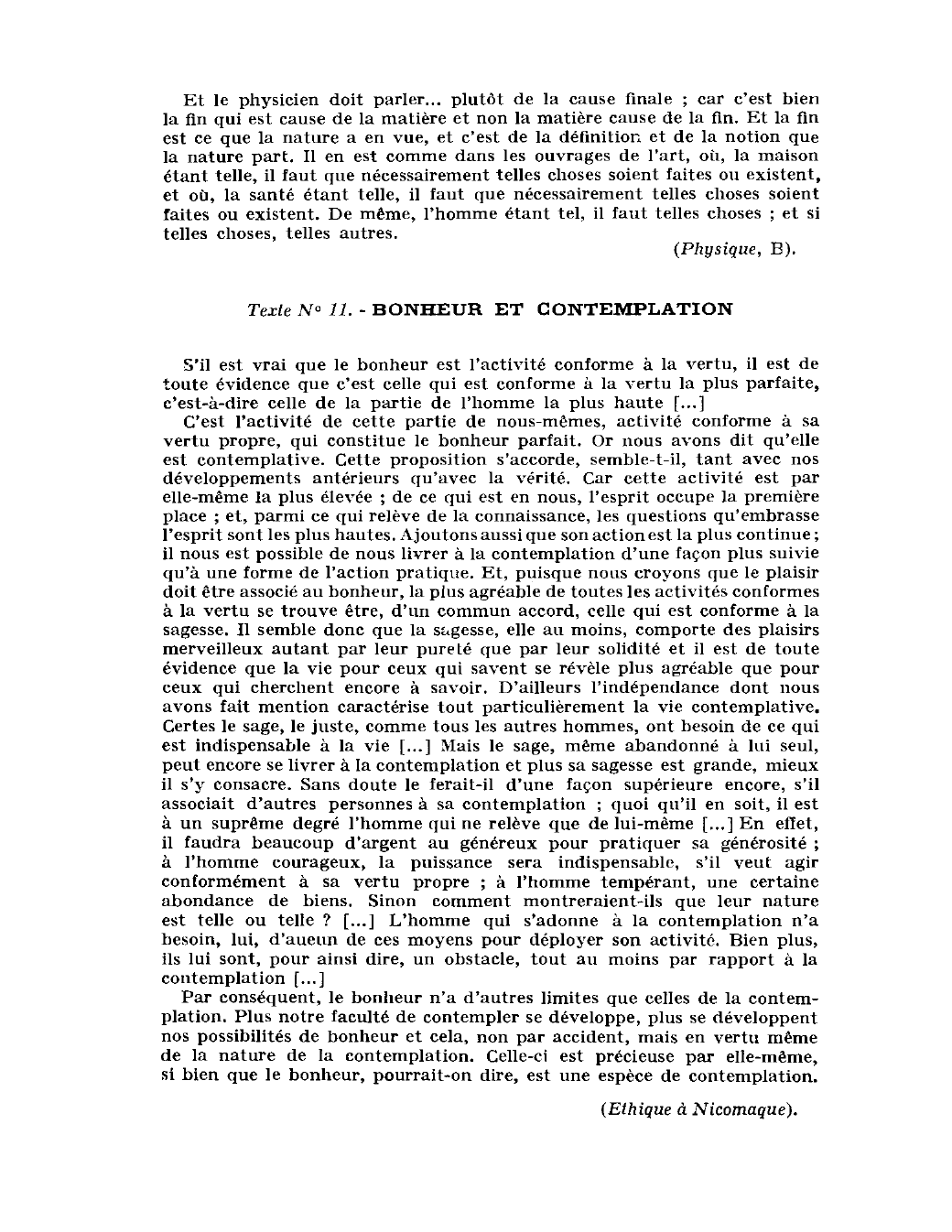ARISTOTE - LA PHILOSOPHIE
Publié le 17/06/2012

Extrait du document

De tout ce que nous venons de dire sur la science elle-même, sort la définition cherchée de la philosophie. Il faut bien qu'elle soit la science théorétique des premiers principes et des premières causes [ ... ]. Ce qui, dans l'origine, poussa les hommes aux premières recherches philosophiques, c'était, comme aujourd'hui, l'étonnement. Entre les objets qui les étonnaient, et dont ils ne pouvaient sè rendre compte, ils s'appliquèrent d'abord à ceux qui étaient à leur portée ; puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à s'expliquer de plus grands phénomènes, par exemple les divers états de la lune, le cours du soleil et des astres, enfin la formation de l'univers [ ... ]. Par conséquent, si les premiers philosophes philosophèrent pour échapper à l'ignorance, il est évident qu'ils poursuivaient la science pour savoir, et non en vue de quelque '!tilité. Le fait lui-même en est la preuve : presque tous les arts qui regardent les besoins et ceux qui s'appliquent au bien-être et au plaisir étaient connus déjà, quand on commença à chercher les explications de ce genre. Il est donc évident que nous n'étudions pas la philosophie pour aucun autre intérêt étranger.

«
Et Je physicien doit parler ...
plutôt de la cause finale ; car c'est bien la fin qui est cause de la matière et non la matière cause de la fin.
Et la fin est ce que la nature a en vue, et c'est de la définition et de la notion que la nature part.
Il en est comme dans les ouvrages de l'art, oü, la maison étant telle, il faut que nécessairement telles choses soient faites ou existent, et où, la santé étant telle, il faut que nécessairement telles choses soient faites ou existent.
De même, l'homme étant tel, il faut telles choses ; et si telles choses, telles autres.
(Physique, B).
Texte No 11.- BONHEUR ET CONTEMPLATION
S'il est vrai que le bonheur est l'activité conforme à la vertu, il est de toute évidence que c'est celle qui est conforme à la yertu la plus parfaite, c'est-à-dire celle de la partie de l'homme la plus haute [ ...
] C'est l'activité de cette partie de nous-mêmes, activité conforme à sa vertu propre, qui constitue le bonheur parfait.
Or nous avons dit qu'elle est contemplative.
Cette proposition s'accorde, semble-t-il, tant avec nos développements antérieurs qu'avec la vérité.
Car cette activité est par elle-même la plus élevée ; de ce qui est en nous, l'esprit occupe la première place ; et, parmi ce qui relève de la connaissance, les questions qu'embrasse l'esprit sont les plus hautes.
Ajoutons aussi que son action est la plus continue; il nous est possible de nous livrer à la contemplation d'une façon plus suivie qu'à une forme de l'action pratique.
Et, puisque nous croyons que le plaisir doit être associé au bonheur, la plus agréable de toutes les activités conformes à la vertu se trouve être, d'un commun accord, celle qui est conforme à la sagesse.
Il semble donc que la sttgesse, elle au moins, comporte des plaisirs merveilleux autant par leur pure té que par leur solidité et il est de toute évidence que la vie pour ceux qui savent se révèle plus agréable que pour ceux qui cherchent encore à savoir.
D'ailleurs l'indépendance dont nous avons fait mention caractérise tout particulièrement la vie contemplative, Certes le sage, le juste, comme tous les autres hommes, ont besoin de ce qui est indispensable à la vie [ ...
] Mais le sage, même abandonné à lui seul, peut encore se livrer à la contemplation et plus sa sagesse est grande, mieux il s'y consacre.
Sans doute le ferait-il d'une façon supérieure encore, s'il associait d'autres personnes à sa contemplation ; quoi qu'il en soit, il est à un suprême degré l'homme qui ne relève que de lui-mème [ ...
]En effet, il faudra beaucoup d'argent au généreux pour pratiquer sa générosité ; à l'homme courageux, la puissance sera indispensable, s'il veut agir conformément à sa vertu propre ; à l'homme tempérant, une certaine abondance de biens.
Sinon comment montreraient-ils que leur nature est telle ou telle ? [ ...
] L'homme qui s'adonne à la contemplation n'a besoin, lui, d'aueLm de ces moyens pour déployer son activité.
Bien plus, ils lui sont, pour ainsi dire, un obstacle, tout au moins par rapport à la contemplation [ ...
] Par conséquent, le bonheur n'a d'autres limites que celles de la contem plation.
Plus notre faculté de contempler se développe, plus se développent nos possibilités de bonheur et cela, non par accident, mais en vertu même de la nature de la contemplation.
Celle-ci est précieuse par elle-même, si bien que le bonheur, pourrait-on dire, est une espèce de contemplation.
(Ethique à Nicomaque)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte : L'origine de la philosophie (Aristote)
- Aristote - philosophie.
- Aristote, Histoire des animaux (extrait) Médecine exceptée, l'histoire de la biologie trouve ses racines dans l'oeuvre d'Aristote relative à la philosophie des êtres vivants.
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.