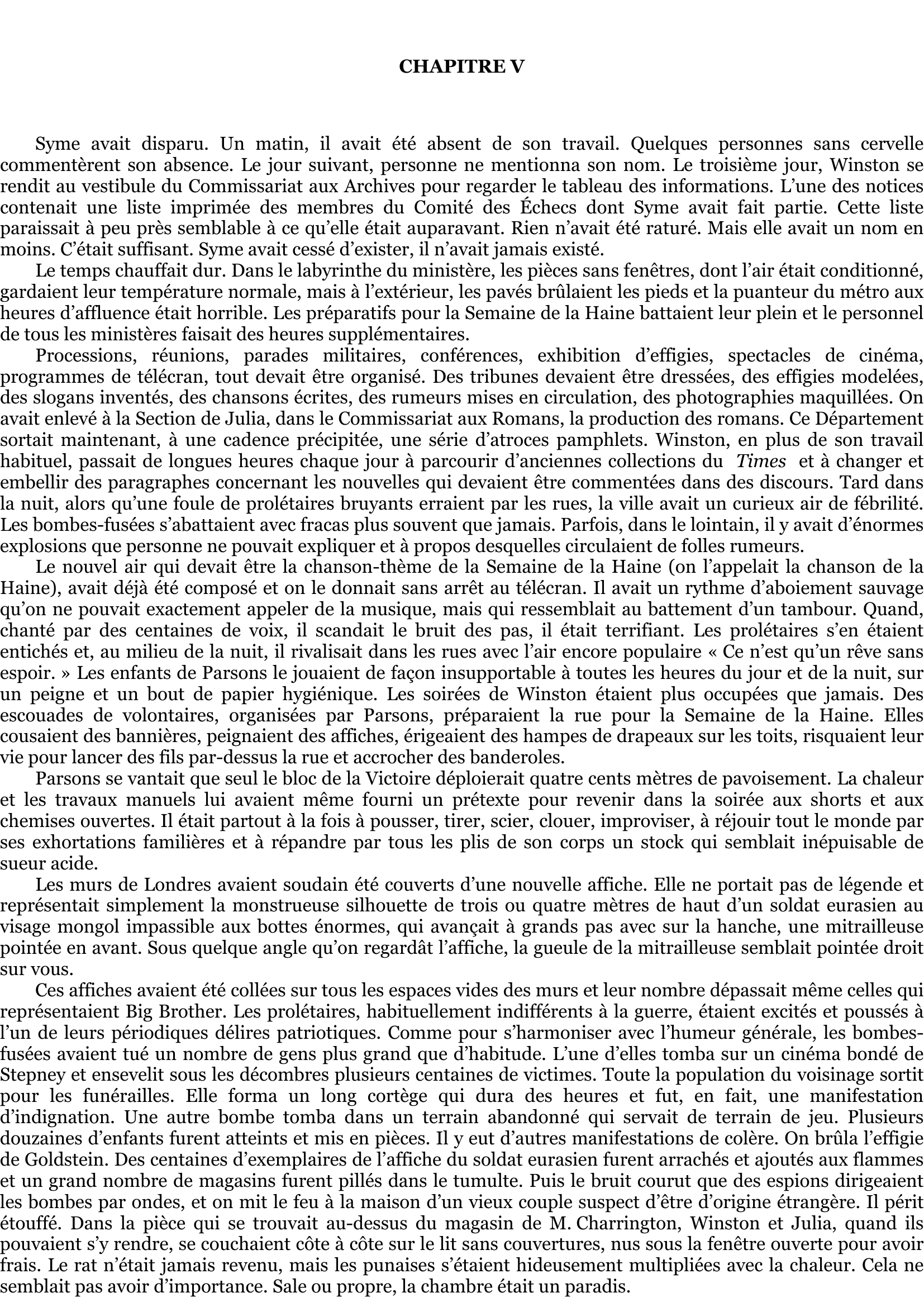debout devant un mur d'ombre, et de l'autre côté de ce mur, il y avait quelque chose d'intolérable, quelque chose de trop horrible pour être affronté.
Publié le 31/10/2013

Extrait du document
«
CHAPITRE
VSyme
avaitdisparu.
Unmatin, ilavait étéabsent deson travail.
Quelques personnes sanscervelle
commentèrent sonabsence.
Lejour suivant, personne nementionna sonnom.
Letroisième jour,Winston se
rendit auvestibule duCommissariat auxArchives pourregarder letableau desinformations.
L’unedesnotices
contenait uneliste imprimée desmembres duComité desÉchecs dontSyme avaitfaitpartie.
Cetteliste
paraissait àpeu près semblable àce qu’elle étaitauparavant.
Rienn’avait étératuré.
Maiselleavait unnom en
moins.
C’étaitsuffisant.
Symeavaitcessé d’exister, iln’avait jamaisexisté.
Le temps chauffait dur.Dans lelabyrinthe duministère, lespièces sansfenêtres, dontl’airétait conditionné,
gardaient leurtempérature normale,maisàl’extérieur, lespavés brûlaient lespieds etlapuanteur dumétro aux
heures d’affluence étaithorrible.
Lespréparatifs pourlaSemaine delaHaine battaient leurplein etlepersonnel
de tous lesministères faisaitdesheures supplémentaires.
Processions, réunions,paradesmilitaires, conférences, exhibitiond’effigies,spectacles decinéma,
programmes detélécran, toutdevait êtreorganisé.
Destribunes devaient êtredressées, deseffigies modelées,
des slogans inventés, deschansons écrites,desrumeurs misesencirculation, desphotographies maquillées.On
avait enlevé àla Section deJulia, dansleCommissariat auxRomans, laproduction desromans.
CeDépartement
sortait maintenant, àune cadence précipitée, unesérie d’atroces pamphlets.
Winston,enplus deson travail
habituel, passaitdelongues heureschaque jouràparcourir d’anciennes collectionsdu Times et
àchanger et
embellir desparagraphes concernantlesnouvelles quidevaient êtrecommentées dansdesdiscours.
Tarddans
la nuit, alors qu’une fouledeprolétaires bruyantserraientparlesrues, laville avait uncurieux airdefébrilité.
Les bombes-fusées s’abattaientavecfracas plussouvent quejamais.
Parfois, danslelointain, ilyavait d’énormes
explosions quepersonne nepouvait expliquer etàpropos desquelles circulaient defolles rumeurs.
Le nouvel airqui devait êtrelachanson-thème delaSemaine delaHaine (onl’appelait lachanson dela
Haine), avaitdéjàétécomposé eton ledonnait sansarrêt autélécran.
Ilavait unrythme d’aboiement sauvage
qu’on nepouvait exactement appelerdelamusique, maisquiressemblait aubattement d’untambour.
Quand,
chanté pardes centaines devoix, ilscandait lebruit despas, ilétait terrifiant.
Lesprolétaires s’enétaient
entichés et,aumilieu delanuit, ilrivalisait danslesrues avec l’airencore populaire « Cen’est qu’un rêvesans
espoir. » Lesenfants deParsons lejouaient defaçon insupportable àtoutes lesheures dujour etde lanuit, sur
un peigne etun bout depapier hygiénique.
Lessoirées deWinston étaientplusoccupées quejamais.
Des
escouades devolontaires, organiséesparParsons, préparaient larue pour laSemaine delaHaine.
Elles
cousaient desbannières, peignaient desaffiches, érigeaient deshampes dedrapeaux surlestoits, risquaient leur
vie pour lancer desfilspar-dessus larue etaccrocher desbanderoles.
Parsons sevantait queseul lebloc delaVictoire déploierait quatrecentsmètres depavoisement.
Lachaleur
et les travaux manuels luiavaient mêmefourni unprétexte pourrevenir danslasoirée auxshorts etaux
chemises ouvertes.Ilétait partout àla fois àpousser, tirer,scier, clouer, improviser, àréjouir toutlemonde par
ses exhortations familièresetàrépandre partous lesplis deson corps unstock quisemblait inépuisable de
sueur acide.
Les murs deLondres avaientsoudain étécouverts d’unenouvelle affiche.Elleneportait pasdelégende et
représentait simplementlamonstrueuse silhouettedetrois ouquatre mètres dehaut d’unsoldat eurasien au
visage mongol impassible auxbottes énormes, quiavançait àgrands pasavec surlahanche, unemitrailleuse
pointée enavant.
Sousquelque anglequ’on regardât l’affiche, lagueule delamitrailleuse semblaitpointéedroit
sur vous.
Ces affiches avaientétécollées surtous lesespaces videsdesmurs etleur nombre dépassait mêmecellesqui
représentaient BigBrother.
Lesprolétaires, habituellement indifférentsàla guerre, étaientexcitésetpoussés à
l’un deleurs périodiques délirespatriotiques.
Commepours’harmoniser avecl’humeur générale, lesbombes-
fusées avaient tuéunnombre degens plusgrand qued’habitude.
L’uned’elles tomba suruncinéma bondéde
Stepney etensevelit souslesdécombres plusieurscentaines devictimes.
Toutelapopulation duvoisinage sortit
pour lesfunérailles.
Elleforma unlong cortège quidura desheures etfut, enfait, unemanifestation
d’indignation.
Uneautre bombe tombadansunterrain abandonné quiservait deterrain dejeu.
Plusieurs
douzaines d’enfantsfurentatteints etmis enpièces.
Ilyeut d’autres manifestations decolère.
Onbrûla l’effigie
de Goldstein.
Descentaines d’exemplaires del’affiche dusoldat eurasien furentarrachés etajoutés auxflammes
et un grand nombre demagasins furentpillésdansletumulte.
Puislebruit courut quedesespions dirigeaient
les bombes parondes, eton mit lefeu àla maison d’unvieux couple suspect d’êtred’origine étrangère.
Ilpérit
étouffé.
Danslapièce quisetrouvait au-dessus dumagasin deM. Charrington, WinstonetJulia, quand ils
pouvaient s’yrendre, secouchaient côteàcôte surlelit sans couvertures, nussous lafenêtre ouverte pouravoir
frais.
Lerat n’était jamais revenu, maislespunaises s’étaienthideusement multipliéesaveclachaleur.
Celane
semblait pasavoir d’importance.
Saleoupropre, lachambre étaitunparadis..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Une seule chose lui causait de l'humeur : deux amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Émile Zola, Germinal, ABU, la Bibliothèque universelle
- « Le maître, qui o interposé l'esclave entre la chose et lui, se relie ainsi seulement à la dépendance de la chose, et purement en jouit. Il abandonne le côté de l'indépendance de la chose à l'esclave, qui l'élabore. » Hegel, La Phénoménologie de l'Esprit, 1807. Commentez cette citation.
- L'ombre de l'inceste plane sur l'intrigue. Selon vous, Phèdre est-elle coupable ?
- Comme Jean Valjean, il vous est arrivé un jour, d’être tenté de faire quelque chose de répréhensible. Racontez ce moment et votre décision finale, en insistant sur les sentiments contradictoires que vous avez éprouvés.
- Anne de noailles: « Être dans la nature ainsi qu’un arbre humain, / Étendre ses désirs comme un profond feuillage » ,« Être le jour qui monte et l’ombre qui descend »