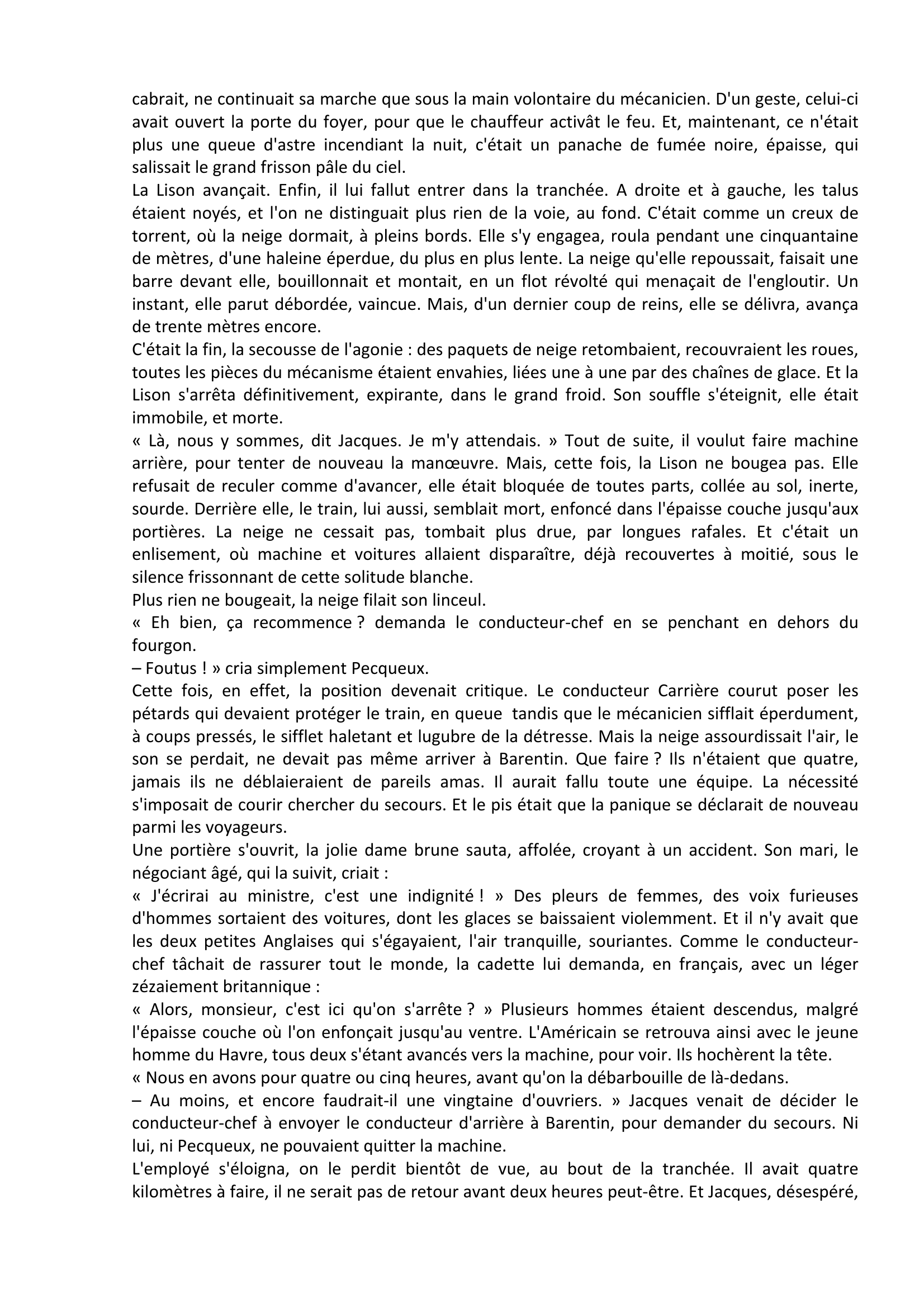du premier wagon, où elle se mettait toujours pour être plus près de lui, il l'avait suppliée du regard et, comprenant, elle s'était retirée, pour ne pas rester à ce vent glacial qui lui brûlait la figure.
Publié le 29/10/2013

Extrait du document
«
cabrait,
necontinuait samarche quesous lamain volontaire dumécanicien.
D'ungeste, celui-ci
avait ouvert laporte dufoyer, pourquelechauffeur activâtlefeu.
Et,maintenant, cen'était
plus unequeue d'astre incendiant lanuit, c'était unpanache defumée noire,épaisse, qui
salissait legrand frisson pâleduciel.
La Lison avançait.
Enfin,illui fallut entrer danslatranchée.
Adroite etàgauche, lestalus
étaient noyés,etl'on nedistinguait plusriendelavoie, aufond.
C'était comme uncreux de
torrent, oùlaneige dormait, àpleins bords.
Elles'yengagea, roulapendant unecinquantaine
de mètres, d'unehaleine éperdue, duplus enplus lente.
Laneige qu'elle repoussait, faisaitune
barre devant elle,bouillonnait etmontait, enun flot révolté quimenaçait del'engloutir.
Un
instant, elleparut débordée, vaincue.Mais,d'undernier coupdereins, ellesedélivra, avança
de trente mètres encore.
C'était lafin, lasecousse del'agonie : despaquets deneige retombaient, recouvraientlesroues,
toutes lespièces dumécanisme étaientenvahies, liéesuneàune pardes chaînes deglace.
Etla
Lison s'arrêta définitivement, expirante,danslegrand froid.Sonsouffle s'éteignit, elleétait
immobile, etmorte.
« Là, nous ysommes, ditJacques.
Jem'y attendais.
»Tout desuite, ilvoulut fairemachine
arrière, pourtenter denouveau lamanœuvre.
Mais,cettefois,laLison nebougea pas.Elle
refusait dereculer comme d'avancer, elleétait bloquée detoutes parts,collée ausol, inerte,
sourde.
Derrière elle,letrain, luiaussi, semblait mort,enfoncé dansl'épaisse couchejusqu'aux
portières.
Laneige necessait pas,tombait plusdrue, parlongues rafales.Etc'était un
enlisement, oùmachine etvoitures allaientdisparaître, déjàrecouvertes àmoitié, sousle
silence frissonnant decette solitude blanche.
Plus riennebougeait, laneige filaitsonlinceul.
« Eh bien, çarecommence ? demandaleconducteur-chef ensepenchant endehors du
fourgon.
– Foutus ! »cria simplement Pecqueux.
Cette fois,eneffet, laposition devenait critique.Leconducteur Carrièrecourutposerles
pétards quidevaient protéger letrain, enqueue tandisquelemécanicien sifflaitéperdument,
à coups pressés, lesifflet haletant etlugubre deladétresse.
Maislaneige assourdissait l'air,le
son seperdait, nedevait pasmême arriver àBarentin.
Quefaire ? Ilsn'étaient quequatre,
jamais ilsne déblaieraient depareils amas.Ilaurait fallutoute uneéquipe.
Lanécessité
s'imposait decourir chercher dusecours.
Etlepis était quelapanique sedéclarait denouveau
parmi lesvoyageurs.
Une portière s'ouvrit,lajolie dame brune sauta, affolée, croyantàun accident.
Sonmari, le
négociant âgé,quilasuivit, criait :
« J'écrirai auministre, c'estuneindignité ! »Des pleurs defemmes, desvoix furieuses
d'hommes sortaientdesvoitures, dontlesglaces sebaissaient violemment.
Etiln'y avait que
les deux petites Anglaises quis'égayaient, l'airtranquille, souriantes.
Commeleconducteur-
chef tâchait derassurer toutlemonde, lacadette luidemanda, enfrançais, avecunléger
zézaiement britannique :
« Alors, monsieur, c'esticiqu'on s'arrête ? »Plusieurs hommesétaientdescendus, malgré
l'épaisse coucheoùl'on enfonçait jusqu'auventre.L'Américain seretrouva ainsiaveclejeune
homme duHavre, tousdeux s'étant avancés verslamachine, pourvoir.Ilshochèrent latête.
« Nous enavons pourquatre oucinq heures, avantqu'on ladébarbouille delà-dedans.
– Au moins, etencore faudrait-il unevingtaine d'ouvriers.
»Jacques venaitdedécider le
conducteur-chef àenvoyer leconducteur d'arrièreàBarentin, pourdemander dusecours.
Ni
lui, niPecqueux, nepouvaient quitterlamachine.
L'employé s'éloigna,onleperdit bientôt devue, aubout delatranchée.
Ilavait quatre
kilomètres àfaire, ilne serait pasderetour avantdeuxheures peut-être.
EtJacques, désespéré,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chenrésig, le patron tutélaire du Tibet " Celui qui regarde avec les yeux clairs ", ou " Celui qui entend les prières du monde, ou encore " Le seigneur qui baisse son regard sur les souffrances du monde ", est sans conteste une figure de proue de la tradition tibétaine.
- Explication linéaire n°9 Madame Bovary: Dans quelle mesure cette rencontre amoureuse, bien que classique, est-elle magnifiée par le regard du héros ?
- Ce qui doit longtemps nous rester cher doit être rare
- Peut-on encore porter un regard sublime sur la nature ?
- Etude de la figure du Cyclope dans l'Odyssée