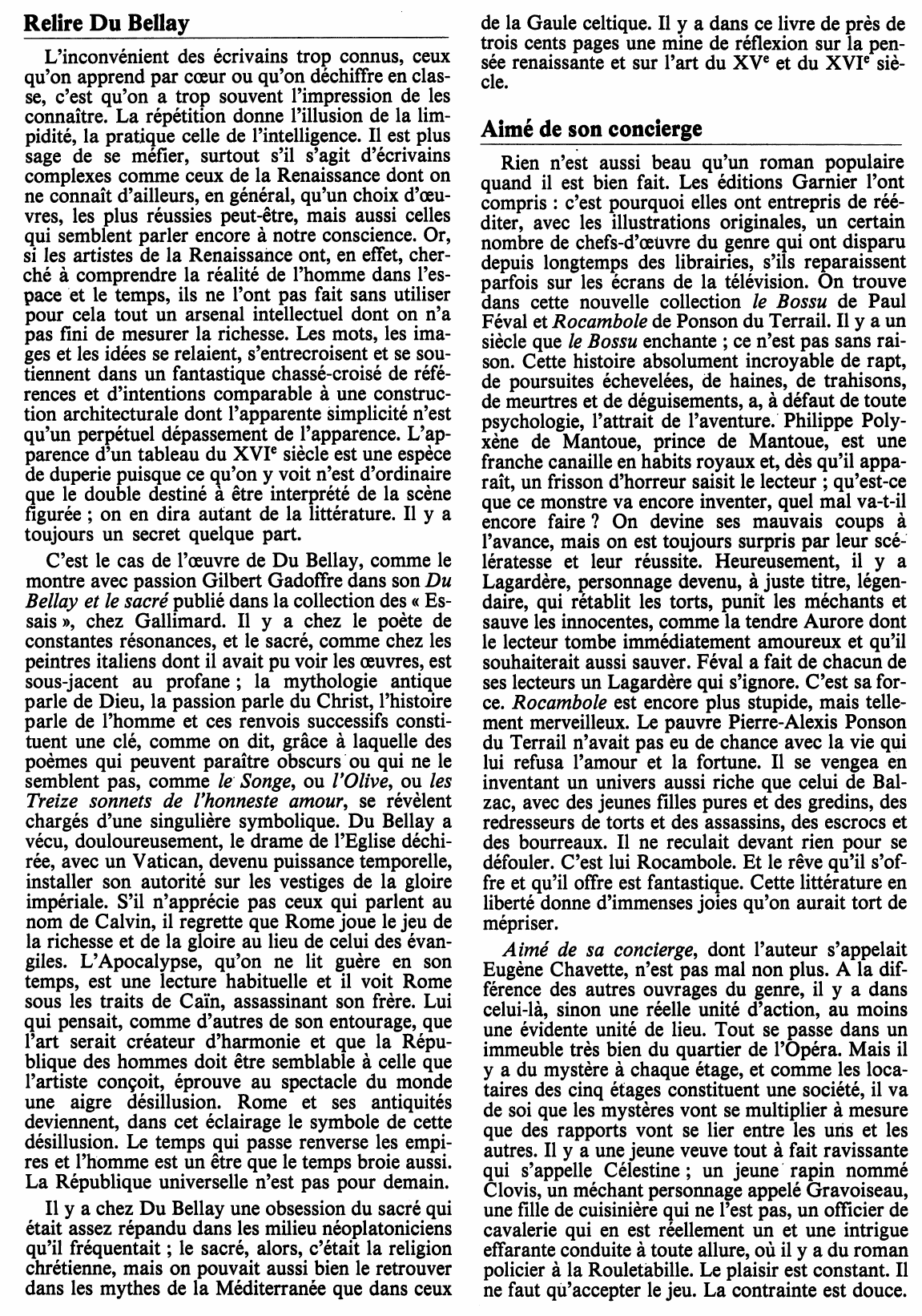La faute à Voltaire
Publié le 14/12/2011

Extrait du document

Voltaire, Rousseau, tout est de leur faute,
comme on sait. Ils ont deux cents ans tous les deux,
et on les lit toujours tous les deux. Ils sont morts la
même année, en 1778, à quelques semaines de distance
; Rousseau avait soixante-six ans et son compère
détesté, Voltaire, était plus qu'octogénaire.
L'année les rapproche comme la vie les sépara. La
Pléiade, la collection « Folio «, les éditions Garnier
leur consacrent des études érudites, comme celle de
Jean Orieux sur l'auteur de Candide, comme celle
de Jean Roussel sur l'auteur des C01J[essions. On a
oublié les querelles des deux frères ennemis qui ne
sont plus qu'argumentations universitaires ; les
deux ermites ne nous concernent plus guère quand
ils s'envoient, par personnes interposées, quelques
méchancetés qui font le plus grand plaisir au châtelain
de Ferney et la plus grande peine au pensionnaire
d'Ermenonville. Mais, n'importe ! Le principal
est qu'ils aient eu des mots : cela fait une littérature.
Et que serait la littérature française sans ces
deux hommes ? Elle aurait un trou.

«
Relire Du Bellay
L'inconvénient des écrivains trop connus, ceux
qu'on apprend par cœur ou qu'on déchiffre en clas
se, c'est qu'on a trop souvent l'impression de les
connaître.
La répétition donne l'illusion de la lim
pidité, la pratique celle de l'intelligence.
Il est plus
sage de se méfier, surtout s'il s'agit d'écrivains
complexes comme ceux
de la Renaissance dont on
ne connaît d'ailleurs, en général, qu'un choix d'œu
vres, les plus réussies peut-être, mais aussi celles
qui semblent parler encore à notre conscience.
Or, si les artistes de la Renaissance ont, en effet, cher
ché à comprendre la réalité de l'homme dans l'es
pace et le temps, ils ne l'ont pas fait sans utiliser
pour cela tout un arsenal intellectuel dont on
n'a pas fini de mesurer la richesse.
Les mots, les ima
ges et les idées se relaient, s'entrecroisent et se sou
tiennent dans un fantastique chassé-croisé de réfé
rences et d'intentions comparable à une construc
tion architecturale dont l'apparente simplicité n'est
qu'un perpétuel dépassement de l'apparence.
L'ap
parence d'un tableau du
XVI• siècle est une espèce de duperie puisque ce 'lu' on y voit n'est d'ordinaire
que le double destiné a être interprété de la scène
figurée ; on en dira autant de la littérature.
Il y a
toujours un secret quelque part.
C'est le cas
de l'œuvre de Du Bellay, comme le montre avec passion Gilbert Gadoffre dans son Du Bellay et le sacré publié dans la collection des « Es
sais », chez Gallimard.
Il y a chez le poète de constantes résonances, et le sacré, comme chez les peintres italiens dont il avait pu voir les œuvres, est
sous-jacent au profane ; la mythologie antique
parle de Dieu, la passion parle du Christ, l'histoire
parle de l'homme et ces renvois successifs consti
tuent une clé, comme on dit, grâce à laquelle des
poèmes qui peuvent paraître obscurs· ou qui
ne le semblent pas, comme le Songe, ou l'Olive, ou les
Treize sonnets de l'honneste amour, se révèlent
chargés d'une singulière symbolique.
Du Bellay a
vécu, douloureusement, le drame de l'Eglise déchi
rée, avec un Vatican, devenu puissance temporelle,
installer son autorité sur les vestiges de
la gloire
impériale.
S'il n'apprécie pas ceux qui parlent au
nom de Calvin, il regrette que Rome joue le jeu de la richesse et de la gloire au lieu de celui des évan
giles.
L'Apocalypse, qu'on ne lit guère en son
temps, est une lecture habituelle et
il voit Rome
sous les traits de Caïn, assassinant son frère.
Lui
qui pensait, comme d'autres de son entourage, que
l'art serait créateur d'harmonie et que
la Répu
blique des hommes doit être semblable à celle que
l'artiste conçoit, éprouve au spectacle du monde
une aigre désillusion.
Rome et ses antiquités
deviennent, dans cet éclairage le symbole
de cette
désillusion.
Le temps qui passe renverse les empi
res et l'homme est un être que le temps broie aussi.
La République universelle n'est pas pour demain.
Il y a chez
Du Bellay une obsession du sacré qui
était assez répandu dans les milieu néoplatoniciens
qu'il fréquentait ; le sacré, alors, c'était la religion
chrétienne, mais on pouvait aussi bien le retrouver
dans les mythes de
la Méditerranée que dans ceux
de la Gaule celtique.
Il y a dans ce livre de près de
trois cents pages une mine de réflexion sur la pen sée renaissante et sur l'art du xv• et du XVI• siè
cle.
Aimé de son concierge
Rien n'est aussi beau qu'un roman populaire
quand il est bien fait.
Les éditions Garnier l'ont
compris : c'est pourquoi elles ont entrepris de réé
diter, avec
les illustrations originales, un certain
nombre de chefs-d'œuvre du genre qui ont disparu
depuis longtemps des librairies, s'ils reparaissent
parfois sur
les écrans de la télévision.
On trouve
dans cette nouvelle collection le Bossu de Paul Féval et Rocambole de Ponson du Terrail.
Il y a un
siècle que le Bossu enchante ; ce n'est pas sans rai
son.
Cette histoire absolument incroyable de rapt,
de poursuites échevelées, de haines, de trahisons, de meurtres et de déguisements, a, à défaut de toute
psychologie, l'attrait de l'aventure.
Philippe Poly xène de Mantoue, prince de Mantoue, est une
franche canaille en habits royaux et, dès qu'il appa
raît, un frisson d'horreur saisit le lecteur ; qu'est-ce
que ce monstre va encore inventer, quel mal va-t-il
encore faire
? On devine ses mauvais coups à
l'avance, mais on est toujours surpris par leur scé~ lératesse et leur réussite.
Heureusement, il y a
Lagardère, ~rsonnage devenu, à juste titre, légen
daire, qui retablit les torts, punit les méchants et
sauve
les innocentes, comme la tendre Aurore dont le lecteur tombe immédiatement amoureux et qu'il
souhaiterait aussi sauver.
Féval a fait de chacun de ses lecteurs un Lagardère qui s'ignore.
C'est sa for ce.
Rocambole est encore plus stupide, mais telle
ment merveilleux.
Le pauvre Pierre-Alexis Ponson
du Terrail n'avait pas eu de chance avec
la vie qui lui refusa l'amour et la fortune.
Il se vengea en
inventant un univers aussi riche que celui de Bal
zac, avec des jeunes filles pures et des gredins, des
redresseurs de torts et des assassins, des escrocs et
des bourreaux.
Il ne reculait devant rien pour se défouler.
C'est lui Rocambole.
Et le rêve qu'il s'of fre et qu'il offre est fantastique.
Cette littérature en
liberté donne d'immenses joies qu'on aurait tort de
mépriser.
Aimé de sa concierge, dont l'auteur s'appelait
Eugène Chavette, n'est pas mal non plus.
A la dif
férence des autres ouvrages du genre, il y a dans
celui-là, sinon une réelle unité d'action, au moins
une évidente unité de lieu.
Tout se passe dans un
immeuble très bien du quartier de l'Opéra.
Mais
il y a du mystère à chaque étage, et comme les loca
taires des cinq étages constituent une société, il va de soi que les mystères vont se multiplier à mesure
que des rapports vont se lier entre les uris et les
autres.
Il y a une jeune veuve tout à fait ravissante
qui s'appelle Célestine ; un jeune· rapin nommé
Clovis, un méchant personnage appelé Gravoiseau,
une fille
de cuisinière qui ne l'est pas, un officier de
cavalerie qui en est réellement un et une intrigue
effarante conduite à toute allure, où il y a du roman
policier à la Rouletabille.
Le plaisir est constant.
Il
ne faut qu'accepter le jeu.
La contrainte est douce..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Lire un conte philosophiqueCandide de Voltaire »
- RESPONSABILITÉ - FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE - CRITÈRE T. C. 14 janv. 1935, THEPAZ, Rec. 224
- Amour dans Candide de Voltaire
- Projet Voltaire
- Nègre de Surinam - de Candide ou l’optimiste, un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759