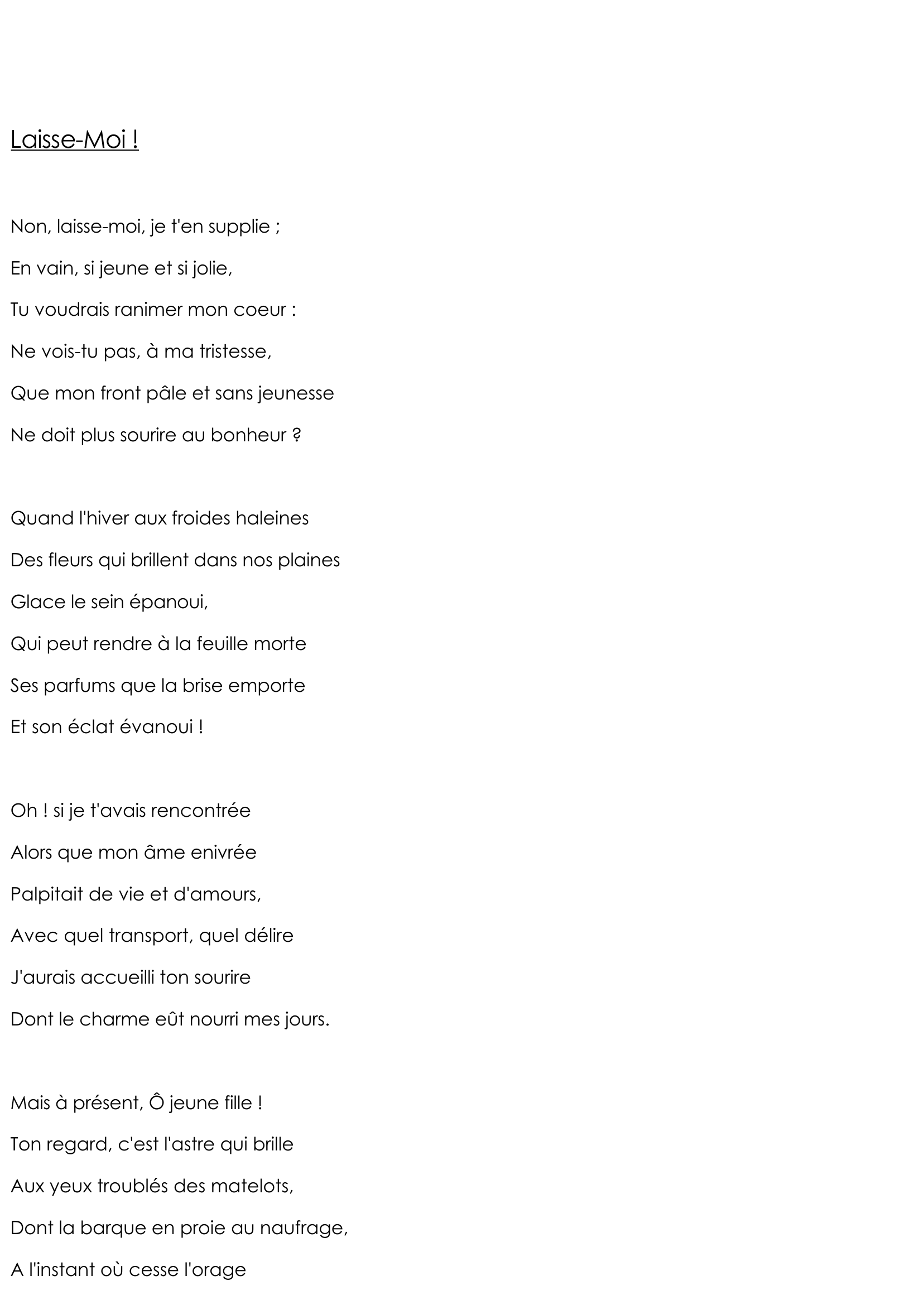Le Temps des Cerises
Quand nous en serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur
Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles
Cerises d'amour aux robes pareilles
Tombant sous la feuille en goutte de sang
Mais il est bien court le temps des cerises
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant
Quand vous en serez au temps des cerises
Si vous avez peur de chagrins d'amour
Evitez les belles
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour
J'aimerai toujours le temps des cerises
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte
Et Dame Fortune en m' étant offerte
Ne saura jamais calmer ma douleur
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur
Jean-Baptiste Clément
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère :
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère :
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire,
Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su.
Hélas ! J'aurai passé près d'elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,
N'osant rien demander et n'ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas ;
À l'austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle :
« Quelle est donc cette femme ? « et ne comprendra pas.
Félix Arvers
L’Albatros
Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, Qui suivent, indolents compagnons de voyage, Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches, Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! L’un agace son bec avec un brûle-gueule, L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; Exilé sur le sol au milieu des huées, Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du Mal (1857), II.
La Mort du loup est un poème philosophique en alexandrins d'Alfred de Vigny, publié en 1843 dans la Revue des deux Mondes[1].
I
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par des loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement
La girouette en deuil criait au firmament;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable, en s'y couchant; bientôt,
Lui que jamais ici l'on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au-delà quelques formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit, sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse;
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa Louve reposait comme celle de marbre
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les Demi-Dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort long-temps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang,
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
À poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
À ne jamais entrer dans le pacte des villes,
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul, le silence est grand; tout le reste est faiblesse.
— Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive,
À force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. «