Textes sur la personnalité : Thomas Mann, Freud et l'Avenir
Publié le 16/03/2011
Extrait du document
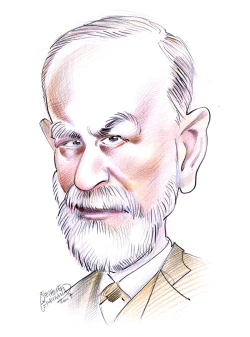
« Le moi des Anciens, la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes étaient autres que la nôtre; il était moins fermé, moins nettement circonscrit. Il était, si je puis dire, ouvert vers l'arrière et accueillait beaucoup de choses du passé pour les reproduire dans le présent en leur donnant une nouvelle existence liée à la sienne. Le philosophe de la civilisation, l'Espagnol Ortega y Gasset, exprime cela en disant que l'homme antique, avant d'accomplir un acte, faisait un pas en arrière, comme le torero prend son élan pour la mise à mort. Il cherchait dans le passé un modèle dans lequel il pût se glisser comme dans une cloche à plongeur pour pénétrer lui-même, à la fois protégé et travesti, dans les problèmes de son temps. Vivre était ainsi pour lui en un certain sens ramener à la vie : il se comportait comme les archaïsants. Mais vivre en ramenant, en rappelant à la vie, c'est justement vivre dans le mythe. Alexandre a marché dans les traces de Miltiade, et les biographes antiques de César étaient persuadés à tort ou à raison qu'il voulait imiter Alexandre. Dans le mot « imiter «, il y a bien plus que nous ne mettons aujourd'hui : il s'agit de l'identification mythique particulièrement familière à l'Antiquité, mais qui se poursuit bien loin dans les temps modernes et reste possible à toute époque dans la vie de l'esprit. On a souvent insisté sur le relief antique de la figure de Napoléon; il regrettait que les exigences de la conscience contemporaine ne lui permettent pas de se donner pour le fils de Jupiter Ammon, comme fit Alexandre. Mais qu'à l'époque de son expédition d'Orient, il se soit tout au moins confondu avec l'Alexandre du mythe, on ne saurait le mettre en doute, et plus tard, lorsqu'il se fut définitivement tourné vers l'Occident il déclarait : « Je suis Charlemagne. « Notez-le bien, il ne dit pas : « Je fais songer à Alexandre «, ou bien, « ma situation fait songer à la sienne «, et pas davantage : « Je suis comme lui «, mais tout simplement : « C'est moi Charlemagne « ! c'est la formule du mythe. La vie, du moins la vie représentative, a été ainsi dans les temps antiques la réincarnation d'un mythe. Elle se référait à lui, se réclamait de lui. C'est par lui, par cette référence au passé, qu'elle établissait son authenticité et sa valeur. Le mythe légitime une vie : c'est par lui, c'est en lui qu'elle prend conscience d'elle-même, de sa raison d'être, de son caractère sacré. Jusque dans la mort, Cléopâtre à joué le rôle d'Aphrodite avec la dignité inhérente à un mystère sacré, et peut-on vivre et mourir avec plus de dignité qu'en assumant la célébration d'un mythe?... Une vie qui s'exprime en citations, la vie dans le mythe, est une sorte de cérémonie religieuse; en tant que commémoration elle devient une cérémonie solennelle, l'accomplissement par un célébrant d'un rite prescrit, un office, une fête. Est-ce que le sens d'une fête n'est pas dans le retour et la commémoration?
Liens utiles
- Explication de texte Freud (extrait du chapitre 6) "L’avenir d’une illusion » 1927
- Le personnage d'ASCHENBACH Gustave de Thomas Mann
- AVENIR D’UNE ILLUSION (L’), Sigmund Freud (résumé)
- Le personnage de CASTORP Hans de Thomas Mann
- Les Buddenbrook de Thomas Mann
