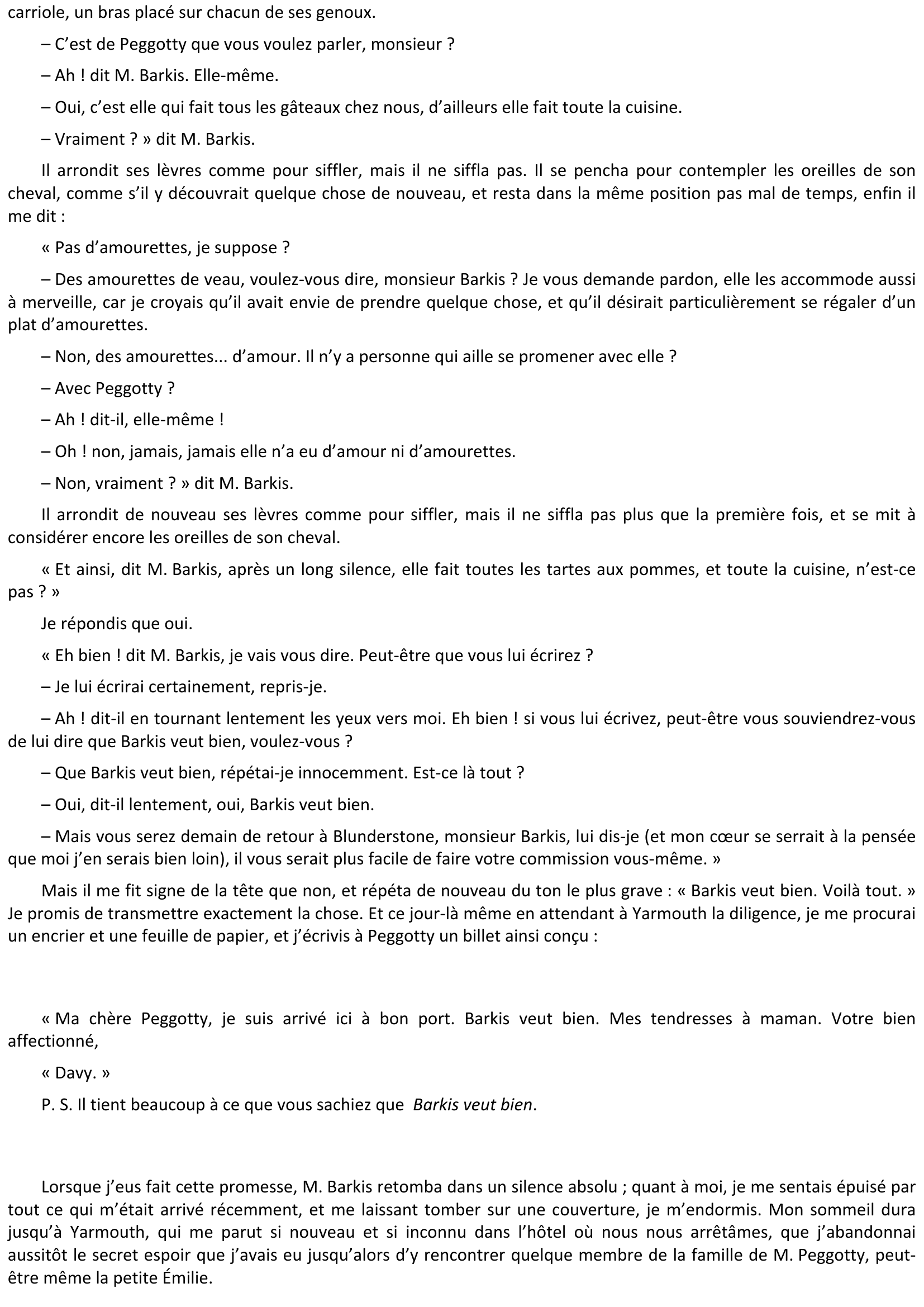V Je suis exilé de la maison paternelle Nous n'avions pas fait plus d'un demi-mille, et mon mouchoir de poche était tout trempé, quand le voiturier s'arrêta brusquement.
Publié le 15/12/2013

Extrait du document
«
carriole,
unbras placé surchacun deses genoux.
– C’est dePeggotty quevous voulez parler, monsieur ?
– Ah ! ditM. Barkis.
Elle-même.
– Oui, c’estellequifait tous lesgâteaux cheznous, d’ailleurs ellefaittoute lacuisine.
– Vraiment ? » ditM. Barkis.
Il arrondit seslèvres comme poursiffler, maisilne siffla pas.Ilse pencha pourcontempler lesoreilles deson
cheval, comme s’ilydécouvrait quelquechosedenouveau, etresta danslamême position pasmal detemps, enfinil
me dit :
« Pas d’amourettes, jesuppose ?
– Des amourettes deveau, voulez-vous dire,monsieur Barkis ?Jevous demande pardon,ellelesaccommode aussi
à merveille, carjecroyais qu’ilavait envie deprendre quelque chose,etqu’il désirait particulièrement serégaler d’un
plat d’amourettes.
– Non, desamourettes...
d’amour.Iln’y apersonne quiaille sepromener avecelle ?
– Avec Peggotty ?
– Ah ! dit-il,elle-même !
– Oh ! non,jamais, jamaisellen’aeud’amour nid’amourettes.
– Non, vraiment ? » ditM. Barkis.
Il arrondit denouveau seslèvres comme poursiffler, maisilne siffla pasplus quelapremière fois,etse mit à
considérer encorelesoreilles deson cheval.
« Et ainsi, ditM. Barkis, aprèsunlong silence, ellefaittoutes lestartes auxpommes, ettoute lacuisine, n’est-ce
pas ? »
Jerépondis queoui.
« Eh bien ! ditM. Barkis, jevais vous dire.Peut-être quevous luiécrirez ?
– Je luiécrirai certainement, repris-je.
– Ah ! dit-ilentournant lentement lesyeux versmoi.
Ehbien ! sivous luiécrivez, peut-être voussouviendrez-vous
de luidire queBarkis veutbien, voulez-vous ?
– Que Barkis veutbien, répétai-je innocemment.
Est-celàtout ?
– Oui, dit-illentement, oui,Barkis veutbien.
– Mais vousserez demain deretour àBlunderstone, monsieurBarkis,luidis-je (etmon cœur seserrait àla pensée
que moi j’enserais bienloin), ilvous serait plusfacile defaire votre commission vous-même. »
Mais ilme fitsigne delatête quenon, etrépéta denouveau duton leplus grave : « Barkis veutbien.
Voilà tout. »
Je promis detransmettre exactementlachose.
Etce jour-là mêmeenattendant àYarmouth ladiligence, jeme procurai
un encrier etune feuille depapier, etj’écrivis àPeggotty unbillet ainsiconçu :
« Ma chère Peggotty, jesuis arrivé iciàbon port.
Barkis veutbien.
Mestendresses àmaman.
Votrebien
affectionné,
« Davy. »
P.
S.Iltient beaucoup àce que vous sachiez que Barkis
veutbien .
Lorsque j’eusfaitcette promesse, M. Barkisretombadansunsilence absolu ; quantàmoi, jeme sentais épuisépar
tout cequi m’était arrivérécemment, etme laissant tombersurune couverture, jem’endormis.
Monsommeil dura
jusqu’à Yarmouth, quime parut sinouveau etsiinconnu dansl’hôtel oùnous nousarrêtâmes, quej’abandonnai
aussitôt lesecret espoir quej’avais eujusqu’alors d’yrencontrer quelquemembre delafamille deM. Peggotty, peut-
être même lapetite Émilie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DEVOIR MAISON : LE SUPPORT DE L’INFORMATION GENETIQUE, L’ADN
- devoir maison mathématiques - Partie 1 : Probabilités
- Sujet : La Maison Carrée, un exemple de temple italique en Gaule romaine
- Devoir maison logo
- L’écriture comme la seule voix audible de l’exilé ?