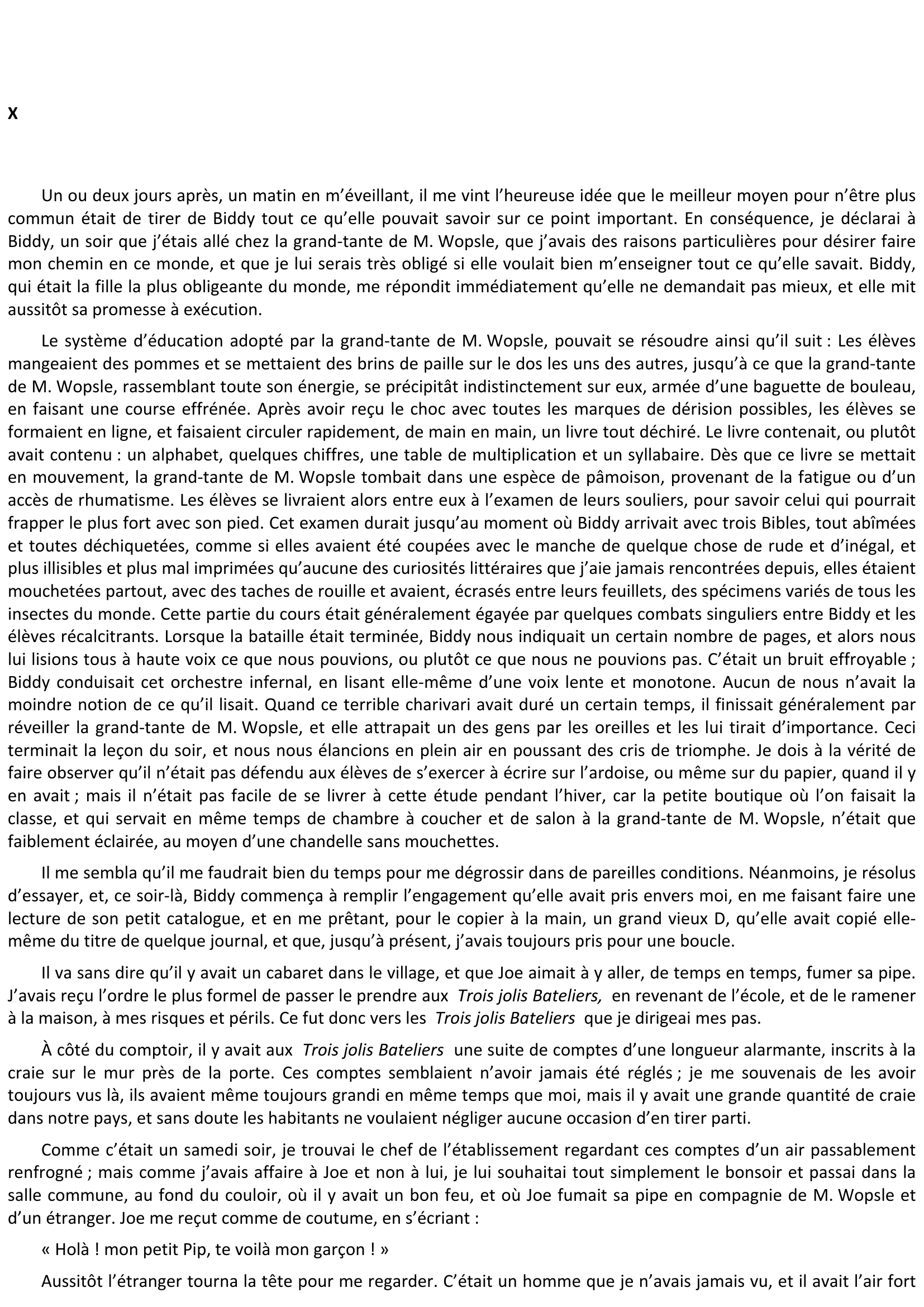voudrais bien que tu ne m'aies pas appris à appeler les valets des Jeannots, et je voudrais que mes mains fussent moins rudes et mes souliers moins épais.
Publié le 15/12/2013

Extrait du document
«
X
Un
oudeux jours après, unmatin enm’éveillant, ilme vint l’heureuse idéequelemeilleur moyenpourn’être plus
commun étaitdetirer deBiddy toutcequ’elle pouvait savoirsurcepoint important.
Enconséquence, jedéclarai à
Biddy, unsoir que j’étais alléchez lagrand-tante deM. Wopsle, quej’avais desraisons particulières pourdésirer faire
mon chemin encemonde, etque jelui serais trèsobligé sielle voulait bienm’enseigner toutcequ’elle savait.Biddy,
qui était lafille laplus obligeante dumonde, merépondit immédiatement qu’ellenedemandait pasmieux, etelle mit
aussitôt sapromesse àexécution.
Le système d’éducation adoptéparlagrand-tante deM. Wopsle, pouvaitserésoudre ainsiqu’ilsuit : Lesélèves
mangeaient despommes etse mettaient desbrins depaille surledos lesuns desautres, jusqu’à ceque lagrand-tante
de M. Wopsle, rassemblant toutesonénergie, seprécipitât indistinctement sureux, armée d’unebaguette debouleau,
en faisant unecourse effrénée.
Aprèsavoirreçulechoc avectoutes lesmarques dedérision possibles, lesélèves se
formaient enligne, etfaisaient circulerrapidement, demain enmain, unlivre toutdéchiré.
Lelivre contenait, ouplutôt
avait contenu : unalphabet, quelqueschiffres,unetable demultiplication etun syllabaire.
Dèsque celivre semettait
en mouvement, lagrand-tante deM. Wopsle tombaitdansuneespèce depâmoison, provenantdelafatigue oud’un
accès derhumatisme.
Lesélèves selivraient alorsentre euxàl’examen deleurs souliers, poursavoir celuiquipourrait
frapper leplus fortavec sonpied.
Cetexamen duraitjusqu’au moment oùBiddy arrivait avectroisBibles, toutabîmées
et toutes déchiquetées, commesielles avaient étécoupées aveclemanche dequelque chosederude etd’inégal, et
plus illisibles etplus malimprimées qu’aucunedescuriosités littéraires quej’aie jamais rencontrées depuis,ellesétaient
mouchetées partout,avecdestaches derouille etavaient, écrasésentreleursfeuillets, desspécimens variésdetous les
insectes dumonde.
Cettepartie ducours étaitgénéralement égayéeparquelques combatssinguliers entreBiddy etles
élèves récalcitrants.
Lorsquelabataille étaitterminée, Biddynousindiquait uncertain nombre depages, etalors nous
lui lisions tousàhaute voixceque nous pouvions, ouplutôt ceque nous nepouvions pas.C’était unbruit effroyable ;
Biddy conduisait cetorchestre infernal,enlisant elle-même d’unevoixlente etmonotone.
Aucundenous n’avait la
moindre notiondecequ’il lisait.
Quand ceterrible charivari avaitduréuncertain temps,ilfinissait généralement par
réveiller lagrand-tante deM. Wopsle, etelle attrapait undes gens parlesoreilles etles luitirait d’importance.
Ceci
terminait laleçon dusoir, etnous nousélancions enplein airenpoussant descrisdetriomphe.
Jedois àla vérité de
faire observer qu’iln’était pasdéfendu auxélèves des’exercer àécrire surl’ardoise, oumême surdupapier, quandily
en avait ; maisiln’était pasfacile deselivrer àcette étude pendant l’hiver,carlapetite boutique oùl’on faisait la
classe, etqui servait enmême tempsdechambre àcoucher etde salon àla grand-tante deM. Wopsle, n’étaitque
faiblement éclairée,aumoyen d’unechandelle sansmouchettes.
Il me sembla qu’ilmefaudrait biendutemps pourmedégrossir dansdepareilles conditions.
Néanmoins, jerésolus
d’essayer, et,cesoir-là, Biddycommença àremplir l’engagement qu’elleavaitprisenvers moi,enme faisant faireune
lecture deson petit catalogue, eten me prêtant, pourlecopier àla main, ungrand vieuxD,qu’elle avaitcopié elle-
même dutitre dequelque journal,etque, jusqu’à présent, j’avaistoujours prispour uneboucle.
Il va sans direqu’il yavait uncabaret danslevillage, etque Joeaimait àyaller, detemps entemps, fumersapipe.
J’avais reçul’ordre leplus formel depasser leprendre aux Trois
jolisBateliers, en
revenant del’école, etde leramener
à la maison, àmes risques etpérils.
Cefut donc versles Trois
jolisBateliers que
jedirigeai mespas.
À côté ducomptoir, ilyavait aux Trois
jolisBateliers une
suite decomptes d’unelongueur alarmante, inscritsàla
craie surlemur près delaporte.
Cescomptes semblaient n’avoirjamaisétéréglés ; jeme souvenais deles avoir
toujours vuslà,ilsavaient mêmetoujours grandienmême tempsquemoi, mais ilyavait unegrande quantité decraie
dans notre pays,etsans doute leshabitants nevoulaient négligeraucuneoccasion d’entirerparti.
Comme c’étaitunsamedi soir,jetrouvai lechef del’établissement regardantcescomptes d’unairpassablement
renfrogné ; maiscomme j’avaisaffaire àJoe etnon àlui, jelui souhaitai toutsimplement lebonsoir etpassai dansla
salle commune, aufond ducouloir, oùilyavait unbon feu,etoù Joe fumait sapipe encompagnie deM. Wopsle et
d’un étranger.
Joemereçut comme decoutume, ens’écriant :
« Holà ! monpetit Pip,tevoilà mongarçon ! »
Aussitôt l’étranger tournalatête pour meregarder.
C’étaitunhomme quejen’avais jamaisvu,etilavait l’airfort.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Ma façon d’agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais ce que je déteste, c’est cela que je fais » PAUL
- MAINS SALES (Les). (résumé) Jean-Paul Sartre
- TEMPS RUDES (résumé et analyse)
- Prénom : Cycle 3 Savoir comment lutter contre les microbes Date : plaie sol de maison matériel de chirurgien mains aliment b.
- SYNTHESE DE PHILO COURS La sensation est un phénomène produit par quelque chose d’extérieur sur un de nos organes de sens comme nos mains, aboutissant alors à la conscience d’une perception.