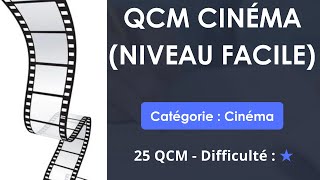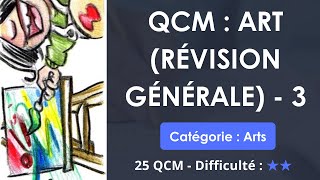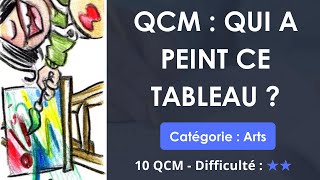le langage de Debussy entre 1900 et 1913
Publié le 17/07/2025
Extrait du document
«
Piano classique
I.
Le langage de Debussy entre 1900 et 1913
Partie 1 : Comparaison de deux pièces différentes
Symbole de l’anti-académisme et de l’audace, à l’aube du XXe siècle, la sensuelle modernité du langage de
Debussy marque un véritable tournant dans l’histoire.
La musique est « un art libre, jaillissant, un art de plein
air, un art à la mesure des éléments, du vent, du ciel, de la mer » écrivait-il.
L’une de ses citations résume
assez bien sa philosophie musicale : « il faut humblement chercher à faire plaisir ».
C’est sans doute ce qui
fait son charme et qui suscite le désir, celui d’entrer dans un monde onirique, dans lequel chacun peut projeter
son imaginaire, ses aspirations.
Contrairement à l'idée reçue qui associe Debussy à l'impressionnisme, celui-ci
y était réticent et lui préférait le symbolisme .En opposition aux impressionnistes qui veulent peindre
l’évanescence et le flou, le symbolisme est la quête d’un monde supérieur, idéal, invisible, accessible à travers
l’émotion poétique et artistique.
Comment ne pas évoquer Debussy dès lors que l’on souhaite parler de
piano ? Compositeur, pianiste dès son plus jeune âge, il est toujours resté fidèle au clavier, créant ainsi un
binôme productif et régulier, révélateur de l’évolution de son propre langage.
Proche de la nature, mais aussi
très attiré par les arts asiatiques, par l’exotisme, Debussy a très tôt trouvé sa « signature » sonore et ses
sources d’inspirations.
Les thèmes de la nuit, de l’eau, celui des légendes également sans parler de l’Espagne,
de l’Antiquité et des saisons sont omniprésents dans toute son œuvre.
Debussy était sensible à la nature et fut
maître dans l’art de l’évocation sonore.
Quelles techniques Debussy met il en œuvre pour retranscrire la sensation d’un environnement pour l’auditeur
? Le vent dans la plaine ou la somptuosité d’un palais javanais, une cité engloutie par les eaux ou encore des
pas sur la neige...Comment Debussy arrive t-il à évoquer toutes ces choses ?
Par l’étude de deux œuvres complémentaires, le but de ce travail sera d’établir la carte d’identité la plus fidèle
au langage original et novateur de Debussy entre 1900 et 1913.
Le ton y sera analytique, musicologique et
historique afin de re-contextualiser au mieux.
Noms des œuvres et interprétations conseillées (cliquer sur lien):
1) Debussy - Pagodes | Claudio Arrau
2) Debussy - Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir | Pierre-Laurent Aimard
1
Période charnière de l’Histoire donc que celle qui assiste à la vie de Debussy : la guerre franco-prussienne a
fait chuter Napoléon III.
Amputée de l’Alsace-Lorraine, la République se remet du choc de la Commune.
La
Société Nationale de Musique vient d’être fondée par Camille Saint-Saëns en 1871 et Claude Monet appose la
dernière touche de peinture à Impression, soleil levant.
De l’autre coté du Rhin, Wagner termine sa tétralogie.
Debussy, très jeune, se fait remarquer pour ses talents de pianiste et de jeune compositeur auprès de Mlle de
Fleurville.
En 1872, elle le fait entrer au conservatoire de Paris, il n’a que 10 ans; on a d’ailleurs souvent
l’occasion de le surprendre au piano, se livrant a des improvisations «guère orthodoxes mais bien
ingénieuses».
En 1874, il compose Prélude a l’après-midi d’un faune, c’est un vif succès, la carrière du jeune
compositeur est lancée.
Ce n’est toutefois qu’à partir de 1903 que Debussy entre dans la grande période de ses
compositions pour piano.
Les deux pièces sélectionnées ici datent de 1903 pour Pagodes (extrait des
Estampes) et 1910 pour Les parfums et les sons tournent dans l’air du soir (extrait du 1er livre de Préludes)
Les Estampes inaugurent une manière qui, après les Images atteindra son apogée dans les deux livres de
Préludes.
Debussy fait appel à des motifs précis, prétextes à des évocations de la puissance de la nature qui
l’inspire.
E.
Lockspeiser a bien défini le phénomène sonore que Debussy nous offre: «Le piano ne quitte pas
seulement la pièce ou l’on étudie ou le salon, [...] il devient l’instrument poétique d’un esprit vagabond
imaginatif, capable de recréer l’âme de lointains pays et de leurs habitants, les beautés sans cesse
changeantes de la nature...».
Debussy dira également, avec un humour qui lui est bien propre «Quand on n’a
pas le moyen de se payer des voyages, il faut y suppléer par l’imagination»
ANALYSES D’OEUVRES
1) Les modes - Une des grandes signatures de Debussy est
qu’il ne tient plus spécialement à entrer dans une tonalité.
Tout est remis en question au profit de nouvelles couleurs
modales.
Dans Pagodes, régnant sur les touches noires, le thème pentatonique initial sera utilisé tout au long
du morceau.
Dans une tonalité se rapprochant de si majeur, mais en évitant les mi et les si, on entre dans un
mode représentatif de l’Asie, tout empreint de spiritualité et de suspension.
Il sera répété plusieurs fois,
chaque fois avec des harmonisations et des rythmiques variées, une sorte de leitmotiv.
Le caractère est libre et
aérien en l’absence de sensible et de tonique.
2
En 1889, Debussy se rend à Bayreuth.
Il assiste à la
tétralogie de Wagner, bouleversé par autant de beauté.
Mais
selon lui, il faut trouver une autre voie après avoir vécu cette
«géniale conclusion d’une époque», tout ayant déjà été
exploré dans le système tonal.
Deuxième exemple dans Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir, ci-dessus, l’armure utilisée laisse
presque deviner La majeur, mais le si ♭ ajoute une couleur phrygienne ce qui plante un décor beaucoup plus
andalou et empreint de rêverie nocturne.
V.
Jankélévitch écrit à ce propos « la sensibilité tonale de cette pièce,
perdant tout système de référence, semble sur le point de défaillir et de chavirer dans l’extase, tandis que les
altérations défont et refont les tonalités tour à tour.
»
Citons également l’emploi de la gamme par ton, étrange et flottante, dans Voiles ou encore l’usage d’échelle
inspirée du plain-chant grégorien dans La cathédrale engloutie.
Que de richesse et une grande curiosité pour
l’époque.
C.
Saint-Saëns dira «C’en est fait de l’exclusivisme des deux modes majeur et mineur.
Les modes
antiques rentrent en scène et, à leur suite, feront irruption dans l’art les modes de l’Orient.»
2) Les proportions/la structure - La forme des œuvres chez Debussy n’est jamais bien traditionnelle.
Quasi
jamais de cadences parfaites, ni de phrases faisant pile 8 mesures, peu de formes ABA conventionnelles, point
de modulations à la quinte pour le développement.
Voici par exemple la structure générale de Pagodes :
Les parties s’enchaînent au gré du son, tels des «paravents chinois» dont les coutures auraient été savamment
gommées.
Il en ressort à l’écoute et au jeu la sensation de liberté, de souplesse, mais aussi un caractère
improvisé.
En revanche dans Les sons et les
parfums, pour créer un climat statique, la
forme est presque constituée d’un bloc
unique,
Debussy
réutilise
le
matériel
thématique bleu ci-dessus:
3) Le goût des secondes, tierces, tritons et
3
septièmes
Certains intervalles sont appréciés et employés à maintes reprises
pour éviter d’exposer une tonalité trop franche...Commençons par
les 2ndes majeures, Les sons et les parfums à droite
+
Pagodes ci
dessous.
Grandes favorites du compositeur, elles traversent toute
son œuvre.
Possédant un pouvoir visuel de miroitement,
de flou, ce pigment sonore apporte un contraste éclairant
et fugitif à l’écriture.
On peut noter également une affinité pour les mouvements de tierces tantôt majeures
tantôt mineures, en mouvements parallèles, ici à gauche, dans Les sons et les
parfums, qui créent le sentiment de temps suspendu, malgré l’écriture en 3/4.
Le
goût de Debussy pour les rapports de tierces se ressent également dans certains
contre-chants.
Rappelons que Pagodes fut écrite dans un pseudo-ton de «Si majeur pentatonique».
À la m.7,
un ravissant contre-chant en sol♯mineur vient s’y greffer, à la tierce
inférieure.
Une dose de nostalgie dans un ancien décor estampé
indonésien...
Poursuivons l’analyse autour des tritons, des accords demi-diminués, véritables «girouette»
tonales dont Debussy se sert énormément pour brouiller les pistes du discours, amorcer des
changements, évoquer l’étrangeté par le son.
En voici un bel exemple dans Les sons et les
parfums, la main gauche jouant fa/si et la main droite ré♯/la, les deux tritons se superposent
de manière assez inattendue.
La quinte diminuée est très présente dans tous les opus.
Finissons ce chapitre avec les septièmes, si
chères à Debussy.
Assez attiré par les
sonorités jazzy, il utilise fréquemment les
accords de septième dans Les sons et les parfums.
De cette manière, l’écriture s’enrichit et s’allège à la fois.
Chaque accord, quel qu’il soit, a sa couleur, son autonomie; les fonctions habituelles d’enchaînements entre
les accords n’existent plus.
On parle même de «mélodie d’accords», créant l’impression de rapides
4
changements d’éclairages.
A 23 ans, il obtient le prix de Rome de composition et va séjourner 2 ans dans «la
prison Médicis» selon ses dires.
Debussy, le caractère bien affirmé, assume déjà son antipathie à se plier aux
règles d’harmonie et à se fondre dans la grande tradition du passé qui l’ennuie et l’emprisonne.
«Foule
ahurie ! Êtes-vous incapables....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES BALISAGES DU LANGAGE HTML
- C. E. 20 juin 1913, TERY, Rec. 736, concl. Corneille
- Le langage – cours
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle
- dissertation juste la fin du monde: En quoi l’œuvre Juste la Fin du Monde relève-telle une crise personnelle et familiale à travers une crise du langage ?