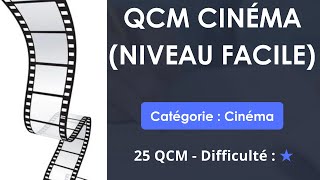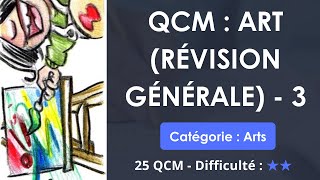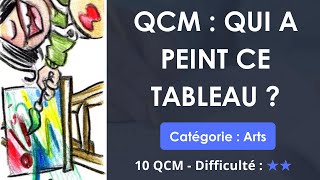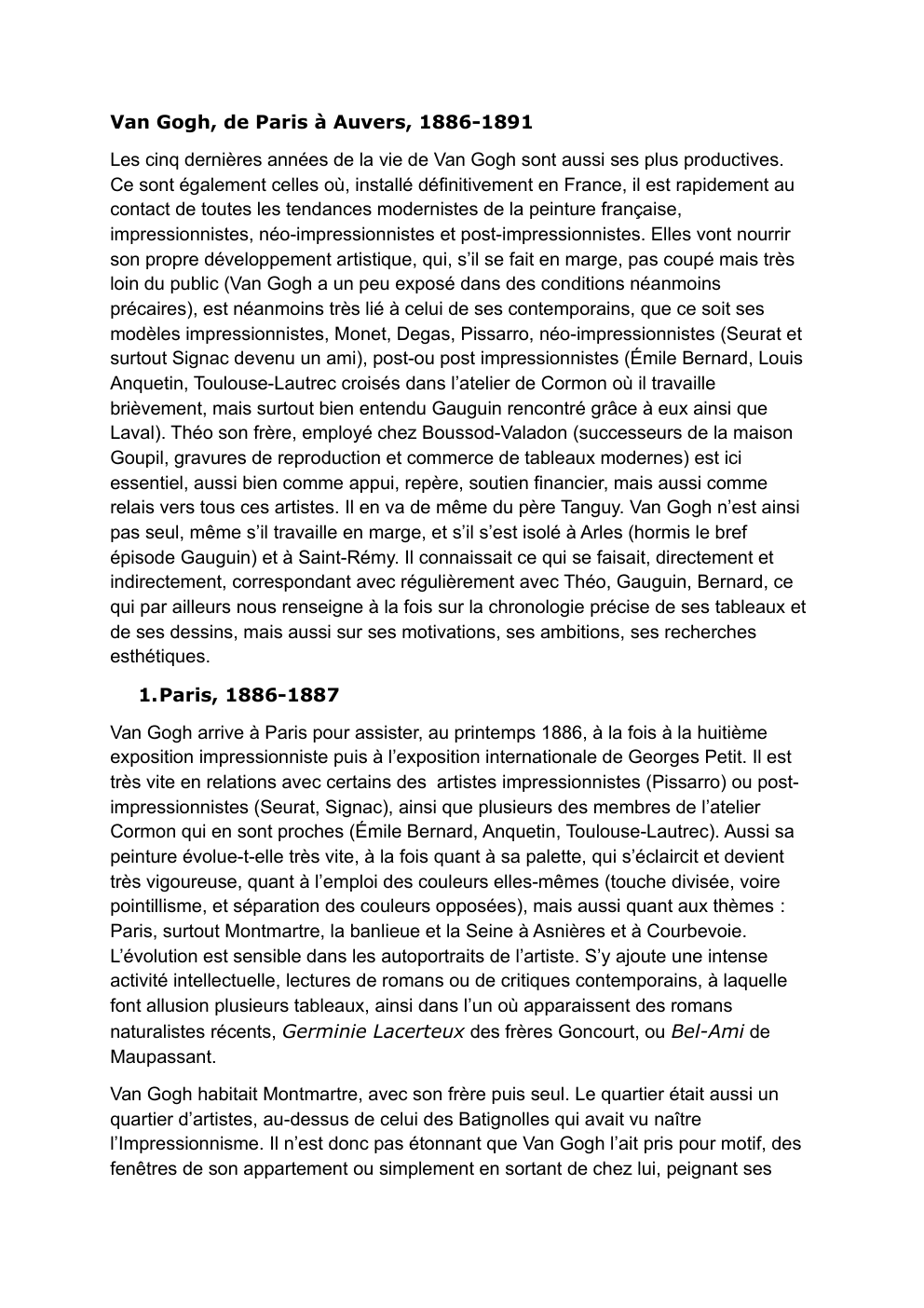Vincent van Gogh
Publié le 18/11/2025
Extrait du document
«
Van Gogh, de Paris à Auvers, 1886-1891
Les cinq dernières années de la vie de Van Gogh sont aussi ses plus productives.
Ce sont également celles où, installé définitivement en France, il est rapidement au
contact de toutes les tendances modernistes de la peinture française,
impressionnistes, néo-impressionnistes et post-impressionnistes.
Elles vont nourrir
son propre développement artistique, qui, s’il se fait en marge, pas coupé mais très
loin du public (Van Gogh a un peu exposé dans des conditions néanmoins
précaires), est néanmoins très lié à celui de ses contemporains, que ce soit ses
modèles impressionnistes, Monet, Degas, Pissarro, néo-impressionnistes (Seurat et
surtout Signac devenu un ami), post-ou post impressionnistes (Émile Bernard, Louis
Anquetin, Toulouse-Lautrec croisés dans l’atelier de Cormon où il travaille
brièvement, mais surtout bien entendu Gauguin rencontré grâce à eux ainsi que
Laval).
Théo son frère, employé chez Boussod-Valadon (successeurs de la maison
Goupil, gravures de reproduction et commerce de tableaux modernes) est ici
essentiel, aussi bien comme appui, repère, soutien financier, mais aussi comme
relais vers tous ces artistes.
Il en va de même du père Tanguy.
Van Gogh n’est ainsi
pas seul, même s’il travaille en marge, et s’il s’est isolé à Arles (hormis le bref
épisode Gauguin) et à Saint-Rémy.
Il connaissait ce qui se faisait, directement et
indirectement, correspondant avec régulièrement avec Théo, Gauguin, Bernard, ce
qui par ailleurs nous renseigne à la fois sur la chronologie précise de ses tableaux et
de ses dessins, mais aussi sur ses motivations, ses ambitions, ses recherches
esthétiques.
1.Paris, 1886-1887
Van Gogh arrive à Paris pour assister, au printemps 1886, à la fois à la huitième
exposition impressionniste puis à l’exposition internationale de Georges Petit.
Il est
très vite en relations avec certains des artistes impressionnistes (Pissarro) ou postimpressionnistes (Seurat, Signac), ainsi que plusieurs des membres de l’atelier
Cormon qui en sont proches (Émile Bernard, Anquetin, Toulouse-Lautrec).
Aussi sa
peinture évolue-t-elle très vite, à la fois quant à sa palette, qui s’éclaircit et devient
très vigoureuse, quant à l’emploi des couleurs elles-mêmes (touche divisée, voire
pointillisme, et séparation des couleurs opposées), mais aussi quant aux thèmes :
Paris, surtout Montmartre, la banlieue et la Seine à Asnières et à Courbevoie.
L’évolution est sensible dans les autoportraits de l’artiste.
S’y ajoute une intense
activité intellectuelle, lectures de romans ou de critiques contemporains, à laquelle
font allusion plusieurs tableaux, ainsi dans l’un où apparaissent des romans
naturalistes récents, Germinie Lacerteux des frères Goncourt, ou Bel-Ami de
Maupassant.
Van Gogh habitait Montmartre, avec son frère puis seul.
Le quartier était aussi un
quartier d’artistes, au-dessus de celui des Batignolles qui avait vu naître
l’Impressionnisme.
Il n’est donc pas étonnant que Van Gogh l’ait pris pour motif, des
fenêtres de son appartement ou simplement en sortant de chez lui, peignant ses
aspects pittoresques, en particulier les moulins qui pouvaient aussi lui faire se
souvenir de son pays natal.
Ses vues du boulevard de Clichy ou de la banlieue
proche, Clichy, Asnières, sont proches de celles, contemporaines, de Seurat et de
son groupe, aussi bien par le choix des sujets que par le style délibérément
pointilliste, ou pratiquant la touche divisée, que Van Gogh adopte alors.
C’est également à ce moment que Van Gogh découvre vraiment, très certainement à
l’initiative de ses amis ou conforté par eux, les estampes japonaises.
Comme eux il
les connait soit par des originaux, soit par des reproductions.
Il en copie certaines en
peinture, et il en fait le fond de ses portraits du père Tanguy, dont il est aussi proche
et qu’il fréquente régulièrement, ou s’en inspire étroitement pour des œuvres
indépendantes
1.Arles, février 1888-mai 1889
Van Gogh était attiré par le Midi, à cause notamment de sa lumière permettant de
voir, et de peindre, des couleurs plus franches et plus éclatantes.
Il voulait ainsi un
« atelier du Midi », qui puisse, de surcroît, être collectif (c’est le sens de la venue de
Gauguin que Van Gogh attendait avec impatience, d’autant qu’il connaissait, par
lettres notamment, les évolutions stylistiques de Gauguin et de Bernard à Pont-Aven
durant l’été 1888).Le Midi était aussi pour lui une sorte de « Japon en Europe ».
Il
s’établit ainsi à Arles en février 1888.
Il n’y a pas de raisons primordiales pour cela,
mais plutôt un ensemble.
Van Gogh voulait, avec son frère, acheter des tableaux de
Monticelli, peintre provençal qu’ils admiraient particulièrement, et pensait en trouver
là avant Marseille.
Arles était une ville connue pour ses monuments, et son insertion
dans une Provence pittoresque.
La beauté des arlésiennes était réputée.
La ville
bénéficiait aussi d’une réputation toute littéraire, qui était celle du Midi en général
(Zola, Daudet, que Van Gogh admirait comme Maupassant et qu’il lisait beaucoup).
Peut-être la lecture des Tartarin de Daudet a-t-elle particulièrement joué (les
Lettres de mon moulin, avec la nouvelle L’Arlésienne, ont été publiées en
1869).
Van Gogh pensait également y vivre à peu de frais.
Il habite d’abord au
Restaurant-Hôtel Carrel, rue de la Cavalerie, jusqu’en mai, où une dispute sur sa
note avec le propriétaire l’oblige à trouver une autre résidence.
Ce sera le Café de la
Gare, place Lamartine (où existe un jardin public surnommé par Van Gogh « Le
jardin du poète »), tenu par monsieur et madame Ginoux (« l’Arlésienne ») et où, à
côté de l’hôtel, existe une petite maison, « la maison jaune », qu’il loue d’abord en
partie pour y faire son atelier, et où il ira complètement habiter en septembre, avant
l’arrivée prévue de Gauguin (les deux hommes coexistant ensuite dans cette
habitation très petite).
Le quartier, à côté de la gare et des dépôts de train qui font un
bruit incessant, est aussi celui des prostituées.
Il est juste en marge du centre
historique d’Arles.
Van Gogh est arrivé à Arles alors que la ville était encore sous la neige.
Mais
très vite le printemps arrive et les verges sont en fleurs : Il peint alors tout un
ensemble de toiles sur ce thème (quatorze sont répertoriées), ce qui à la fois lui fait
d’emblée trouver une palette très claire et des couleurs éclatantes où les blancs
jouent d’évidence un grand rôle, mais aussi prendre conscience de l’intérêt de
peindre en séries ou en ensemble.
Tout ceci apparaît bien dans ses lettres à Théo ou
à d’autres artistes comme Émile Bernard, à qui il écrit régulièrement.
Il pensait
regrouper plusieurs de ces tableaux en tryptiques, ce qui nous renseigne aussi sur le
sens purement décoratif qu’il leur donnait.
Parallèlement, il explore Arles et ses environs immédiats (la ville reste son
sujet) dans une série de dessins, exécutés avec l’aide d’un cadre lui permettant de
fixer la perspective comme il l’explique à son frère.
Plusieurs de ses dessins sont à
l’origine de peintures exécutées plus tard, ou peuvent être considérées comme une
première approche, travaillée ultérieurement lorsqu’il reviendra plus précisément sur
un sujet.
Mais il ne s’agit pas à proprement parler d’études, puisqu’il existe des
dessins sans tableaux et des tableaux sans dessins.
En outre, si Van Gogh a utilisé
des carnets de croquis, ceux-ci ont complètement disparu.
Pour lui ces dessins
étaient en fait des œuvres en soi, qui deviennent d’ailleurs exclusives par moments,
par exemple lors de cette campagne où il cherche à économiser sur son matériel en
ayant appris les difficultés que Théo rencontre alors avec ses employeurs (il veut
faire économiser à son frère sur les fonds que celui-ci lui envoie).
Sa technique est
aussi très raisonnée, il veut imiter, en dessin, les estampes japonaises, d’où l’usage
des plumes en roseau qui lui permettent un trait très épais, et la simplification des
formes.
Fin mai, grâce à un envoi d’argent par Théo, il peut se rendre aux SaintesMaries de la mer (dont le pèlerinage annuel vient d’avoir lieu, ce qui a probablement
attiré son attention) où il exécute un ensemble de dessins très abouti, en même
temps que deux marines peintes.
De retour à Arles, début juin, il peint d’après ses
dessins plusieurs tableaux.
Le séjour aux Saintes-Maries lui permet de prendre plus
de liberté dans son dessin d’une part, dans ses tableaux de l’autre, en recherchant à
la fois l’expressivité du trait, mais aussi d’une couleur qui lui est encore plus révélée
au bord de la mer.
Ce double travail, sur le motif et en atelier, se poursuit pendant
l’été où il prend pour motif la campagne environnant Arles, au moment de la
moisson, avec notamment la première version du Semeur, mais aussi Arles ellemême.
C’est ainsi qu’un dessin de même sujet qu’une peinture semble moins être un
carton préparatoire (il n’existe d’ailleurs pas d’exemple de mise au carreau) qu’un
moyen de se familiariser avec un motif particulier.
Cet ensemble sur la moisson (le
travail sur le motif a été interrompu par les pluies torrentielles des 20-23 juin) culmine
dans deux tableaux : La Charrette bleue, patiemment construite, et Le Semeur,
dont le thème se révéla symboliquement si important pour Van Gogh, et qui le retint
tout particulièrement (c’est l’une de ses peintures les mieux documentées et sur
laquelle....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VINCENT VAN GOGH - Arts et Culture
- Vincent Van Gogh (Exposé – Art – Collège/Lycée)
- Les Tournesols 1888 Vincent Van Gogh (1853-1890)
- Vincent van Gogh.
- Vincent VAN GOGH: LE JARDIN DU DOCTEUR GACHET.