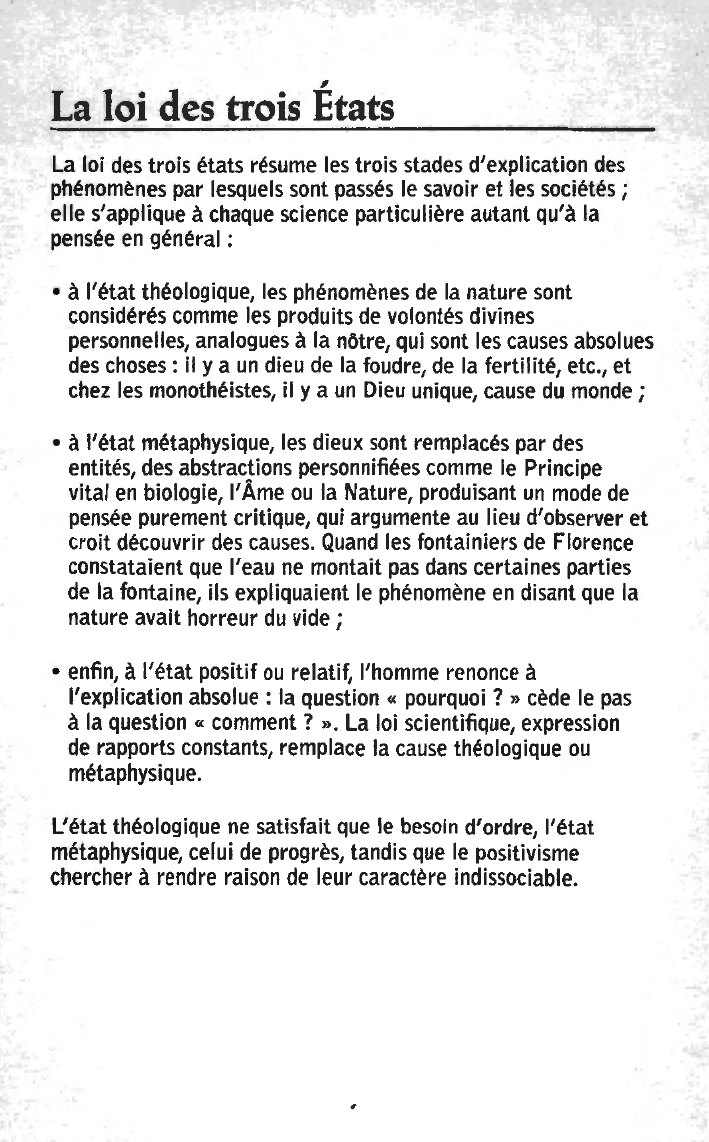Auteurs: COMTE
Publié le 22/05/2012

Extrait du document
Auguste Comte est né en 1798 à Montpellier, dans une famille de la petite bourgeoisie catholique. Il intégra en 1814 l'École polytechnique. Il n'a alors que 16 ans. Il fut secrétaire de Saint-Simon et donna des leçons de mathématiques pour vivre. En 1830, il publie le premier volume de son célèbre Cours de philosophie positive. Nommé, en 1832, répétiteur à l'École Polytechnique, il fait paraître, en 1842, le dernier des six volumes de son cours, puis, en 1844, le Discours sur l'esprit positif. En 1845, il rencontre Clotilde de Vaux dont la mort, l'année suivante, bouleversera son existence. Il lui vouera un véritable culte, et l'érigera en " patronne du positivisme ". Comte s'éteint le 5 septembre 1857. D'abord disciple de Saint-Simon, penseur de l'âge industriel, dont il récusa par la suite les conceptions et les thèses, il est également influencé par de nombreux philosophes : Aristote, à qui il consacre le troisième mois du calendrier positiviste ; Descartes, à qui il dédie le onzième mois ; et Condorcet, en qui il voit son père spirituel. Tout au long de son ouvre, les morts semblent gouverner les vivants, par la trace qu'ils ont laissée dans l'Histoire. Comte est le fondateur du positivisme, doctrine qui, dépassant métaphysique et religion, ne reconnaît le vrai que dans les faits scientifiquement et méthodiquement étudiés. Cette doctrine a eu une influence considérable jusqu'à notre époque. L'esprit positif se caractérise par l'abandon de l'explication par les causes théologiques et métaphysiques, ainsi que par la mise à l'écart de tout absolu et la seule recherche des lois. Le positivisme est également conçu comme un mouvement de pensée " réel " et " utile ", où seule la méthode des sciences positives, qui s'attachent uniquement à l'étude des faits, est reconnue comme étant féconde. La société forme un groupe humain spécifique qui est irréductible à l'individu, lequel renvoie à une abstraction. L'humanité constitue, elle, ce Grand Être, nous englobant et nous dépassant, où les morts " existent " en nous, et nous conduisent. Comte élabore la théorie des trois états qui se veut avant tout descriptive et dégagée de toute portée métaphysique : l'esprit humain passe d'abord par l'état théologique, puis par l'état métaphysique, et accède enfin à l'état positif lorsqu'il abandonne la recherche du pourquoi. La science et ses lois, non seulement répondent au besoin fondamental de l'homme, celui de comprendre le réel, mais permettent de prévoir et d'agir. L'esprit positif reste alors tout particulièrement attentif aux phénomènes de liaison sociale qui existent entre les hommes. Comte, créateur du terme " sociologie ", pose l'individu isolé comme une abstraction, et ouvre l'analyse de la spécificité de la réalité sociale. Toutefois, il faudra attendre Émile Durkheim pour que soit définie la méthodologie fondamentale de la sociologie, car la " sociologie " de Comte débouche sur le culte du " Grand Être ", c'est-à-dire l'Humanité.
«
La loi des trois États
La loi des trois états résume les trois stades d'explication des phénomènes par lesquels sont passés le savoir et les sociétés; elle s'applique à chaque science particulière autant qu'à la pensée en général :
• à l'état théologique , les phénomènes de la nature sont
considérés comme les produits de volontés divines personnelles , analogues à la nôtre, qui sont les causes absolues des choses : il y a un dieu de la foudre , de la fertilité, etc., et chez les monothéistes, il y a un Dieu unique, cause du monde;
• à l'état métaphysique, les dieux sont remplacés par des entités , des abstractions personnifiées comme le Principe vital en biologie, l'Âme ou la Nature, produisant un mode de pensée purement critique, qui argumente au lieu d'observer et
croit découvrir des causes.
Quand les fontainiers de Florence constataient que l'eau ne montait pas dans certaines parties de la fontaine, ils expliquaient le phénomène en disant que la nature avait horreur du vide ;
• enfin, à l'état positif ou relatif, l'homme renonce à l'explication absolue : la question « pourquoi ? , cède le pas à la question.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les livres n'ont pas d'importance: il n'y a que la vie qui importe, et seuls méritent d'être lus les livres qui se mettent à son service - seuls méritent d'être lus, en conséquence, les auteurs qui savent que les livres n'ont pas d'importance! l'amour la solitude Comte-Sponville, André. Commentez cette citation.
- Fiche de lecture le Comte de monte Cristo de ALEXANDRE DUMAS
- auteurs russes interdits
- Les Lumières : auteurs, œuvres et idées
- Comte, la Science sociale (extrait) Avec un souci pédagogique proprement « positif », Comte expose la loi des trois états -- théologique, métaphysique et positif -- par lesquels passent successivement tous les produits de la pensée humaine.