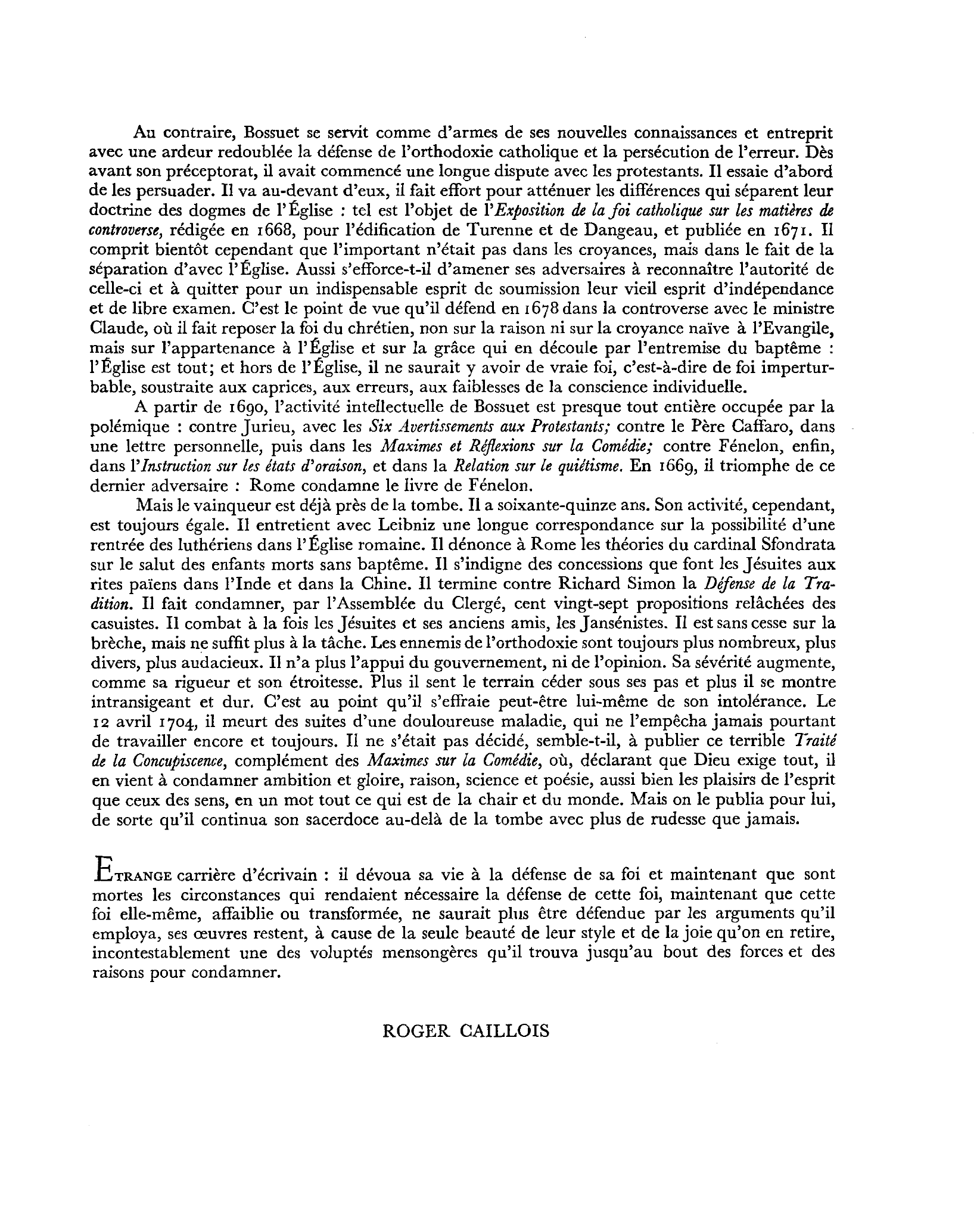BOSSUET
Publié le 02/09/2013

Extrait du document
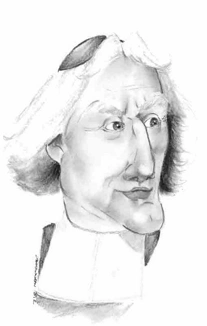
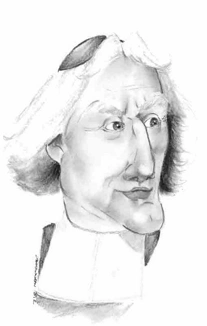
«
------------·----------------- ..
-~- ......
__ _
Au contraire, Bossuet se servit comme d'armes de ses nouvelles connaissances et entreprit
avec une ardeur redoublée la défense de l'orthodoxie catholique et la persécution de l'erreur.
Dès
avant son préceptorat, il avait commencé une longue dispute avec les protestants.
Il essaie d'abord
de les persuader.
Il va au-devant d'eux, il fait effort pour atténuer les différences qui séparent leur
doctrine des dogmes de l'Église : tel est l'objet de !'Exposition de lafoi catholique sur les matières de
controverse, rédigée en 1668, pour l'édification de Turenne et de Dangeau, et publiée en 1671.
Il
comprit bientôt cependant que l'important n'était pas dans les croyances, mais dans le fait de la
séparation d'avec l'Église.
Aussi s'efforce-t-il d'amener ses adversaires à reconnaître l'autorité de
celle-ci et à quitter pour un indispensable esprit de soumission leur vieil esprit d'indépendance
et de libre examen.
C'est le point de vue qu'il défend en l 678 dans la controverse avec le ministre
Claude,
où il fait reposer la foi du chrétien, non sur la raison ni sur la croyance naïve à l'Evangile,
mais
sur l'appartenance à l'Église et sur la grâce qui en découle par l'entremise du baptême :
l'Église est
tout; et hors de l'Église, il ne saurait y avoir de vraie foi, c'est-à-dire de foi impertur
bable, soustraite aux caprices, aux erreurs, aux faiblesses de la conscience individuelle.
A
partir de 1690, l'activité intellectuelle de Bossuet est presque tout entière occupée par la
polémique : contre Jurieu, avec les Six Avertissements aux Protestants; contre le Père Caffaro, dans
une lettre personnelle, puis dans les Maximes et Rifftexions sur la Comédie; contre Fénelon, enfin,
dans l' Instruction sur les états d'oraison, et dans la Relation sur le quiétisme.
En l 669, il triomphe de ce
dernier adversaire : Rome condamne le livre de Fénelon.
Mais le
vainqueur est déjà près de la tombe.
Il a soixante-quinze ans.
Son activité, cependant,
est toujours égale.
Il entretient avec Leibniz une longue correspondance sur la possibilité d'une
rentrée des luthériens dans l'Église romaine.
Il dénonce à Rome les théories du cardinal Sfondrata
sur le salut des enfants morts sans baptême.
Il s'indigne des concessions que font les Jésuites aux
rites païens dans l'Inde et dans la Chine.
Il termine contre Richard Simon la Défense de la Tra
dition.
Il fait condamner, par l'Assemblée du Clergé, cent vingt-sept propositions relâchées des
casuistes.
Il combat à la fois les Jésuites et ses anciens amis, les Jansénistes.
Il est sans cesse sur la
brèche, mais ne suffit plus à la tâche.
Les ennemis de l'orthodoxie sont toujours plus nombreux, plus
divers, plus audacieux.
Il n'a plus l'appui du gouvernement, ni de l'opinion.
Sa sévérité augmente,
comme sa rigueur et son étroitesse.
Plus il sent le terrain céder sous ses pas et plus il se montre
intransigeant et dur.
C'est au point qu'il s'effraie peut-être lui-même de son intolérance.
Le
12 avril 1704, il meurt des suites d'une douloureuse maladie, qui ne l'empêcha jamais pourtant
de travailler encore et toujours.
Il ne s'était pas décidé, semble-t-il, à publier ce terrible Traité
de la Concupiscence, complément des Maximes sur la Comédie, où, déclarant que Dieu exige tout, il
en vient à condamner ambition et gloire, raison, science et poésie, aussi bien les plaisirs de l'esprit
que ceux des sens, en un mot tout ce qui est de la chair et du monde.
Mais on le publia pour lui,
de sorte qu'il continua son sacerdoce au-delà de la tombe avec plus de rudesse que jamais.
ETRANGE carrière d'écrivain : il dévoua sa vie à la défense de sa foi et maintenant que sont
mortes les circonstances
qui rendaient nécessaire la défense de cette foi, maintenant que cette
foi elle-même, affaiblie
ou transformée, ne saurait plus être défendue par les arguments qu'il
employa, ses œuvres restent, à cause de la seule beauté de leur style et de la joie qu'on en retire,
incontestablement
une des voluptés mensongères qu'il trouva jusqu'au bout des forces et des
raisons
pour condamner.
ROGER CAILLOIS.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Oraison Funèbre, Bossuet « Un symbole de libération »
- BOSSUET (1627-1704) SERMONS CHOISIS. - ORAISONS FUNÈBRES. OEUVRES DIVERSES
- DISCOURS SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE Jacques Bénigne Bossuet (résumé & analyse)
- SERMONS, de Bossuet
- SERMONS de Jacques-Bénigne Bossuet (résumé & analyse)