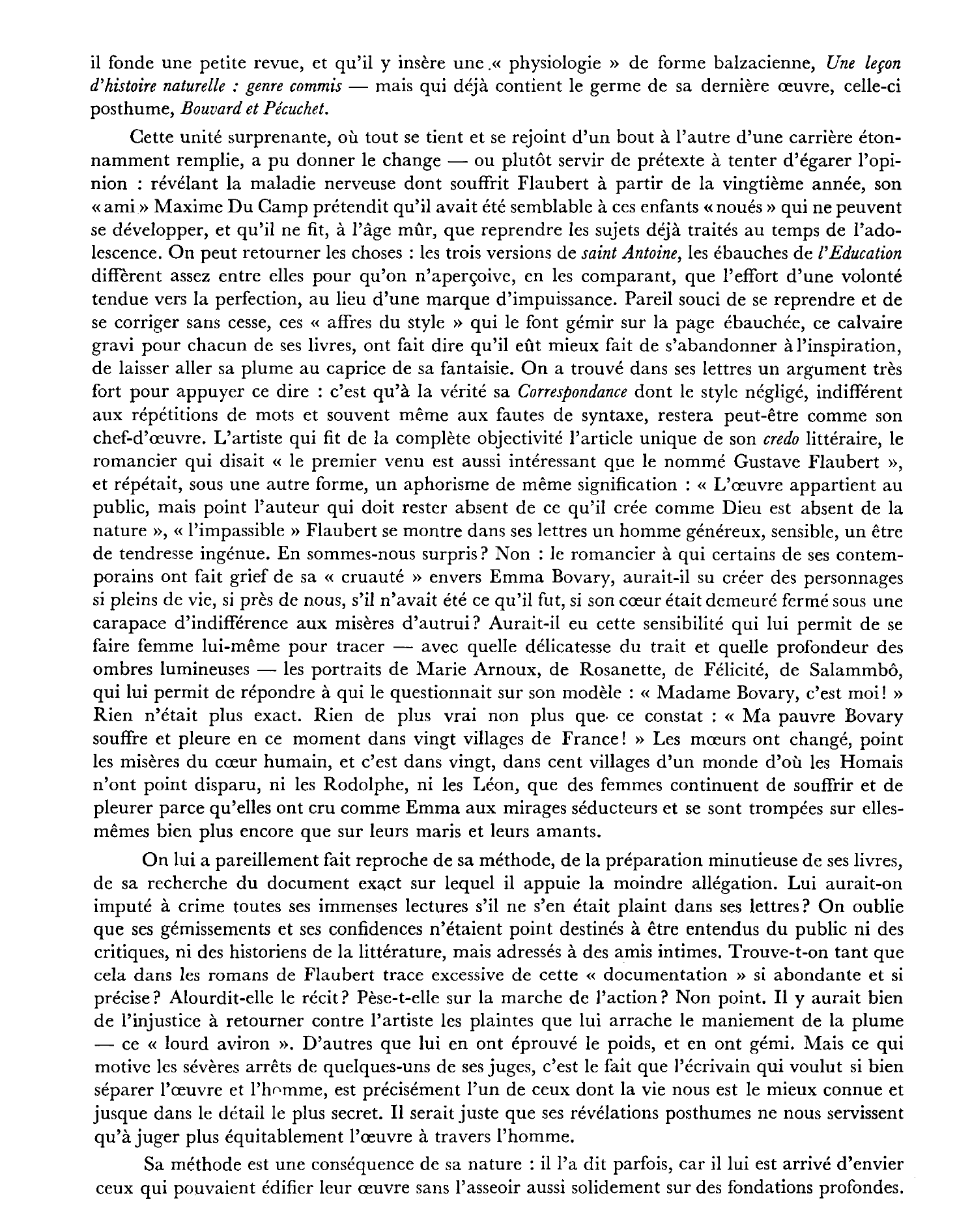FLAUBERT, Gustave
Publié le 22/04/2012

Extrait du document

(12 décembre 1821-8 mai 1880)
Ecrivain
Une première crise d’épilepsie lui interdit en 1844 de poursuivre ses études de droit. Il fait entre 1849 et 1851, en compagnie de son ami Maxime Du CampF269A, un voyage en Orient. A son retour en France il partage sa vie entre la propriété familiale de Croisset, en Normandie, et Paris. Il entretient avec ses amis Théophile GautierF270B, George SandF255, et plus tard avec les frères GoncourtF271A, MaupassantF289C et DaudetF270D, une importante correspondance. La publication en 1857 de Madame Bovary lui vaut d’être inculpé pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il est cependant acquitté. Ami de la princesse Mathilde, invité chez l’empereur Napoléon IIIF259 à Compiègne, il reçoit la Légion d’honneurO519 en 1866. Trois ans plus tard paraît L’Education sentimentale. Après la publication d’une troisième version de La Tentation de saint Antoine et un échec au théâtre, Flaubert entreprend Bouvard et Pécuchet, qui ne paraît qu’après sa mort.

«
il fonde une petite revue, et qu'il y insère une.« physiologie » de forme balzacienne, Une lefon
d'histoire naturelle :genre commis- mais qui déjà contient le germe de sa dernière œuvre, celle-ci
posthume,
Bouvard et Pécuchet.
Cette unité surprenante, où tout se tient et se rejoint d'un bout à l'autre d'une carrière éton
namment remplie, a pu donner le change- ou plutôt servir de prétexte à tenter d'égarer l'opi
nion : révélant la maladie nerveuse dont souffrit Flaubert à partir de la vingtième année, son
«ami>> Maxime Du Camp prétendit qu'il avait été semblable à ces enfants «noués» qui ne peuvent
se développer, et qu'il ne fit, à l'âge mûr, que reprendre les sujets déjà traités au temps de l'ado
lescence.
On peut retourner les choses :les trois versions de saint Antoine, les ébauches de l'Education
diffèrent assez entre elles pour qu'on n'aperçoive, en les comparant, que l'effort d'une volonté
tendue vers la perfection, au lieu d'une marque d'impuissance.
Pareil souci de se reprendre et de
se corriger sans cesse, ces « affres du style » qui le font gémir sur la page ébauchée, ce calvaire
gravi
pour chacun de ses livres, ont fait dire qu'il eût mieux fait de s'abandonner à l'inspiration,
de laisser aller sa plume au caprice de sa fantaisie.
On a trouvé dans ses lettres un argument très
fort
pour appuyer ce dire : c'est qu'à la vérité sa Correspondance dont le style négligé, indifférent
aux répétitions de mots et souvent même aux fautes de syntaxe, restera peut-être comme son
chef-d'œuvre.
L'artiste qui fit de la complète objectivité l'article unique de son credo littéraire, le
romancier qui disait « le premier venu est aussi intéressant qJ.le le nommé Gustave Flaubert »,
et répétait, sous une autre forme, un aphorisme de même signification : « L'œuvre appartient au
public, mais point l'auteur qui doit rester absent de ce qu'il crée comme Dieu est absent de la
nature », « l'impassible » Flaubert se montre dans ses lettres un homme généreux, sensible, un être
de tendresse ingénue.
En sommes-nous surpris? Non : le romancier à qui certains de ses contem
porains
ont fait grief de sa « cruauté » envers Emma Bovary, aurait-il su créer des personnages
si pleins
de vie, si près de nous, s'il n'avait été ce qu'il fut, si son cœur était demeuré fermé sous une
carapace d'indifférence aux misères d'autrui? Aurait-il eu cette sensibilité qui lui permit de se
faire femme lui-même pour tracer -avec quelle délicatesse du trait et quelle profondeur des
ombres lumineuses
-les portraits de Marie Arnoux, de Rosanette, de Félicité, de Salammbô,
qui lui permit de répondre à qui le questionnait sur son modèle :«Madame Bovary, c'est moi! »
Rien n'était plus exact.
Rien de plus vrai non plus que· ce constat : « Ma pauvre Bovary
souffre
et pleure en ce moment dans vingt villages de France! » Les mœurs ont changé, point
les misères du cœur humain, et c'est dans vingt, dans cent villages d'un monde d'où les Harnais
n'ont point disparu, ni les Rodolphe, ni les Léon, que des femmes continuent de souffrir et de
pleurer parce qu'elles ont cru comme Emma aux mirages séducteurs et se sont trompées sur elles
mêmes
bien plus encore que sur leurs maris et leurs amants.
On lui a pareillement fait reproche de sa méthode, de la préparation minutieuse de ses livres,
de sa recherche
du document exact sur lequel il appuie la moindre allégation.
Lui aurait-on
imputé à crime toutes ses immenses lectures s'il ne s'en était plaint dans ses lettres? On oublie
que ses gémissements et ses confidences n'étaient point destinés à être entendus du public ni des
critiques, ni des historiens de
la littérature, mais adressés à des amis intimes.
Trouve-t-on tant que
cela dans les romans de Flaubert trace excessive de cette « documentation » si abondante et si
précise? Alourdit-elle le récit? Pèse-t-elle sur la marche de l'action? Non point.
Il y aurait bien
de l'injustice à retourner contre l'artiste les plaintes que lui arrache le maniement de la plume
-ce « lourd aviron ».
D'autres que lui en ont éprouvé le poids, et en ont gémi.
Mais ce qui
motive les sévères arrêts de quelques-uns de ses juges, c'est le fait que l'écrivain qui voulut si bien
séparer l'œuvre et l'h~'mme, est précisément l'un de ceux dont la vie nous est le mieux connue et
jusque dans le détail le plus secret.
Il serait juste que ses révélations posthumes ne nous servissent
qu'àjuger plus équitablement l'œuvre à travers l'homme.
Sa méthode est une conséquence de sa nature : il l'a dit parfois, car il lui est arrivé d'envier
ceux qui pouvaient édifier leur œuvre sans l'asseoir aussi solidement sur des fondations profondes..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire: Gustave Flaubert - Madame Arnoux et Frédéric
- L’Idiot de la famille : Gustave Flaubert, de 1821 à 1857 (fiche de lecture)
- Fiche de lecture : SALAMMBÔ de Gustave Flaubert
- L’Éducation sentimentale Histoire d’un jeune homme de Gustave Flaubert (analyse détaillée)
- Analyse de Madame Bovary de Gustave Flaubert