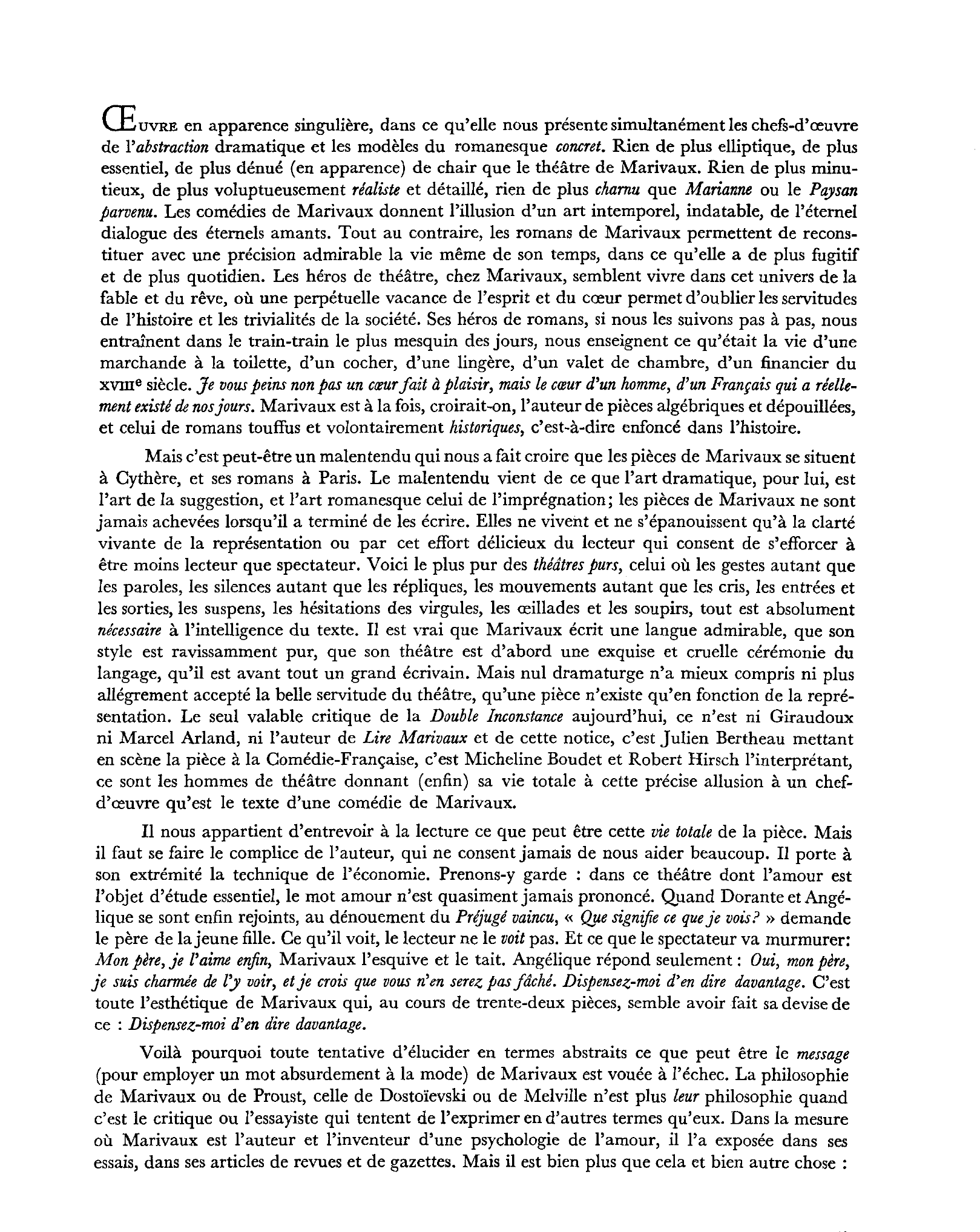MARIVAUX
Publié le 02/09/2013

Extrait du document

1688-1763
RIEN n'est plus mince que le fil d'un rasoir, rien ne tranche moins (si on en voit seulement l'épaisseur) sur ce qui entoure. Rien n'est cependant plus fort, ni plus tranchant. Ainsi de l'oeuvre de Marivaux. Elle semble mince, à qui voit mal; elle semble se confondre avec ce qui l'entoure, à qui est myope. Marivaux paraît avoir si bien la couleur de son temps, qu'on l'en distingue à peine. Il brille si gracieusement, que l'on s'aperçoit malaisément de ce qu'il a de redoutable. On se sert de son théâtre pour inventer un mot : le marivaudage, qu'on en vient à confondre avec le vrai génie de Marivaux. On finit par croire que ses pièces sont de bijouteries, que leur fini est un peu court, leur poli de seule politesse, leur élégance un peu vaine, leur précision comme futile. Ce théâtre sans un grand mot, on s'abuse jusqu'à y voir un théâtre sans grande substance. Ces personnages bien élevés qui sortent du salon pour entrer sur la scène, qui ont l'air de danser un ballet courtois, réglé avec toutes les précautions du goût et toutes les ressources de la finesse, qui préfèrent sourire plutôt que de hurler, dont les chagrins badinent et dont les désespoirs tracent des arabesques vives et maigres, ces personnages qui ont trop l'air de n'être que des personnages, deux siècles hésitent, jusqu'à nous, à les prendre au sérieux. Peut-on croire qu'Arlequin souffre, que Silvia pleure, que ces marionnettes italiennes se soutiennent par d'autres ressorts que les fils ingénieux dont le montreur feint de tenir le bout ? Il faudra longtemps pour que Marivaux échappe à sa légende et que la vraie lumière de son oeuvre se lève enfin.
Il n'y a rien dans sa vie même qui puisse aider à le mieux découvrir. De sa naissance à sa mort, Marivaux est de si bonne compagnie qu'il n'en accepte quasiment aucune; il ne livre de lui-même rien, ou presque. Il est plus facile d'écrire la biographie de Marianne ou de Lelio, du Paysan parvenu ou d'Arlequin, que celle de Pierre Carlet Chamblain de Marivaux. On lui suppose des amours, on lui prête des passions, on lui imagine des soucis. Mais il ne donne prise ni au romanesque, ni même à la curiosité. On ne s'aperçoit presque pas qu'un homme ne dit mot, quand il écoute attentivement, écrit-il quelque part. Il semble que sa vie se soit passée à écouter attentivement. On s'est à peine aperçu qu'il était là. Il a fait de la littérature sa vie. Normand, comme Corneille, il n'a pas un destin plus héroïque que celui de l'auteur du Cid. Il a de la fortune, il la perd. Il se marie, sa femme meurt. Il a une fille, et c'est le seul personnage de Marivaux qui semble n'avoir jamais marivaudé, puisqu'elle entre au couvent.

«
CEUVRE en apparence singulière, dans ce qu'elle nous présente simultanément les chefs-d'œuvre
de l'abstraction dramatique et les modèles du romanesque concret.
Rien de plus elliptique, de plus
essentiel, de plus
dénué (en apparence) de chair que le théâtre de Marivaux.
Rien de plus minu
tieux, de plus voluptueusement réaliste et détaillé, rien de plus charnu que Marianne ou le Paysan
parvenu.
Les comédies de Marivaux donnent l'illusion d'un art intemporel, indatable, de l'éternel
dialogue des éternels amants.
Tout au contraire, les romans de Marivaux permettent de recons
tituer avec une précision admirable la vie même de son temps, dans ce qu'elle a de plus fugitif
et de plus quotidien.
Les héros de théâtre, chez Marivaux, semblent vivre dans cet univers de la
fable et du rêve, où une perpétuelle vacance de l'esprit et du cœur permet d'oublier les servitudes
de l'histoire et les trivialités de la société.
Ses héros de romans, si nous les suivons pas à pas, nous
entraînent dans le train-train le plus mesquin des jours, nous enseignent ce qu'était la vie d'une
marchande à la toilette, d'un cocher, d'une lingère, d'un valet de chambre, d'un financier du
xvme siècle.
Je vous peins non pas un cœur fait à plaisir, mais le cœur d'un homme, d'un Français qui a réelle
ment existé de nos jours.
Marivaux est à la fois, croirait-on, l'auteur de pièces algébriques et dépouillées,
et celui de romans touffus et volontairement historiques, c'est-à-dire enfoncé dans l'histoire.
Mais c'est peut-être
un malentendu qui nous a fait croire que les pièces de Marivaux se situent
à
Cythère, et ses romans à Paris.
Le malentendu vient de ce que l'art dramatique, pour lui, est
l'art de la suggestion, et l'art romanesque celui de l'imprégnation; les pièces de Marivaux ne sont
jamais achevées lorsqu'il a terminé de les écrire.
Elles ne vivent et ne s'épanouissent qu'à la clarté
vivante de la représentation
ou par cet effort délicieux du lecteur qui consent de s'efforcer à
être moins lecteur
que spectateur.
Voici le plus pur des théâtres purs, celui où les gestes autant que
les paroles, les silences autant que les répliques, les mouvements autant que les cris, les entrées et
les sorties, les suspens, les hésitations des virgules, les œillades et les soupirs, tout est absolument
nécessaire à l'intelligence du texte.
Il est vrai que Marivaux écrit une langue admirable, que son
style est ravissamment
pur, que son théâtre est d'abord une exquise et cruelle cérémonie du
langage, qu'il est avant tout un grand écrivain.
Mais nul dramaturge n'a mieux compris ni plus
allégrement accepté
la belle servitude du théâtre, qu'une pièce n'existe qu'en fonction de la repré
sentation.
Le seul valable critique de la Double Inconstance aujourd'hui, ce n'est ni Giraudoux
ni Marcel Arland, ni l'auteur de Lire Marivaux et de cette notice, c'est Julien Bertheau mettant
en scène la pièce à la Comédie-Française, c'est Micheline Boudet et Robert Hirsch l'interprétant,
ce sont les hommes de théâtre donnant (enfin) sa vie totale à cette précise allusion à un chef
d'œuvre qu'est le texte d'une comédie de Marivaux.
Il nous appartient d'entrevoir à la lecture ce que peut être cette vie totale de la pièce.
Mais
il faut se faire le complice
de l'auteur, qui ne consent jamais de nous aider beaucoup.
Il porte à
son extrémité
la technique de l'économie.
Prenons-y garde : dans ce théâtre dont l'amour est
l'objet
d'étude essentiel, le mot amour n'est quasiment jamais prononcé.
Quand DoranteetAngé
lique se sont enfin rejoints, au dénouement du Préjugé vaincu, « (lue signifie ce que je vois? » demande
le père de la jeune fille.
Ce qu'il voit, le lecteur ne le voit pas.
Et ce que le spectateur va murmurer:
Mon pere, je l'aime enfin, Marivaux l'esquive et le tait.
Angélique répond seulement: Oui, mon pere,
je suis charmée de l'y voir, etje crois que vous n'en serezpasfâché.
Dispensez-moi d'en dire davantage.
C'est
toute l'esthétique de Marivaux qui, au cours de trente-deux pièces, semble avoir fait sa devise de
ce :
Dispensez-moi d'en dire davantage.
Voilà pourquoi toute tentative d'élucider en termes abstraits ce que peut être le message
(pour employer un mot absurdement à la mode) de Marivaux est vouée à l'échec.
La philosophie
de
Marivaux ou de Proust, celle de Dostoïevski ou de Melville n'est plus leur philosophie quand
c'est le critique ou l'essayiste qui tentent de l'exprimer en d'autres termes qu'eux.
Dans la mesure
où Marivaux est l'auteur et l'inventeur d'une psychologie de l'amour, il l'a exposée dans ses
essais, dans ses articles de revues et de gazettes.
Mais il est bien plus que cela et bien autre chose :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) - Résumé de la pièce
- Marivaux - les fausses confidences (1737) scène 14 - acte I
- Lecture linéaire : Le piège d’Araminte. Acte II scène 13, Les fausses Confidences, Marivaux
- Analyse linéaire Marivaux fausses confidences: Acte I, Scène 2
- Texte 3, Marivaux, Les Fausses Confidences, Acte 3, scène 12