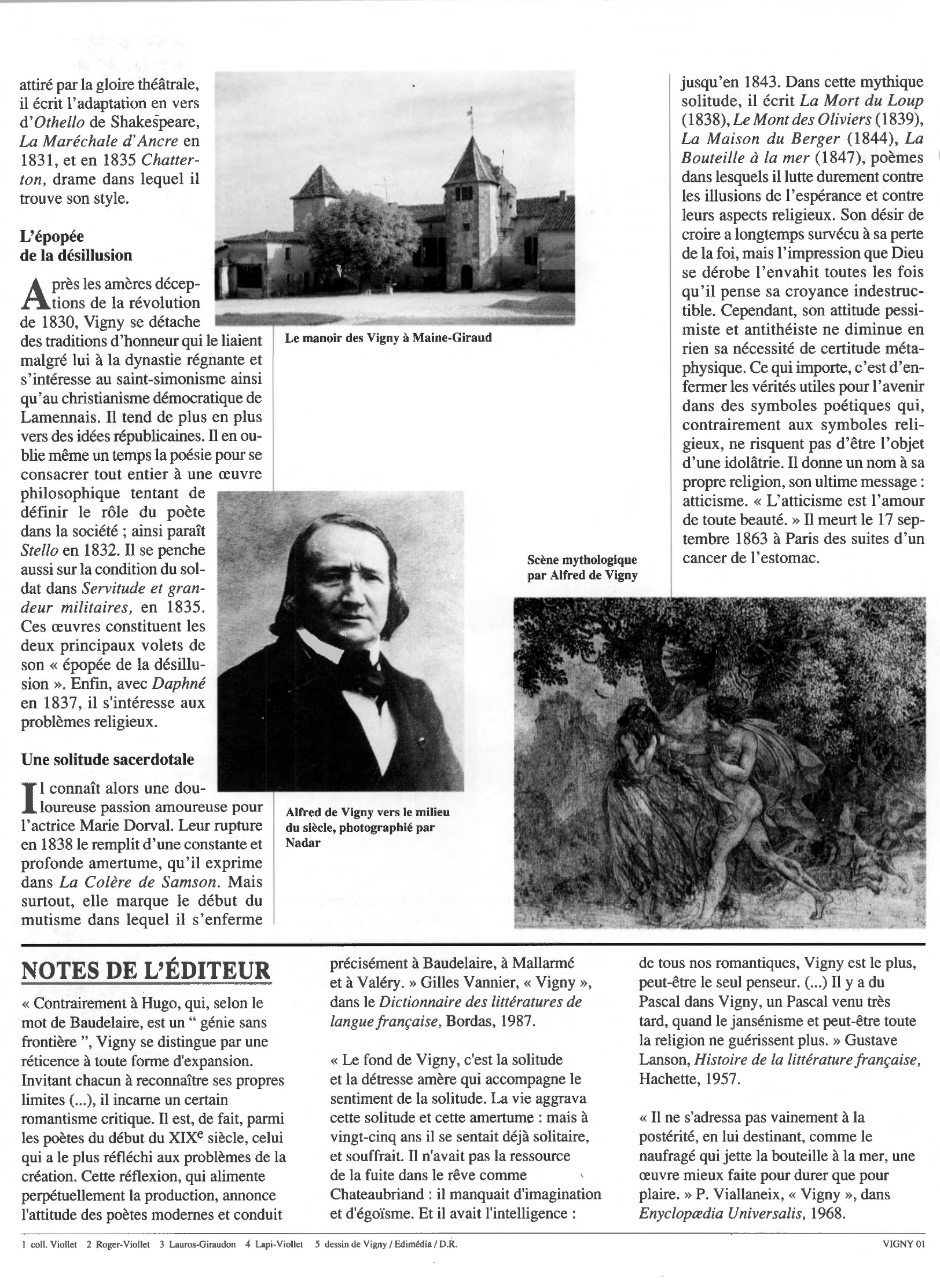Vigny
Publié le 08/04/2013

Extrait du document
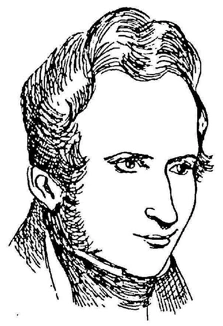
Vigny écrit dans le Journal d'un poète:« La vérité sur la vie, c'est le désespoir. Il est bon et salutaire de n'avoir aucune espérance.« Le Cénacle est un salon littéraire parisien qui se constitua, de 1823 à 1828, d'abord chez Charles Nodier, ensuite chez Victor Hugo, pour définir les idées du romantisme naissant et lutter contre le formalisme classique. Louis Ratisbonne, l'exécuteur testamentaire de Vigny, rassembla en 1864, dans un recueil intitulé Les Destinées, les poèmes parus dans la Revue des Deux Mondes depuis 1834, et ceux qui étaient restés inédits. De même, les impressions écrites des dix dernières années de la vie de Vigny ont été regroupées dans le Journal d'un poète.
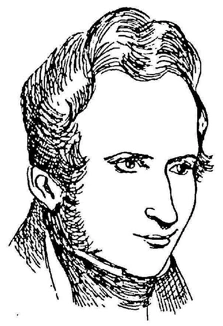
«
attiré par la gloire théâtrale,
il écrit l'adaptation
en vers
d 'Othello de Shakespeare,
la Maréchale d' Ancre en
1831 , et en 1835 Chatter
ton,
drame dans lequel il
trouve son style.
L'épopée
de la désillusion
A
près les amères décep
tions
de la révolution
de 1830, Vigny se détache
des traditions
d'honneur qui le liaient
malgré lui
à la dynastie régnante et
s'intéresse au saint-simonisme ainsi
qu'au christianisme démocratique de
Lamennais.
Il tend de plus en plus
vers des idées républicaines.
Il en ou
blie
même un temps la poésie pour se
consacrer tout entier à une œuvre
philosophique tentant de
définir le rôle du poète
dans la société ; ainsi paraît
Stello en 1832.
Il se penche
aussi sur la condition du sol
dat dans
Servitude et gran
deur militaires ,
en 1835.
Ces œuvres constituent les
deux principaux volets de
son « épopée de la désillu
sion».
Enfin, avec Daphné
en 1837, il s'intéresse aux
problèmes religieux.
Une solitude sacerdotale
1
1 connaît alors une dou
loureuse passion amoureuse pour
l'actrice Marie Dorval.
Leur rupture
en 1838 le remplit d'une constante et
profonde amertume, qu'il exprime
dans la Colère de Samson .
Mais
surtout, elle marque le début du
mutisme dans lequel il s' enferme
NOTES DE L'ÉDITEUR
« Contrairement à Hugo, qui, selon le
mot de Baudelaire, est un
" génie sans
frontière ", Vigny se distingue par une
réticence à toute forme d'expansion .
Invitant chacun
à reconnaître ses propres
limites ( ..
.
), il incarne
un certain
romantisme critique.
Il est, de fait , parmi
les poètes du début du XIXe siècle, celui
qui a le plus réfléchi aux problèmes de la
création.
Cette réflexion, qui alimente
perpétuellement la production, annonce
l'attitude des poètes modernes et conduit
Le manoir des Vigny à Maine-Giraud
Alfred de Vigny vers
le milieu
du siècle, photographié par Nadar
Scène mythologique par Alfred de Vigny
précisément à Baudelaire, à Mallarmé
et à Valéry.
»Gilles Vannier, « Vigny »,
dans le Dictionnaire des littératures de
lan gue française, Bordas, 1987.
«Le fond de Vigny, c'est la solitude
et la détresse amère qui accompagne le
sentiment de la solitude.
La vie aggrava
cette solitude et cette amertume : mais à
vingt-cinq ans il se sentait déjà solitaire,
et souffrait.
Il n'avait pas la ressource
de la fuite dans le rêve comme
Chateaubriand : il manquait d'imagination
et d'égoïsme.
Et
il avait l'intelligence :
1 coll.
Viollet 2 Roger-Viollet 3 Lauros-Giraudon 4 Lapi-Viollet
5 dessin de Vigny/ Edimédia / D.R.
jusqu'en 1843.
Dans cette mythique
solitude, il écrit la Mort du loup
(1838), le Mont des Oliviers (1839) ,
la Maison du Berger (1844 ), la
Bouteille à la mer (1847) , poèmes
dans lesquels il lutte durement contre
les illusions de l'espérance
et contre
leurs aspects religieux.
Son désir de
croire a longtemps survécu
à sa perte
de
la foi, mais l'impression que Dieu
se
dérobe l'envahit toutes les fois
qu'il pense sa croyance indestruc
tible.
Cependant, son attitude pessi
miste et antithéiste ne diminue en
rien sa nécessité de certitude méta
physique.
Ce qui importe, c'est d'en
fermer les vérités utiles pour l'avenir
dans des symboles poétiques qui,
contrairement aux symboles reli
gieux, ne risquent pas d'être l'objet
d'une idolâtrie.
Il donne un nom à sa
propre religion , son ultime message :
atticisme.
« L'atticisme est l'amour
de toute beauté.
» Il meurt le 17 sep
tembre 1863
à Paris des suites d'un
cancer de l'estomac.
de tous nos romantiques, Vigny est le plus,
peut-être le seul penseur.
( ..
.
) Il y a du
Pascal dans Vigny, un Pascal venu très
tard, quand le jansénisme et peut-être toute
la religion ne guérissent plus.
» Gustave
Lanson,
H istoire de la littérature frança ise,
Hachette , 1957.
« Il ne s'adressa pas vainement à la
postérité, en lui destinant, comme le
naufragé qui jette la bouteille à la mer , une
œuvre mieux faite pour durer que pour
plaire.
» P.
Viallaneix, «Vigny », dans
Enyclopœdia Universalis, 1968.
VJGNYOI.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture : SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES Alfred de Vigny
- Cinq-Mars. Roman d'Alfred de Vigny (analyse détaillée)
- Poèmes antiques et modernes, recueil d'Alfred de Vigny
- Le personnage de BELL Kitcy d’Alfred de Vigny
- CHATTERTON de A. de Vigny