Les Paravents, Genet : Fiche de lecture
Publié le 13/12/2018
Extrait du document
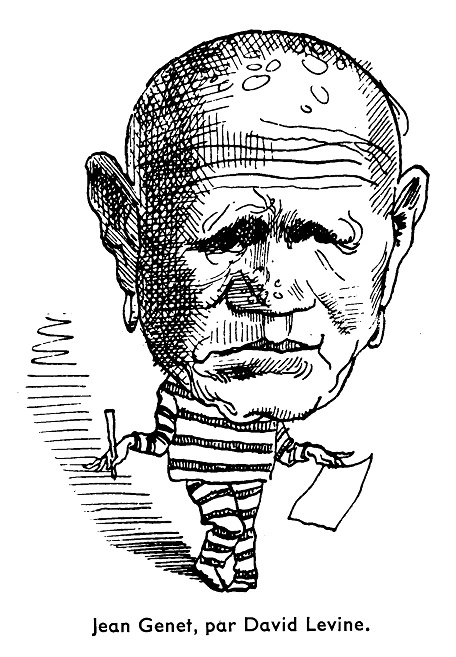
Les Paravents
Jouée dans son intégralité, cette pièce constituerait un spectacle de plus de cinq heures. C’est pourquoi elle sera créée dans différentes versions abrégées, d’abord à Berlin-Ouest en 1961, puis à Londres en 1964. En 1964 également la version intégrale sera présentée à Stockholm. Paris ne verra la pièce qu’en 1966, dans une version pour la scène mise au point par l’auteur et par le metteur en scène, Roger Blin. La dimension satirique et provocatrice de l’œuvre, qui montre et les colons français et l’armée en Algérie sous un jour violemment caricatural, explique que les Paravents n’aient pas été joués plus tôt à Paris.
Vingt-cinq tableaux, une centaine de personnages... L'action éclate, s’organise autour de plusieurs groupes : le trio des Algériens, Saïd, sa mère et sa femme, Leïla, la plus laide d’entre toutes les femmes; les prostituées du bordel dirigé par Warda; les représentants guignoles-ques de la colonisation; ceux de l’armée française, à travers qui s’affirme, à la fois sauvage et précieux, un érotisme de la guerre; enfin le peuple des morts.
Crevant les paravents de papier qui définissent l’espace du jeu théâtral — et qui donnent leur nom à la pièce
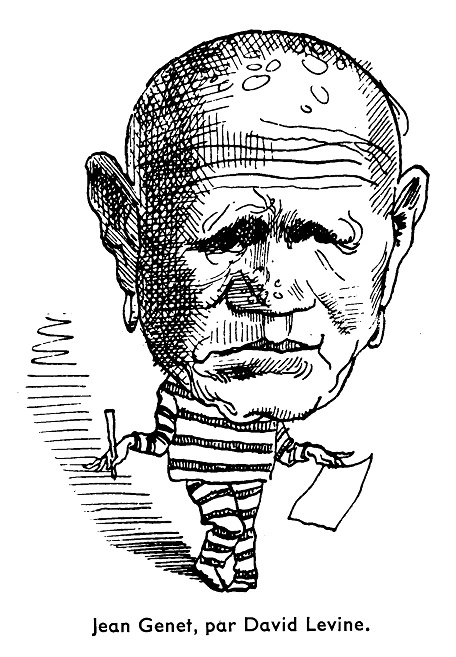
«
-.
les
morts se rassemblent, lavés de leurs passions et
de leurs folies de vivants, colons et maquisards, Arabes
et Français.
Ils se font les spectateurs, attentifs et déta
chés, de la scène des vivants, scène où Saïd, voleur,
incendiaire, délateur, assassin, va achever ce parcours de
l'abjection qui doit le conduire à la sainteté.
Toutefois, la pièce est peut-être un aveu d'échec de
ce rêve de sanctification et d'inhumanisation : Warda
voulait devenir signe pur, archétype de la Putain, figure
somptueuse et inutile.
Mais la réalité de la guerre ruine
ces efforts d'apothéose et ramène Warda à son ordinaire
fonction prostitutionnelle.
De même, Saïd sera abattu par
les maquisards sans que sa « sainteté » ait été, par eux,
reconnue et célébrée.
C'est que la Révolution qui détruit
un Ordre procède elle-même d'un Ordre idéal pour
déboucher sur une nouvelle organisation du monde.
Elle
ne peut donc admettre la négativité comme valeur.
La
réalité ne peut tolérer son inversion : « Certaines vérités
sont inapplicables, sinon elles mourraient.
..
Elles ne doi
vent pas mourir, mais vivre par le chant qu'elles sont
devenues ...
Vive le chant! »
L'apparence et l'imposture deviennent, à leur tour,
instruments de domination, c'est-à-dire qu'elles sont
comme « récupérées » par le réel : la société des colons
se donne en spectacle, dans une mascarade grotesque,
mimant le jeu social qui produit du pouvoir et de l'op
pression.
De même les « paras >> doivent-ils leur victoire
à leur beauté, c'est-à-dire encore à l'apparence.
Car
« vaincre >>, c'est >
La problématique du jeu de l'acteur est également
tributaire de cette esthétique.
Genet aurait voulu que ses
personnages fussent masqués ou, du moins, maquillés de
façon excessive, que les comédiens osent «des gestes
admirables sans rapport avec ceux qu'[ils ont) dans la
vie >>.
De même, la diction devrait faire éclater les limites
étroites du mimétisme psychologique pour devenir
déclamation et chant : «Au texte des Paravents devrait
être joint quelque chose ressemblant à une partition.
C'est possible.
Le metteur en scène, tenant compte des
différents timbres de voix, inventera un mode de décla
mation allant du murmure au cri.
Des phrases, des tor
rents de phrases doivent passer dans des hurlements,
d'autres seront roucoulées, d'autres seront dites sur le
ton de l'habituelle conversation».
En fin de compte, dans l'évolution de Genet, les Para
vents constituent peut-être à la fois un aboutissement et
une impasse dans la tentative visant à promouvoir un
théâtre qui ait la force explosive d'un événement vécu, à
faire de la scène le lieu d'une déflagration dont Genet
rêve «qu'elle soit si forte et si dense qu'elle illumine,
par ses prolongements, le monde des morts -des mil
liards de milliards -et celui des vivants qui viendront ».
Ce rêve, qui n'est pas sans rappeler celui d'Artaud- ce n'est
sans doute pas un hasard si le metteur en scène
favori de Genet est Roger Blin, qui fut très proche de
l'auteur du Théâtre et son double -, ce rêve ne cesse de
se briser sur la matérialité même du théâtre occidental et
sur ses traditions..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Paravents, les [Jean Genet] - Fiche de lecture.
- GENET: LES PARAVENTS (Analyse et fiche de lecture)
- BONNES (les) de Jean Genet (fiche de lecture et critique)
- Bonnes, les [Jean Genet] - Fiche de lecture.
- Saint Genet, comédien et martyr [Jean-Paul Sartre] - Fiche de lecture.










