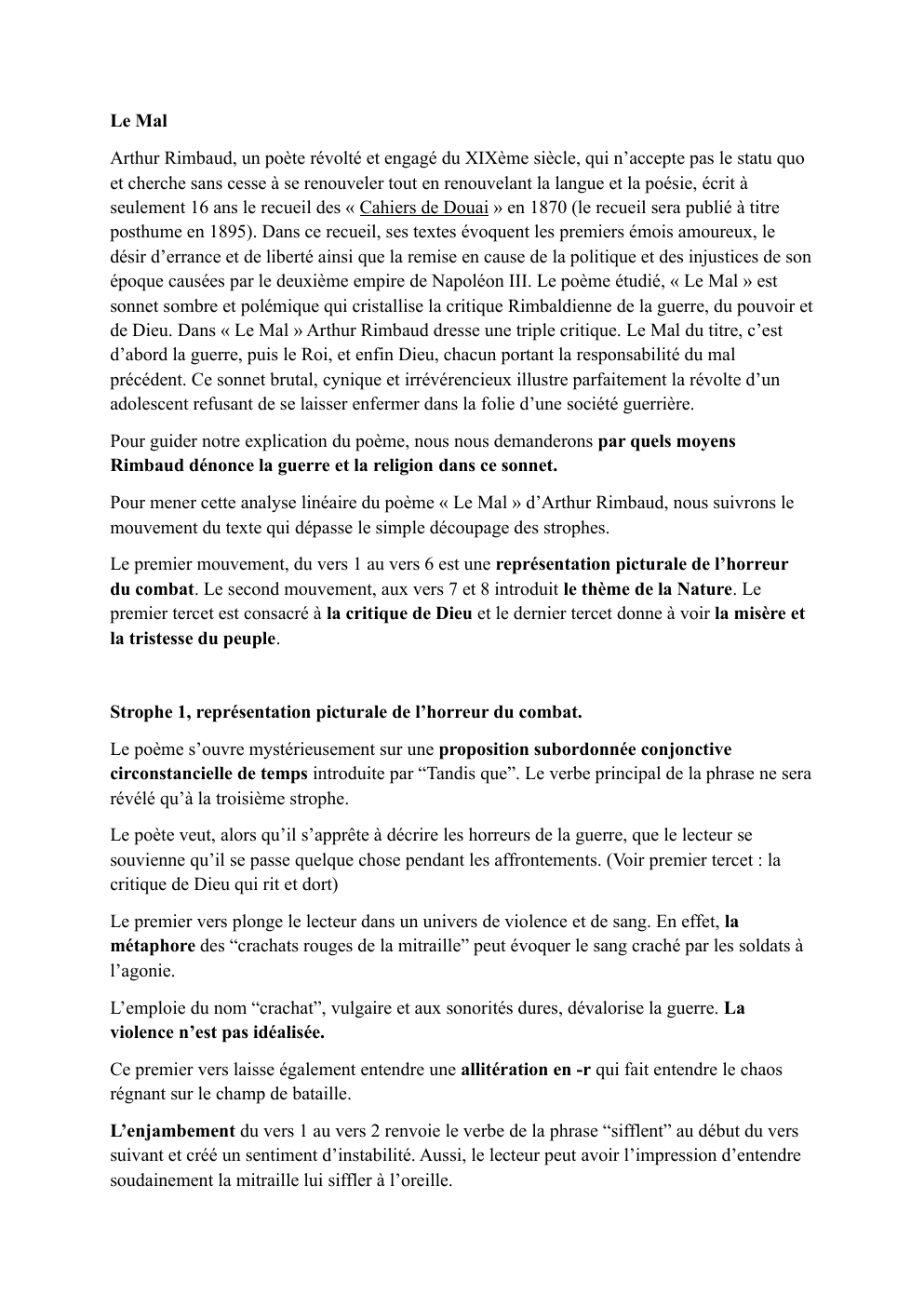analyse lineaire Le Mal rimbaud
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Le Mal
Arthur Rimbaud, un poète révolté et engagé du XIXème siècle, qui n’accepte pas le statu quo
et cherche sans cesse à se renouveler tout en renouvelant la langue et la poésie, écrit à
seulement 16 ans le recueil des « Cahiers de Douai » en 1870 (le recueil sera publié à titre
posthume en 1895).
Dans ce recueil, ses textes évoquent les premiers émois amoureux, le
désir d’errance et de liberté ainsi que la remise en cause de la politique et des injustices de son
époque causées par le deuxième empire de Napoléon III.
Le poème étudié, « Le Mal » est
sonnet sombre et polémique qui cristallise la critique Rimbaldienne de la guerre, du pouvoir et
de Dieu.
Dans « Le Mal » Arthur Rimbaud dresse une triple critique.
Le Mal du titre, c’est
d’abord la guerre, puis le Roi, et enfin Dieu, chacun portant la responsabilité du mal
précédent.
Ce sonnet brutal, cynique et irrévérencieux illustre parfaitement la révolte d’un
adolescent refusant de se laisser enfermer dans la folie d’une société guerrière.
Pour guider notre explication du poème, nous nous demanderons par quels moyens
Rimbaud dénonce la guerre et la religion dans ce sonnet.
Pour mener cette analyse linéaire du poème « Le Mal » d’Arthur Rimbaud, nous suivrons le
mouvement du texte qui dépasse le simple découpage des strophes.
Le premier mouvement, du vers 1 au vers 6 est une représentation picturale de l’horreur
du combat.
Le second mouvement, aux vers 7 et 8 introduit le thème de la Nature.
Le
premier tercet est consacré à la critique de Dieu et le dernier tercet donne à voir la misère et
la tristesse du peuple.
Strophe 1, représentation picturale de l’horreur du combat.
Le poème s’ouvre mystérieusement sur une proposition subordonnée conjonctive
circonstancielle de temps introduite par “Tandis que”.
Le verbe principal de la phrase ne sera
révélé qu’à la troisième strophe.
Le poète veut, alors qu’il s’apprête à décrire les horreurs de la guerre, que le lecteur se
souvienne qu’il se passe quelque chose pendant les affrontements.
(Voir premier tercet : la
critique de Dieu qui rit et dort)
Le premier vers plonge le lecteur dans un univers de violence et de sang.
En effet, la
métaphore des “crachats rouges de la mitraille” peut évoquer le sang craché par les soldats à
l’agonie.
L’emploie du nom “crachat”, vulgaire et aux sonorités dures, dévalorise la guerre.
La
violence n’est pas idéalisée.
Ce premier vers laisse également entendre une allitération en -r qui fait entendre le chaos
régnant sur le champ de bataille.
L’enjambement du vers 1 au vers 2 renvoie le verbe de la phrase “sifflent” au début du vers
suivant et créé un sentiment d’instabilité.
Aussi, le lecteur peut avoir l’impression d’entendre
soudainement la mitraille lui siffler à l’oreille.
Au niveau des sonorités, on retrouve à deux reprises le -f (sifflent ; infini) qui imite le bruit
des balles frôlant les soldats.
Le lecteur se retrouve donc immergé dans l’horreur du combat.
Rimbaud insiste sur le fait que les soldats n’ont aucun repos.
Il utilise l’hyperbole “tout le
jour” pour montrer que le combat ne faiblit à aucun moment.
Pourtant, une couleur douce et rassurante subsiste, il s’agit de “l’infini du ciel bleu”.
Ici, le
poète prépare son évocation de la Nature divine et salvatrice.
Cependant, l’apaisement du bleu n’est que de courte durée puisque le rouge revient, encore
plus intense, au vers 3 avec l’adjectif “écarlates”.
On comprend que la guerre efface la nature.
Au niveau des couleurs, le rouge est omniprésent : “rouges” ; “écarlates” ; “feu”.
Il illustre la
violence, le sang et le mal en général.
On note également la présence du vert avec l’adjectif “verts”.
Il fait référence à la couleur de
l’uniforme des soldats prussiens (les français sont en rouge).
Rimbaud déplore les pertes
inutiles dans les deux camps.
Cette première strophe revêt donc un caractère profondément pictural.
Rimbaud nous montre
une scène de combat de loin en insistant sur les couleurs : on ne distingue que le rouge du
sang, les uniformes des soldats, et le ciel bleu au-dessus.
Notons également que l’intensité du tableau est renforcée par le champ lexical de la guerre :
“crachats rouges ” ; “mitraille” ; “sifflent” ; “Roi” ; “bataillons” ; “feu”.
Au niveau des sonorités, on remarque que la liaison du -s vers le -o et l’ordre de
présentation des couleurs “écarlates ou verts” laisse entendre écarlates ouverts.
On peut
imaginer que le poète a voulu ici suggérer encore une fois la violence des combats.
Plus généralement sur le vers 3, c’est l’allitération en -r qui fait son retour et renforce la
violence un temps oubliée grâce au “ciel bleu”.
La figure du “Roi” est vivement critiquée.
Cette autorité représente en fait l’empereur
Napoléon III, et plus généralement, toute figure de tyran.
On voit qu’il ne se soucie pas des pertes humaines, au contraire il “raille” les soldats.
Cela
montre bien l’aversion de Rimbaud pour la guerre et les hommes au pouvoir qu’il tient pour
responsables.
Si le roi est mentionné de manière individuelle, ce n’est pas le cas des soldats qui sont
déshumanisés par leur nombre : ils sont des “bataillons”, “une masse” puis “cent milliers
d’hommes” et enfin un “tas fumant”.
Il est clair ici que le poète souligne le désintérêt du Roi pour ses soldats.
Ils ne sont qu’un
contingent informe, sacrifiable et remplaçable.
D’ailleurs, la métaphore filée du bucher, ou du brasier (“dans le feu” puis “tas fumant”)
suggère que les soldats ne tombent “en masse” que pour alimenter un chaos de plus en plus
grand et de plus en plus dévorant.
Ici, il ne semble pas y avoir de vainqueur.
Les vers 3 et 4 laissent entendre une assonance en -a qui peut justement évoquer les cris
d’agonie des soldats sacrifiés.
Strophe 2
Le début du deuxième quatrain réitère et poursuit la subordonnée de temps introduite par
“Tandis que”.
Le poète n’a pas terminé de peindre le chaos.
Il allonge sa phrase sans utiliser
de ponctuation forte comme pour symboliser la lutte qui s’éternise.
Ainsi, le combat déborde dans la seconde strophe, comme s’il était impossible de le
contenir en seulement 4 vers.
Le groupe nominal “une folie épouvantable” peut désigner métaphoriquement la guerre,
voire la folie du roi qui mène son pays à la boucherie.
La force de l’adjectif “épouvantable” laisse transparaître la position du poète qui se révèle
profondément choqué par l’horreur de la guerre.
L’horreur est renforcée par l’utilisation du verbe broyer à la fin du vers 5.
Le tableau de la guerre se clôt par la mort des soldats, la transformation de “cent milliers
d’hommes” (hyperbole) en “un tas fumant”.
L’emploi du verbe “faire” montre que la guerre possède un pouvoir de transformation, qui
s’apparente en fait plus à défaire qu’à réellement faire.
Enfin, le “tas fumant” parachève de déshumaniser et dévaloriser les soldats qui ne sont plus
qu’un amas de chair meurtrie.
L’adjectif “fumant” peut faire penser à un tas de fumier, ultime
dévalorisation qui insiste sur la manière dont le roi voit son peuple.
Heureusement, après avoir exposé au lecteur le tableau terrible d’une guerre sale, Rimbaud
ouvre une fenêtre d’espoir lyrique, l’espace de seulement deux vers, qui s’incarne sous les
traits de la Nature.
Le Mal analyse linéaire : le thème de la Nature
Le tiret au début du vers indique le poète prend directement la parole.
Submergé par l’horreur,
il sombre dans le registre pathétique et le lyrisme.
La ponctuation expressive (3 points d’exclamation et les points de suspension) tranche avec
le regard extérieur qui était proposé dans les 6 premiers vers.
Ici, le poète s’implique, révèle
ses sentiments.
Le groupe nominal “pauvre morts” montre pour la première fois une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Mal - Rimbaud - Analyse
- Le Mal de Rimbaud (analyse littéraire)
- ANALYSE LINEAIRE ELLE ETAIT DECHAUSSE
- ANALYSE LINEAIRE PHEDRE DE RACINE ACTE II SCENE 5
- Analyse lineaire le rouge et le noir exipit