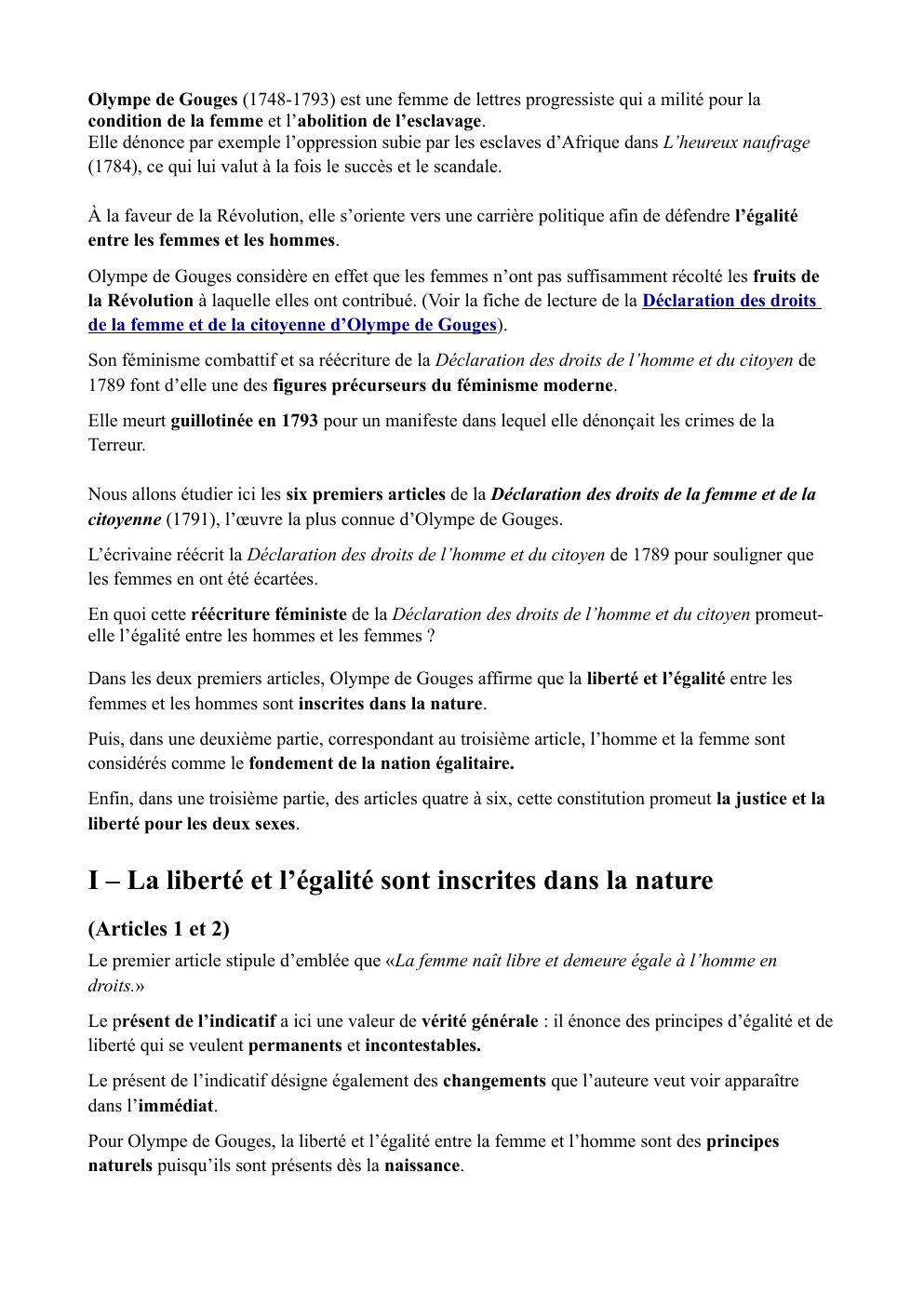comparaison DDHC et DDFC
Publié le 22/06/2025
Extrait du document
«
Olympe de Gouges (1748-1793) est une femme de lettres progressiste qui a milité pour la
condition de la femme et l’abolition de l’esclavage.
Elle dénonce par exemple l’oppression subie par les esclaves d’Afrique dans L’heureux naufrage
(1784), ce qui lui valut à la fois le succès et le scandale.
À la faveur de la Révolution, elle s’oriente vers une carrière politique afin de défendre l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Olympe de Gouges considère en effet que les femmes n’ont pas suffisamment récolté les fruits de
la Révolution à laquelle elles ont contribué.
(Voir la fiche de lecture de la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges).
Son féminisme combattif et sa réécriture de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 font d’elle une des figures précurseurs du féminisme moderne.
Elle meurt guillotinée en 1793 pour un manifeste dans lequel elle dénonçait les crimes de la
Terreur.
Nous allons étudier ici les six premiers articles de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (1791), l’œuvre la plus connue d’Olympe de Gouges.
L’écrivaine réécrit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pour souligner que
les femmes en ont été écartées.
En quoi cette réécriture féministe de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen promeutelle l’égalité entre les hommes et les femmes ?
Dans les deux premiers articles, Olympe de Gouges affirme que la liberté et l’égalité entre les
femmes et les hommes sont inscrites dans la nature.
Puis, dans une deuxième partie, correspondant au troisième article, l’homme et la femme sont
considérés comme le fondement de la nation égalitaire.
Enfin, dans une troisième partie, des articles quatre à six, cette constitution promeut la justice et la
liberté pour les deux sexes.
I – La liberté et l’égalité sont inscrites dans la nature
(Articles 1 et 2)
Le premier article stipule d’emblée que «La femme naît libre et demeure égale à l’homme en
droits.»
Le présent de l’indicatif a ici une valeur de vérité générale : il énonce des principes d’égalité et de
liberté qui se veulent permanents et incontestables.
Le présent de l’indicatif désigne également des changements que l’auteure veut voir apparaître
dans l’immédiat.
Pour Olympe de Gouges, la liberté et l’égalité entre la femme et l’homme sont des principes
naturels puisqu’ils sont présents dès la naissance.
Cette notion est très importante car Olympe de Gouges fonde sa Constitution sur la nature.
Selon
elle, l’égalité entre les sexes est naturelle mais a été pervertie par les lois humaines.
Elle souhaite
donc que les lois reconnaissent et protègent l’égalité naturelle entre les sexes.
On remarque les noms singuliers introduits par des articles définis à valeur générale : « La
femme », « l’homme ».
Ce texte de loi a une visée universaliste.
La réécriture du célèbre article premier de la DDHC de 1789 est également ironique.
Dans la DDHC de 1789, l’article premier stipule que « Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits« , les hommes représentant le genre humain.
Olympe de Gouges détourne cet article pour en faire un combat féministe où la femme lutte pour
obtenir les mêmes droits que les hommes.
Olympe de Gouges réduit ainsi le substantif « homme » de la DDHC de 1789 au genre masculin.
Quant à la femme, elle devient sujet de la phrase : « La femme naît libre et demeure égale à
l’homme en droits.«
Olympe de Gouges reprend néanmoins à l’identique la suite de l’article 1, qui reconnaît les
distinctions sociales : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune.
»
Une société peut donc demeurer égalitaire malgré l’existence d’inégalités sociales, tant que les
personnes les plus favorisées concourent au bon fonctionnement de la société (« l’utilité
commune« ).
Cet article initial est donc une réécriture quasi-littérale de l’article premier de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Mais Olympe de Gouges y donne une place à la femme.
Sa réécriture est audacieuse car l’auteure
montre que le substantif « homme » dans la DDHC de 1789, censé désigner le genre humain dans
son ensemble, participe en réalité d’une invisibilisation des femmes.
Le deuxième article réécrit également l’article 2 de la DDHC de 1789, auquel il ajoute la mention
de la femme.
En mentionnant la femme avant l’homme (« de la femme et de l’homme« ), l’auteure témoigne du
combat des femmes pour être reconnues.
Olympe de Gouges pose comme fondement de la société la défense « des droits naturels et
imprescriptibles de la femme et de l’homme ».
Les deux adjectifs (« naturels et imprescriptibles » )
insistent sur le caractère naturel de ces droits : la constitution ne fait en réalité que mettre par écrit
des principes de la nature.
Les droits fondamentaux en question « sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la
résistance à l’oppression.
»
Dans l’article 2 de la DDHC de 1789, « la résistance à l’oppression » légitime le soulèvement
populaire contre la monarchie.
Mais la réécriture de cet article par Olympe de Gouges suggère que l’oppression peut également
venir des révolutionnaires eux-mêmes.
En accordant aux femmes un droit de résistance à l’oppression, Olympe de Gouges légitime le
combat des femmes pour l’égalité entre les sexes.
II – L’homme et la femme sont au fondement de la nation
égalitaire
(Article 3)
L’article 3 porte sur la notion de nation : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
en la nation ».
Il s’agit d’une reprise littérale de l’article 3 de la DDHC de 1789.
Le pouvoir n’appartient plus à un
souverain, mais à l’ensemble des individus, considérés comme une Nation.
La souveraineté est ainsi détenue par la communauté entière, et non plus par des groupes (« nul
corps ») ou des personnes (« nul individu ») défendant leurs intérêts contre ceux des autres.
Mais Olympe de Gouges prolonge l’article 3 de la DDHC de 1789 par une proposition
subordonnée relative qui précise la définition de la nation : « la nation, qui n’est que la réunion
de la femme et de l’homme ».
La militante rappelle ainsi que les femmes ne doivent pas être écartées de la nation.
La conjonction
de coordination « et », qui supprime toute hiérarchisation, exprime cette égalité entre les sexes.
La négation restrictive « ne…que » exclut toute définition de la Nation qui n’inclurait pas les
femmes.
III – La justice et la liberté pour les deux sexes
(Articles 4 à 6)
À mesure que les articles s’enchaînent, le tableau de la société idéale d’Olympe de Gouges se
précise.
Ainsi, l’article 4 définit «La liberté et la justice», qui «consistent à rendre tout ce qui appartient à
autrui; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle
que l’homme lui oppose».
Il s’agit d’une réécriture ironique de l’article 4 de la DDHC de 1789 qui énonce que « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits.
» Dans la DDHC de 1789, la liberté des uns s’achève là où
commence celle des autres.
Olympe de Gouges réécrit cet article avec une ironie grinçante puisqu’elle énonce que la liberté de
la femme est bornée par la tyrannie des hommes.
Ainsi,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Postambule DDFC
- Comparaison œuvres anglais
- Les Conflits en géopolitique : genèse et comparaison
- comparaison economique NZ et Cameroon
- Comparaison des institutions françaises et roumaines