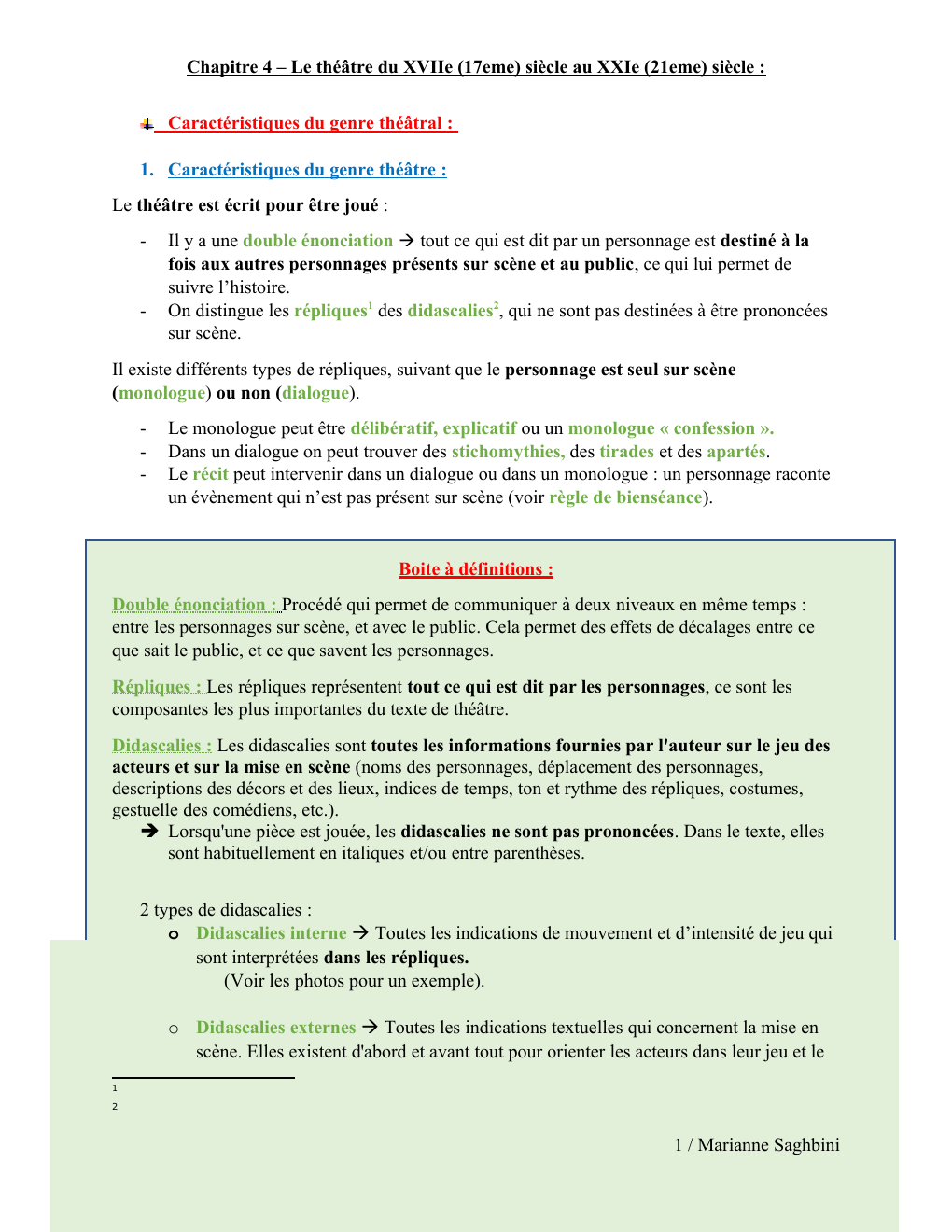Le theatre - cours de seconde
Publié le 20/09/2025
Extrait du document
«
Chapitre 4 – Le théâtre du XVIIe (17eme) siècle au XXIe (21eme) siècle :
Caractéristiques du genre théâtral :
1.
Caractéristiques du genre théâtre :
Le théâtre est écrit pour être joué :
-
Il y a une double énonciation tout ce qui est dit par un personnage est destiné à la
fois aux autres personnages présents sur scène et au public, ce qui lui permet de
suivre l’histoire.
On distingue les répliques1 des didascalies2, qui ne sont pas destinées à être prononcées
sur scène.
Il existe différents types de répliques, suivant que le personnage est seul sur scène
(monologue) ou non (dialogue).
-
Le monologue peut être délibératif, explicatif ou un monologue « confession ».
Dans un dialogue on peut trouver des stichomythies, des tirades et des apartés.
Le récit peut intervenir dans un dialogue ou dans un monologue : un personnage raconte
un évènement qui n’est pas présent sur scène (voir règle de bienséance).
Boite à définitions :
Double énonciation : Procédé qui permet de communiquer à deux niveaux en même temps :
entre les personnages sur scène, et avec le public.
Cela permet des effets de décalages entre ce
que sait le public, et ce que savent les personnages.
Répliques : Les répliques représentent tout ce qui est dit par les personnages, ce sont les
composantes les plus importantes du texte de théâtre.
Didascalies : Les didascalies sont toutes les informations fournies par l'auteur sur le jeu des
acteurs et sur la mise en scène (noms des personnages, déplacement des personnages,
descriptions des décors et des lieux, indices de temps, ton et rythme des répliques, costumes,
gestuelle des comédiens, etc.).
Lorsqu'une pièce est jouée, les didascalies ne sont pas prononcées.
Dans le texte, elles
sont habituellement en italiques et/ou entre parenthèses.
2 types de didascalies :
o Didascalies interne Toutes les indications de mouvement et d’intensité de jeu qui
sont interprétées dans les répliques.
(Voir les photos pour un exemple).
o Didascalies externes Toutes les indications textuelles qui concernent la mise en
scène.
Elles existent d'abord et avant tout pour orienter les acteurs dans leur jeu et le
1
2
Chapitre 4 – Le théâtre du XVIIe (17eme) siècle au XXIe (21eme) siècle :
metteur en scène dans son processus artistique.
Souvent, elles renseignent sur
l’attitude des personnages, l'intonation appropriée, la position physique, les jeux de
lumière, les décors, etc.
Comme ces didascalies sont inscrites à l’extérieur des
répliques, on les qualifie d’externes, par opposition aux didascalies internes.
(Voir photo pour exemple).
La distribution de la parole au théâtre :
Monologue : texte prononcé par un personnage seul sur scène.
Le public a ainsi accès à ses
pensées.
Le monologue peut être :
- Délibératif : un personnage doit prendre une décision et pèse le pour et le contre.
- Explicatif : un personnage vient expliquer une action ou une situation.
- Un monologue « confession » : un personnage dévoile ses sentiments ou ses projets
cachés.
Dialogue : Plusieurs personnages présents sur scène échangent des répliques.
-
La stichomythie : Les répliques sont brèves et s'enchaînent rapidement, ce qui rend
la scène plus dynamique, crée une accélération.
Deux personnages se disputent.
- La tirade : un personnage prononce une longue réplique.
Un personnage défend son point de vue, raconte quelque chose d'important pour faire
avancer l'intrigue
-
L’aparté : un personnage prononce un texte « en secret » à un personnage choisi et au
public, ou seulement au public, tandis que les autres personnages ne l'entendent pas.
Il est
signalé dans le texte par la didascalie « à part » ou « bas » en opposition à « haut ».
Un personnage ment à un autre mais révèle au public la vérité.
Le récit (dans la tirade ou le monologue) : Un personnage raconte un événement qui n’est
pas représenté sur scène (par exemple, un message vient raconter la mort de tel ou tel
personnage).
/// Règle de bienséance : Correspond à la conduite, au comportement social qui convient à
une époque, une société, un environnement.
Les bienséantes sont donc les usages, les
protocoles attendues pour ne pas choquer les spectateurs.
On parle souvent des aristocrates du XVII -ème siècle.
Cette règle est souvent utilisée
au XVII -ème siècle, pendant le mouvement littéraire du classicisme qui obéit à des
règles précises, notamment concernant le théâtre et surtout la tragédie.
La bienséance
doit être respectée.
Exemple : Interdit de montrer des meurtres sur la scène.
Chapitre 4 – Le théâtre du XVIIe (17eme) siècle au XXIe (21eme) siècle :
2.
La structure d’une pièce :
La plupart du temps une pièce de théâtre raconte une histoire.
Les étapes de cette histoire ont un nom spécifique au genre théâtral.
a.
Le découpage de l’histoire :
Les actes : ils correspondent aux grandes étapes de l'intrigue théâtrale.
Généralement, on baisse le rideau pour pouvoir changer de décor (et donc de lieu) d'un
acte à l'autre.
Avant l'éclairage électrique, on changeait également les bougies.
Les actes sont notés dans le texte en chiffres romains.
→ Acte IV
Les scènes : chaque acte est constitué de plusieurs scènes.
Habituellement, on change de scène quand on change de personnages et donc de
comédiens présents sur scène, ce qui facilite les répétitions.
Les scènes sont notées dans le texte en chiffres arabes.
→ Acte III scène 12 ou III, 12.
b.
Les étapes de l’intrigue :
On distingue différentes étapes dans la construction de l’intrigue théâtrale :
-
L’exposition : La ou les première(s) scène(s) d'une pièce de théâtre.
Par la double énonciation, elle informe le spectateur des éléments qui lui permettront de
suivre l'histoire : le lieu, l'époque, l'identité des personnages principaux, leurs rapports entre
eux, le sujet de la pièce.
(Remarque : À ne pas confondre avec l'incipit, qui est le début d'un récit.)
-
Le nœud : la situation des personnages semble bloquée, le spectateur ne voit pas de
solution et se demande comment s'achèvera l'intrigue.
Les péripéties : des événements surviennent dans le cours de l'histoire.
Le coup de théâtre : qui permet de résoudre le nœud / un événement inattendu vient
débloquer la situation vers la fin de la pièce.
Le dénouement : La dernière scène d'une pièce de théâtre.
Le nœud se dénoue : la
situation est résolue.
c.
L’évolution des lieux de
représentation :
Chapitre 4 – Le théâtre du XVIIe (17eme) siècle au XXIe (21eme) siècle :
Les mouvements littéraires au théâtre :
1.
Les origines du théâtre : Le théâtres antique
- Une origine religieuse et civique : dans la Grèce antique, les concours de théâtre avaient
lieu pendant les fêtes consacrées à Dionysos, dieu de l’ivresse et de l’inspiration.
- Les acteurs sont costumés et portent des masques.
- À l’origine, le théâtre est donc un art populaire.
- Les dramaturges développent la tragédie (Eschyle, Sophocle, Euripide, Sénèque) et la
comédie (Aristophane, Plaute, Ménandre).
2.
Le théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle : Le baroque.
- Le baroque naît dans un contexte de bouleversements philosophiques et politiques qui
conduisent les artistes à proposer une vision instable du monde.
- Selon eux, le monde n’est qu’illusion, les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En analysant les documents,en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, vous vous interrogerez sur ce qu’apportent les procès à la connaissance historique des crimes contre l’humanité commis par les nazis au cours de la Seconde Guerre Mondiale
- Cours d'histoire sur la seconde guerre mondiale
- cours de st niveau seconde
- Seconde Cours ensembles et intervalles I.
- L'Atome (cours seconde/première)