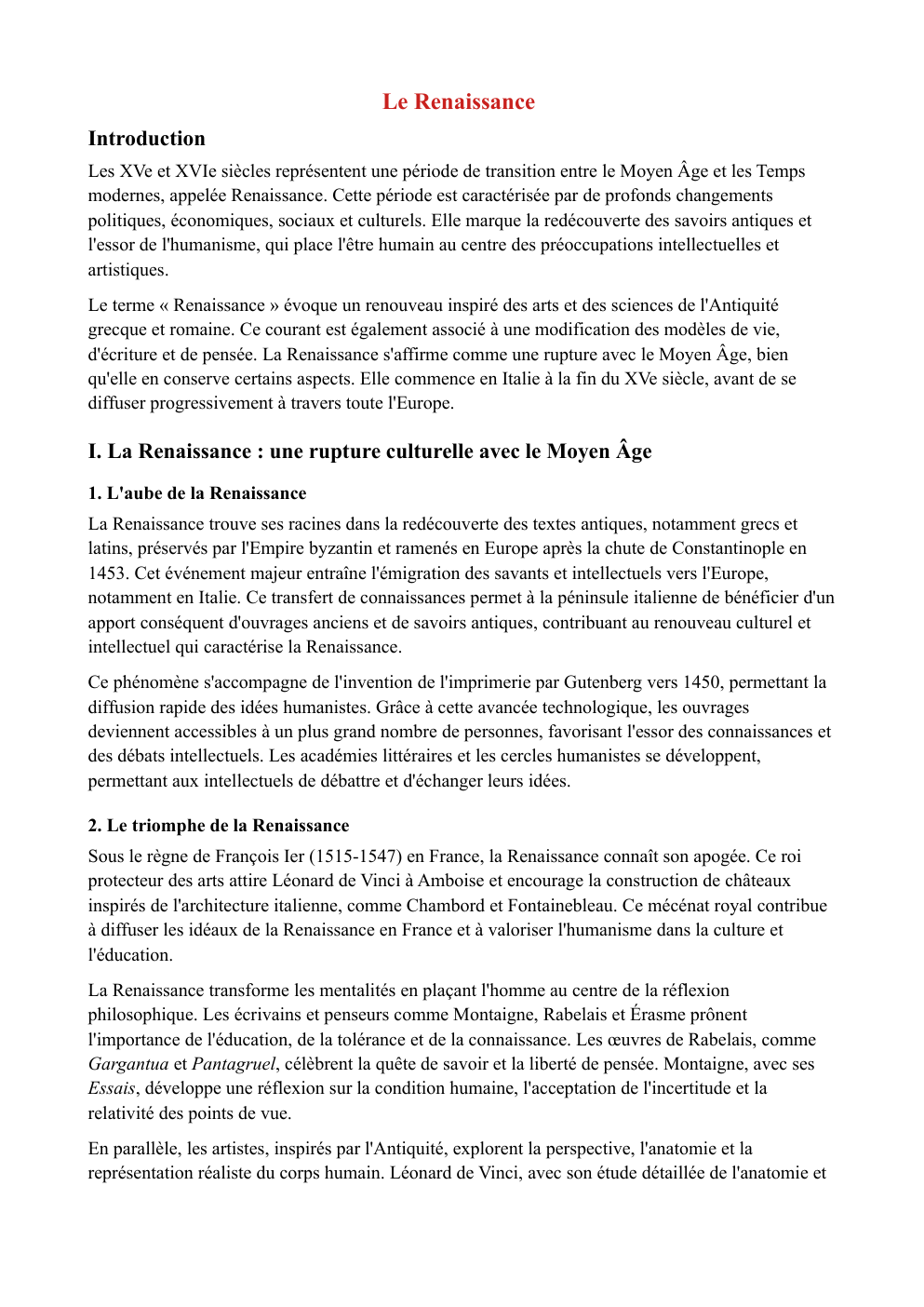Renaissance
Publié le 15/04/2025
Extrait du document
«
Le Renaissance
Introduction
Les XVe et XVIe siècles représentent une période de transition entre le Moyen Âge et les Temps
modernes, appelée Renaissance.
Cette période est caractérisée par de profonds changements
politiques, économiques, sociaux et culturels.
Elle marque la redécouverte des savoirs antiques et
l'essor de l'humanisme, qui place l'être humain au centre des préoccupations intellectuelles et
artistiques.
Le terme « Renaissance » évoque un renouveau inspiré des arts et des sciences de l'Antiquité
grecque et romaine.
Ce courant est également associé à une modification des modèles de vie,
d'écriture et de pensée.
La Renaissance s'affirme comme une rupture avec le Moyen Âge, bien
qu'elle en conserve certains aspects.
Elle commence en Italie à la fin du XVe siècle, avant de se
diffuser progressivement à travers toute l'Europe.
I.
La Renaissance : une rupture culturelle avec le Moyen Âge
1.
L'aube de la Renaissance
La Renaissance trouve ses racines dans la redécouverte des textes antiques, notamment grecs et
latins, préservés par l'Empire byzantin et ramenés en Europe après la chute de Constantinople en
1453.
Cet événement majeur entraîne l'émigration des savants et intellectuels vers l'Europe,
notamment en Italie.
Ce transfert de connaissances permet à la péninsule italienne de bénéficier d'un
apport conséquent d'ouvrages anciens et de savoirs antiques, contribuant au renouveau culturel et
intellectuel qui caractérise la Renaissance.
Ce phénomène s'accompagne de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450, permettant la
diffusion rapide des idées humanistes.
Grâce à cette avancée technologique, les ouvrages
deviennent accessibles à un plus grand nombre de personnes, favorisant l'essor des connaissances et
des débats intellectuels.
Les académies littéraires et les cercles humanistes se développent,
permettant aux intellectuels de débattre et d'échanger leurs idées.
2.
Le triomphe de la Renaissance
Sous le règne de François Ier (1515-1547) en France, la Renaissance connaît son apogée.
Ce roi
protecteur des arts attire Léonard de Vinci à Amboise et encourage la construction de châteaux
inspirés de l'architecture italienne, comme Chambord et Fontainebleau.
Ce mécénat royal contribue
à diffuser les idéaux de la Renaissance en France et à valoriser l'humanisme dans la culture et
l'éducation.
La Renaissance transforme les mentalités en plaçant l'homme au centre de la réflexion
philosophique.
Les écrivains et penseurs comme Montaigne, Rabelais et Érasme prônent
l'importance de l'éducation, de la tolérance et de la connaissance.
Les œuvres de Rabelais, comme
Gargantua et Pantagruel, célèbrent la quête de savoir et la liberté de pensée.
Montaigne, avec ses
Essais, développe une réflexion sur la condition humaine, l'acceptation de l'incertitude et la
relativité des points de vue.
En parallèle, les artistes, inspirés par l'Antiquité, explorent la perspective, l'anatomie et la
représentation réaliste du corps humain.
Léonard de Vinci, avec son étude détaillée de l'anatomie et
son chef-d'œuvre La Joconde, ainsi que Michel-Ange, avec la chapelle Sixtine, marquent l'histoire
de l'art par leur approche novatrice et leur quête de perfection esthétique.
3.
L'automne de la Renaissance
Malgré les progrès intellectuels et artistiques, la Renaissance sombre dans les guerres de religion au
XVIe siècle.
Ces conflits opposent catholiques et protestants, notamment en France avec les guerres
de religion qui débutent en 1562 et s'achèvent avec l'Édit de Nantes en 1598.
Cette période trouble
marque la fin de l'esprit de tolérance qui avait caractérisé les débuts de la Renaissance.
Les guerres de religion affaiblissent l'autorité royale et plongent la France dans une période de
chaos et de violence.
La Saint-Barthélemy (1572) symbolise l'horreur de ces affrontements, avec
des milliers de morts parmi les protestants.
Ce contexte conflictuel ébranle les idéaux humanistes et
favorise l'émergence de théories politiques justifiant l'absolutisme royal.
II.
La Renaissance : un prolongement naturel du Moyen Âge
1.
Les prémices de l'Humanisme
Bien que la Renaissance soit perçue comme une rupture, elle s'inscrit également dans la continuité
de certaines dynamiques médiévales.
Dès le XIIe siècle, l'essor des universités favorise un
renouveau intellectuel qui prépare l'émergence de l'humanisme.
Les travaux de penseurs comme
Abélard et les traductions d'Aristote montrent un intérêt croissant pour la raison et la logique.
Les monastères médiévaux avaient déjà préservé une partie du savoir antique, notamment à travers
la copie des manuscrits.
Ce travail de conservation....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi la Renaissance est-elle une période marquée par les ruptures ?
- questions de civilisations la renaissance
- Les textes et les images de l'art de la Renaissance
- LA RENAISSANCE EN PHILOSOPHIE
- La Renaissance du XIIe siècle