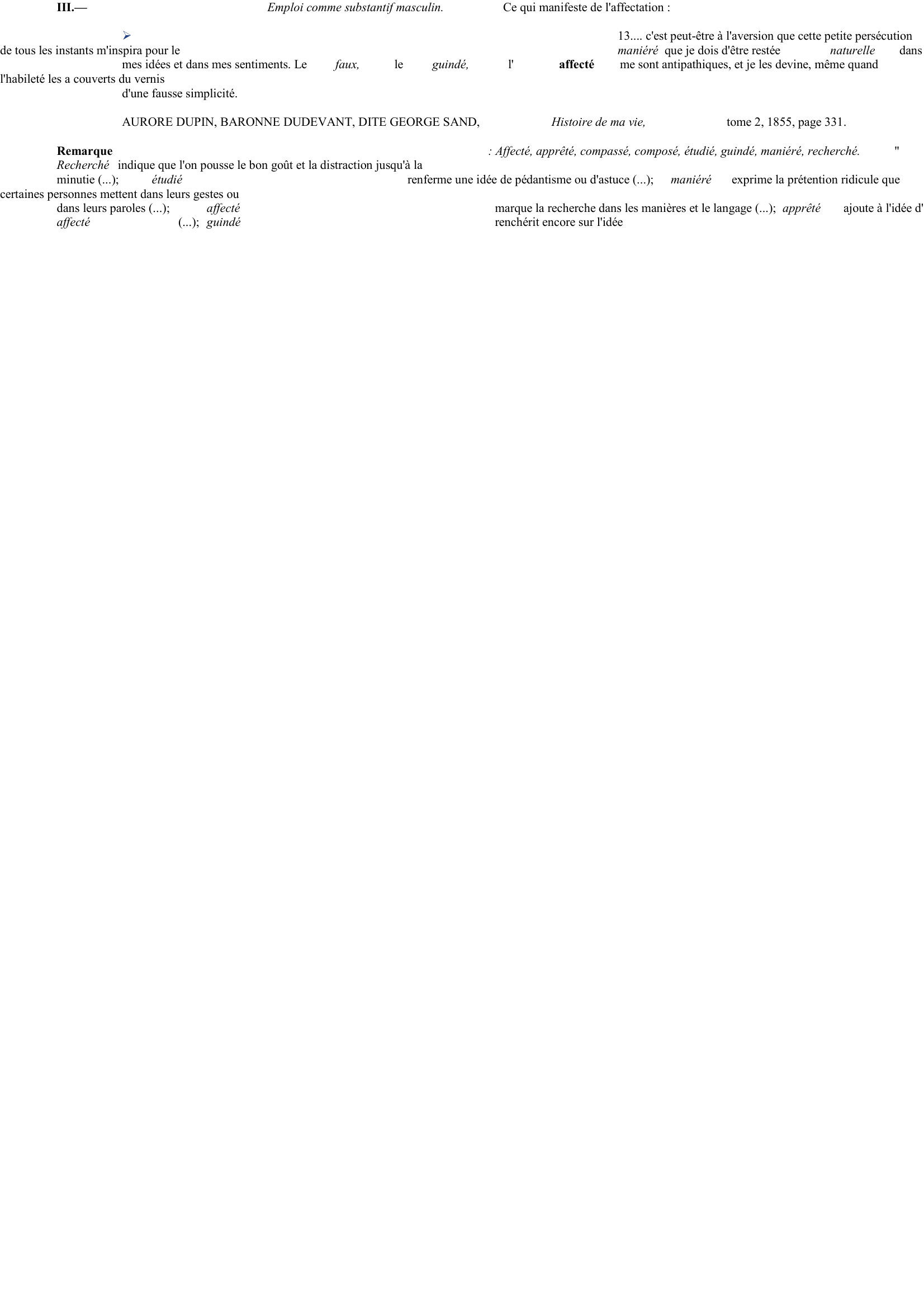AFFECTÉ 1 , -ÉE, participe passé, adjectif et substantif. I.- Participe passé de affecter1* II.- Adjectif. Qui manifeste de l'affectation, qui manque de simplicité naturelle et parfois de sincérité. 1. [En parlant d'une personne] : Ø 1. Malheur à l'homme le moins du monde affecté! même quand il aimerait, même avec tout l'esprit possible, il perd les trois quarts de ses avantages. Se laisse-t-on aller un instant à l'affectation, une minute après, l'on a un moment de sécheresse. HENRI BEYLE, DIT STENDHAL, De l'Amour, 1822, page 96. Ø 2.... le fond était mieux que la forme : sous ses dehors prétentieux, sous les exagérations de ses attitudes, il recélait un brin de personnalité vraiment « personnelle ». Il était affecté, mais pas entièrement factice. Il avait un tempérament, et le laissa vibrer avec une spontanéité qui les conquit tous. ROGER MARTIN DU GARD, Devenir, 1909, page 65. Ø 3. D'abord il avait été affecté, hautain, égoïste, vaniteux dans la vie comme dans ses écrits. - Oui, mais était-ce un tort réel? Tout homme a le droit d'être affecté jusqu'à ce qu'il ait réussi. ÉMILE HERZOG, DIT ANDRÉ MAUROIS, La Vie de Disraëli, 1927, page 45. Ø 4. Elle joue mal, pauvre petite, elle parle faux. Sa voix, l'émission de sa voix, la livre tout entière. Toi aussi, jeune femme, tu étais affectée. Mais dès ta première grossesse, tu redevins toi-même. FRANÇOIS MAURIAC, Le Noeud de vipères, 1932, page 80. 2. Par extension . [En parlant du vêtement, d'une attitude, du comportement d'une personne] Ton affecté : Ø 5. Sous Henri IV, l'habit français avait quelque chose de chevaleresque; mais les grandes perruques, et cet habit si sédentaire et si affecté que l'on portait à la cour de Louis XIV, n'ont commencé que sous Louis XIII. GERMAINE NECKER, BARONNE DE STAËL, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, tome 1, 1817, page 164. Ø 6. Il passa la soirée entière avec moi, et parut aussi calme que la Méditerranée. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que ce calme n'avait rien d' affecté. C'était de l'indifférence sincère. HENRI MURGER, Scènes de la vie de bohème, 1851, page 254. Ø 7.... Baccarat s'était insensiblement approchée de la croisée, sur laquelle elle s'était accoudée avec une négligence affectée, mais, en réalité, pour jeter un regard ardent et curieux à une croisée de la maison voisine,... PIERRE-ALEXIS, VICOMTE PONSON DU TERRAIL, Rocambole, les drames de Paris, tome 1, L'Héritage mystérieux, 1859, page 105. Ø 8. Vous brodez avec habileté, citoyenne, mais, si vous voulez que je vous dise, le dessin qui vous a été tracé n'est pas assez simple, assez nu, et se ressent du goût affecté qui régna trop longtemps en France dans l'art de décorer les étoffes, les meubles, les lambris; ces noeuds, ces guirlandes rappellent le style petit et mesquin qui fut en faveur sous le tyran. ANATOLE-FRANÇOIS THIBAULT, DIT ANATOLE FRANCE, Les Dieux ont soif, 1912, page 31. Ø 9. Peut-être recevrait-elle dans huit jours un de ces billets où il enfermait son secret d'être aimable avec insulte, ce secret (qui lui fait tant d'ennemis) de donner à ses politesses une banalité si affectée qu'il fût impossible de ne pas sentir qu'il les avait voulues criantes d'indifférence... HENRI DE MONTHERLANT, Le Songe, 1922, page 203. Ø 10. Je m'affectai péniblement, non tant de ces paroles absurdes que de leur ton; un ton déclamatoire, indiciblement affecté, auquel mon vieux maître, si naturel avec moi d'ordinaire et si confiant, ne m'avait pas habitué. ANDRÉ GIDE, Les Faux-monnayeurs, 1925, page 1129. Ø 11. Le visage de l'abbé lui apparut mal distinct dans la chambre obscure (les rideaux étaient encore à demi tirés). Ce qu'il en vit démentait suffisamment le calme affecté de la voix. GEORGES BERNANOS, Sous le soleil de Satan, 1926, page 214. Ø 12. Machinalement, je regardai le portrait. À travers la vitre sale, on apercevait un visage mince encadré d'anglaises blondes; l'ensemble était affecté et banal tout à la fois, mais les yeux, très grands, faisaient oublier le reste et fascinaient. HENRI PETIOT, DIT DANIEL-ROPS, Mort, où est ta victoire?, 1934, page 274. III.- Emploi comme substantif masculin. Ce qui manifeste de l'affectation : Ø 13.... c'est peut-être à l'aversion que cette petite persécution de tous les instants m'inspira pour le maniéré que je dois d'être restée naturelle dans mes idées et dans mes sentiments. Le faux, le guindé, l' affecté me sont antipathiques, et je les devine, même quand l'habileté les a couverts du vernis d'une fausse simplicité. AURORE DUPIN, BARONNE DUDEVANT, DITE GEORGE SAND, Histoire de ma vie, tome 2, 1855, page 331. Remarque : Affecté, apprêté, compassé, composé, étudié, guindé, maniéré, recherché. " Recherché indique que l'on pousse le bon goût et la distraction jusqu'à la minutie (...); étudié renferme une idée de pédantisme ou d'astuce (...); maniéré exprime la prétention ridicule que certaines personnes mettent dans leurs gestes ou dans leurs paroles (...); affecté marque la recherche dans les manières et le langage (...); apprêté ajoute à l'idée d' affecté (...); guindé renchérit encore sur l'idée exprimée par apprêté (...); composé exprime les allures de certains pédants et les manières hypocrites de certains dévots (...); compassé se dit de ce qui est d'une régularité, d'une symétrie minutieuse. " (Grand dictionnaire universel du XIXe . siècle (Pierre Larousse)). Forme dérivée du verbe "affecter" affecter AFFECTER 1 , verbe transitif. A.- Rare, vieilli . [L'objet désigne une chose] Montrer une grande prédilection pour, s'intéresser vivement à : Ø 1.... ce nom de Caracalla, emprunté d'un vêtement gaulois que le fils de Sévère affectoit. FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND, Études historiques, 1831, page 106. Ø 2.... il avait à se faire un nom [Stenka Razine] ... Ce fut la politique de César, qui, avant d' affecter l'empire, passa huit ans en Gaule à guerroyer pour former ses invincibles légions. PROSPER MÉRIMÉE, Les Cosaques d'autrefois, 1865, page 306. B.- Recherché . [L'objet désigne une forme physique, un type moral ou social] Prendre nettement (telle forme, telle figure, etc.) : Ø 3. Ces îles sont un amas de rochers qui affectent toutes sortes de figures;... Voyage de la Pérouse autour du monde (MILET DE MUREAU) tome 2, 1797, page 375. Ø 4. La côte que nous venons de décrire (...) affecte une direction sensiblement Nord et Sud... LOUIS-CLAUDE DESAULCES DE FREYCINET, Voyage de découverte aux terres australes, 1815, pages 66-67. Ø 5. C'est seulement avec le christianisme que le mariage affecta un autre caractère. ÉMILE DURKHEIM, De la division du travail social, 1893, page 185. Ø 6.... il suffit ici d'un fil maintenu ou coupé pour que la vie affecte la forme sociale ou la forme individuelle. HENRI BERGSON, L'Évolution créatrice, 1907, page 261. C.- Langue courante . [L'objet désigne une attitude ou une qualité physique ou morale] Adopter (une attitude) avec un certain degré d'ostentation et parfois d'insincérité. Synonymes : afficher, simuler. 1. [L'objet est un nom abstrait] : Ø 7. Là je voudrois te voir, telle que je t'ai vue, De ta molle fourrure élégamment vêtue, Affectant l'air distrait, jouant l'air endormi, Épier une mouche, ou le rat ennemi,... ABBÉ JACQUES DELILLE, L'Homme des champs ou les Géorgiques françaises, 1800, page 123. Ø 8. La marquise paraissait souffrante : elle avait les yeux battus. Cependant elle a affecté beaucoup de gaieté et a causé un peu de toutes choses. Puis, sans affectation, elle a demandé au major quel était ce jeune homme qu'il lui avait présenté et qu'elle avait revu chez la vicomtesse G... PIERRE-ALEXIS, VICOMTE PONSON DU TERRAIL, Rocambole, les drames de Paris, tome 2, Le Club des valets de coeur, 1859, page 181. Ø 9. Il affectait avec ses collègues un ton d'égalité courtoise. Mais au fond, il avait pour eux un mépris tranquille et sans bornes. ROMAIN ROLLAND, Jean-Christophe, La Révolte, 1907, page 417. Ø 10. Quelque mépris que j'eusse pour mon entourage, je m'étonnais de n'y rencontrer pas un qui fût à tout le moins capable d'apprécier l'habileté dont je faisais preuve en affectant, au plus fort de ma tragique passion, des dehors de mauvais sujet en quête d'aventures divertissantes et passagères. OSCAR VLADISLAS DE LUBICZ-MILOSZ, L'Amoureuse initiation, 1910, page 196. Ø 11. Quand je parlais d'Albertine avec Andrée, j' affectais une froideur dont Andrée fut peut-être moins dupe que moi, de sa crédulité apparente. MARCEL PROUST, À la recherche du temps perdu, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918, page 927. Ø 12. Ne pas poser devant soi-même. Id est : ne pas affecter les qualités et les vertus que l'on souhaiterait d'avoir mais que l'on n'a pas. ANDRÉ GIDE, Journal, 1927, page 851. Ø 13.... la vieille châtelaine affectait volontiers des convictions voltairiennes, bien qu'elle continuât d'entretenir avec les curés du voisinage des relations qui ne semblaient pas seulement de pure courtoisie. GEORGES BERNANOS, Un crime, 1935, page 799. - [L'objet est un pronom neutre] : Ø 14.... quand nous nous rencontrions, son air ennuyé, son affectation provinciale de ne rien affecter et d'éviter l'allusion, étaient réjouissants. RAYMOND ABELLIO, Heureux les pacifiques, 1946, page 197. Remarque : 1. Les idées d'ostentation et d'insincérité sont étroitement mêlées; l'idée d'ostentation est cependant dominante, voire seule présente, dans l'exemple 14. 2. Syntagmes rencontrés (verbe + substantif). Les substantifs les plus fréquents sont : air (exemple 7 et, en outre François-René de Chateaubriand, Les Natchez, 1826, page 482; Émile Zola, L'?uvre, 1886, page 78; Anatole France, L'Orme du mail, 1897, page 192; Idem, Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881, page 327; H. Quéffelec, Le Recteur de l'île de Sein, 1944, page 203), allures (Romain Rolland, Jean-Christophe, La Foire sur la place, 1908, page 717), calme (Émile Zola, Germinal, 1885, page 1512; Idem, L'Argent, 1891, page 321), contenance (Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, 1834, page 63), façons de parler (E. Moselly, Terres lorraines, 1907, page 40), gaieté (exemple 8 et, en outre, Emmanuel Dieudonné, comte de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, tome 1, 1823, page 477; Honoré de Balzac, La Cousine Bette, 1846, page 155), indifférence (Étienne-Jean Delécluze, Journal, 1828, page 158; Erckmann-Chatrian, L'Ami Fritz, 1864, page 120; Émile Zola, Nana, 1880, page 1304), sang-froid (Henri Beyle, dit Stendhal, L'Abbesse de Castro, 1839, page 158; Gaston Leroux, Rouletabille chez le tsar, 1912, page 106), ton (exemple 9 et, en outre, Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, 1913, page 253; Roger Martin du Gard, Les Thibault, Épilogue, 1940, page 801), tranquillité (Romain Rolland, Jean-Christophe, Antoinette, 1908, page 869). 2. [Le complément est un verbe à l'infinitif] Affecter de : Ø 15.... je vis tout cela, et n'en fis pas semblant; j' affectai même de n'avoir pas fait attention à ce qui avait été dit. GABRIEL SÉNAC DE MEILHAN, L'Émigré, 1797, page 1640. Ø 16. Il mène Mme. Martineau à la messe et reste à la porte, en affectant de ne jamais mettre le pied dans l'église, ce qui est un sujet de scandale chaque dimanche. ÉMILE ZOLA, Son Excellence Eugène Rougon, 1876, pages 250-251. Ø 17. Ma femme se moque de moi sans se cacher. Solange affecte de prendre mes idées au sérieux, mais je sais bien que c'est uniquement par gentillesse. HENRI DE MONTHERLANT, Pitié pour les femmes, 1936, page 1176. Ø 18. Ce n'était pas un de ces orages comme il en éclate au fond des coeurs et que l'on peut ne pas voir, que l'on peut affecter de ne pas voir ou même dédaigner de voir. GEORGES DUHAMEL, Chronique des Pasquier, Suzanne et les jeunes hommes, 1941, page 213. Remarque : Syntagmes. Les verbes à l'infinitif le plus fréquemment notés sont : croire (J. GUÉHENNO, Jean-Jacques, En marge des « Confessions », 1948, page 67), douter (ÉMILE ZOLA, La Terre, 1887, page 445; Charles DE GAULLE, Mémoires de guerre, L'Unité, 1956, page 5), ne pas entendre (GEORGES BERNANOS, Un Crime, 1935, page 781), ignorer (JOSÉPHIN PÉLADAN, Le Vice suprême, 1884, page 300; Charles MAURRAS, Kiel et Tanger, 1914, page 220; Charles DE GAULLE, Mémoires de guerre, L'Appel, 1954, page 14), parler (JEAN GUÉHENNO, opere citato page 125), savoir (ÉMILE ZOLA, L'Argent, 1891, page 251), se taire (ALAIN- FOURNIER, Le Grand Meaulnes, 1913, page 19), voir (Charles DE GAULLE, Mémoires de guerre, L'Unité, 1956, page 412), ne pas voir (J. GUÉHENNO, opere citato page 162).