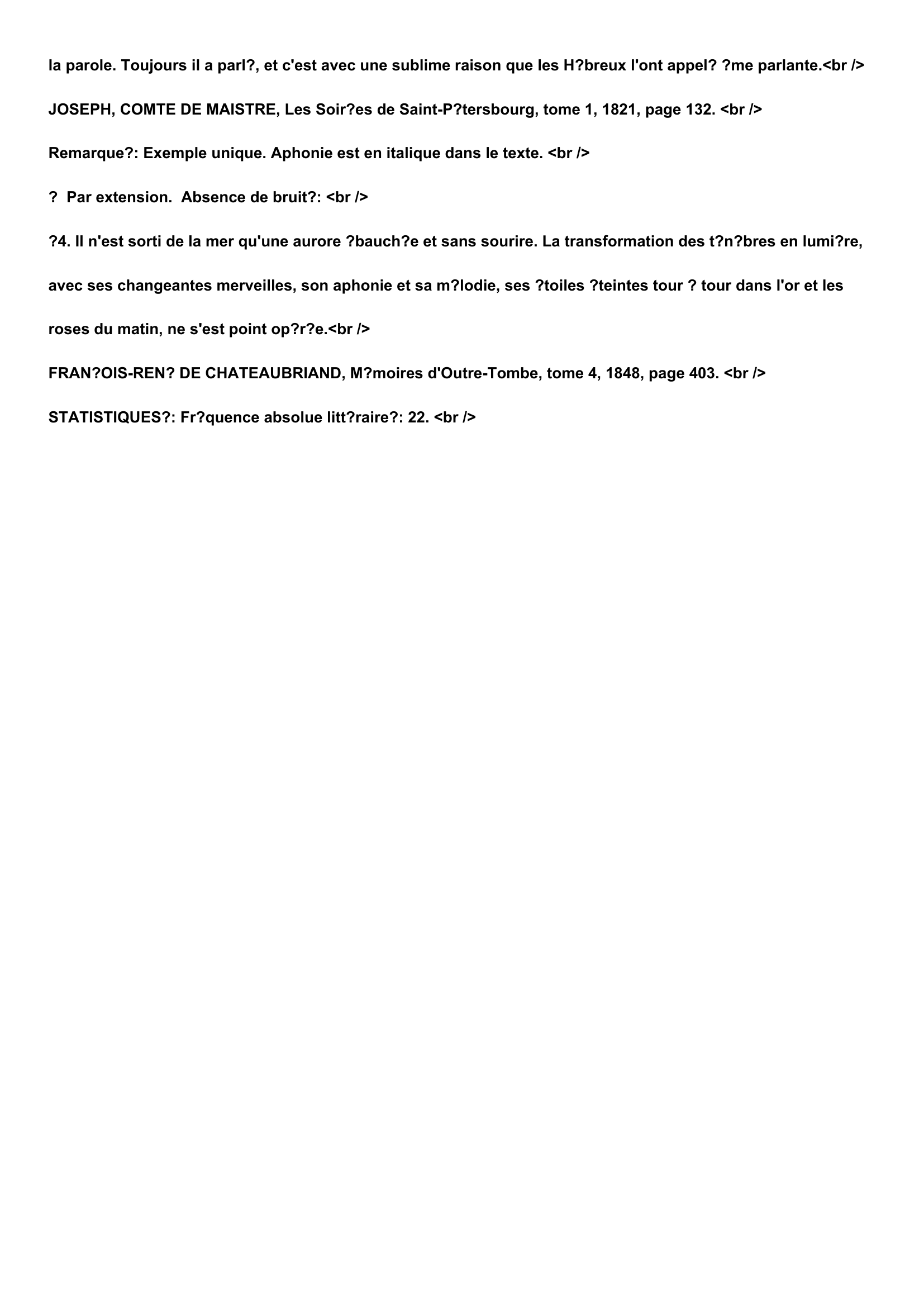APHONIE, substantif féminin.
Publié le 22/10/2015
Extrait du document
«
la parole.
Toujours il a parl?, et c'est avec une sublime raison que les H?breux l'ont appel? ?me parlante.
JOSEPH, COMTE DE MAISTRE, Les Soir?es de Saint-P?tersbourg, tome 1, 1821, page 132.
Remarque?: Exemple unique.
Aphonie est en italique dans le texte.
? Par extension.
Absence de bruit?:
? 4.
Il n'est sorti de la mer qu'une aurore ?bauch?e et sans sourire.
La transformation des t?n?bres en lumi?re,
avec ses changeantes merveilles, son aphonie et sa m?lodie, ses ?toiles ?teintes tour ? tour dans l'or et les
roses du matin, ne s'est point op?r?e.
FRAN?OIS-REN? DE CHATEAUBRIAND, M?moires d'Outre-Tombe, tome 4, 1848, page 403.
STATISTIQUES?: Fr?quence absolue litt?raire?: 22..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CLAIRÉE, substantif féminin.
- ACHROMATOPSIE, substantif féminin.
- Définition: FABLE, substantif féminin.
- Définition: FABRICATION, substantif féminin.
- Définition: FABRIQUE, substantif féminin.