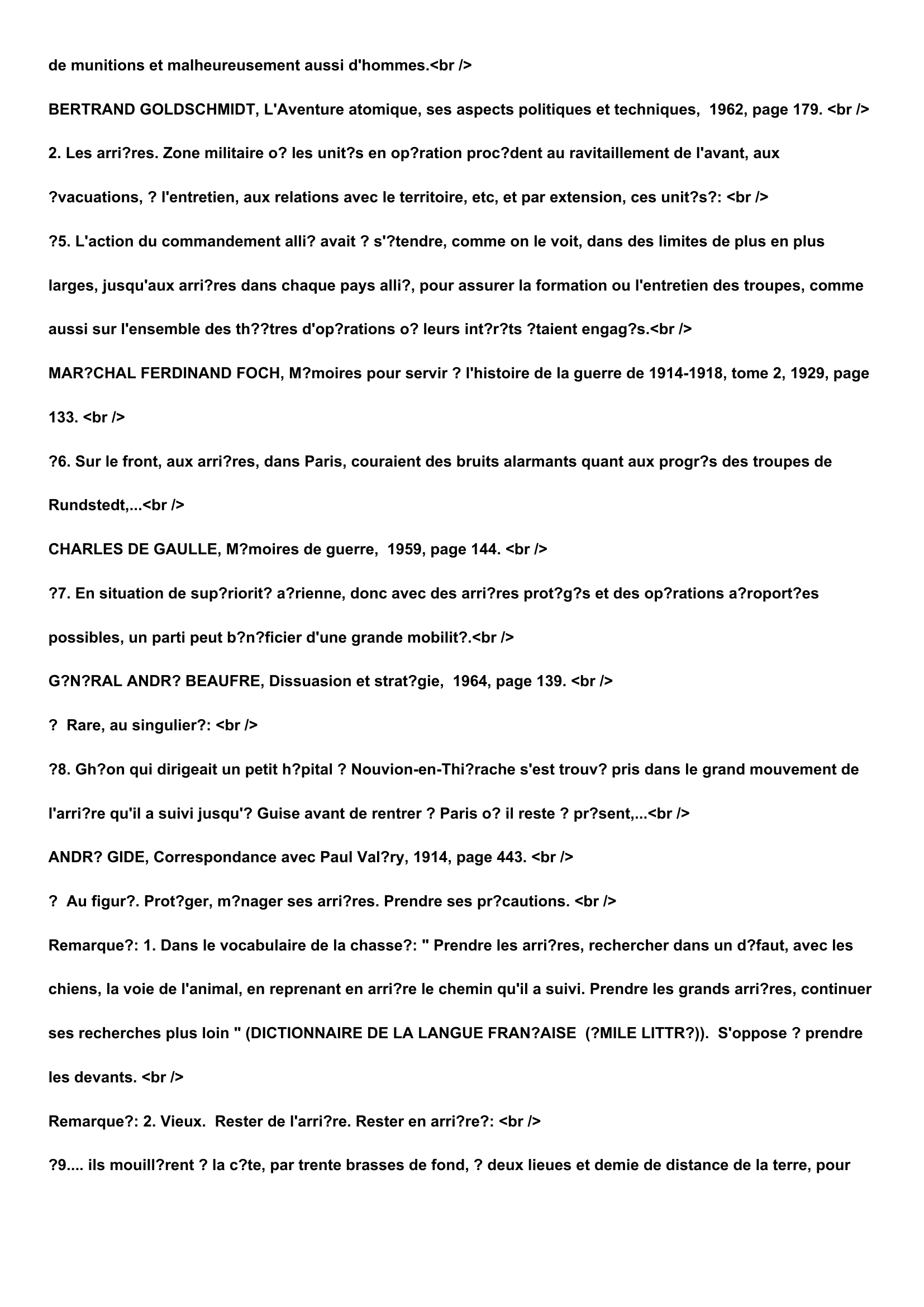ARRIÈRE2, substantif masculin.
Publié le 27/10/2015

Extrait du document
«
de munitions et malheureusement aussi d'hommes.
BERTRAND GOLDSCHMIDT, L'Aventure atomique, ses aspects politiques et techniques, 1962, page 179.
2.
Les arri?res.
Zone militaire o? les unit?s en op?ration proc?dent au ravitaillement de l'avant, aux
?vacuations, ? l'entretien, aux relations avec le territoire, etc, et par extension, ces unit?s?:
? 5.
L'action du commandement alli? avait ? s'?tendre, comme on le voit, dans des limites de plus en plus
larges, jusqu'aux arri?res dans chaque pays alli?, pour assurer la formation ou l'entretien des troupes, comme
aussi sur l'ensemble des th??tres d'op?rations o? leurs int?r?ts ?taient engag?s.
MAR?CHAL FERDINAND FOCH, M?moires pour servir ? l'histoire de la guerre de 1914-1918, tome 2, 1929, page
133.
? 6.
Sur le front, aux arri?res, dans Paris, couraient des bruits alarmants quant aux progr?s des troupes de
Rundstedt,...
CHARLES DE GAULLE, M?moires de guerre, 1959, page 144.
? 7.
En situation de sup?riorit? a?rienne, donc avec des arri?res prot?g?s et des op?rations a?roport?es
possibles, un parti peut b?n?ficier d'une grande mobilit?.
G?N?RAL ANDR? BEAUFRE, Dissuasion et strat?gie, 1964, page 139.
? Rare, au singulier?:
? 8.
Gh?on qui dirigeait un petit h?pital ? Nouvion-en-Thi?rache s'est trouv? pris dans le grand mouvement de
l'arri?re qu'il a suivi jusqu'? Guise avant de rentrer ? Paris o? il reste ? pr?sent,...
ANDR? GIDE, Correspondance avec Paul Val?ry, 1914, page 443.
? Au figur?.
Prot?ger, m?nager ses arri?res.
Prendre ses pr?cautions.
Remarque?: 1.
Dans le vocabulaire de la chasse?: " Prendre les arri?res, rechercher dans un d?faut, avec les
chiens, la voie de l'animal, en reprenant en arri?re le chemin qu'il a suivi.
Prendre les grands arri?res, continuer
ses recherches plus loin " (DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRAN?AISE (?MILE LITTR?)).
S'oppose ? prendre
les devants.
Remarque?: 2.
Vieux.
Rester de l'arri?re.
Rester en arri?re?:
? 9....
ils mouill?rent ? la c?te, par trente brasses de fond, ? deux lieues et demie de distance de la terre, pour.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DIGEST, substantif masculin.
- ACOTA, substantif masculin.
- ALBUM, substantif masculin.
- AISEMENT, substantif masculin.
- ACIDIMÈTRE, substantif masculin.