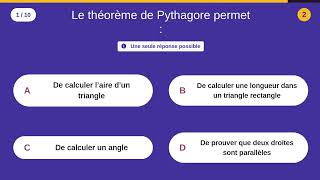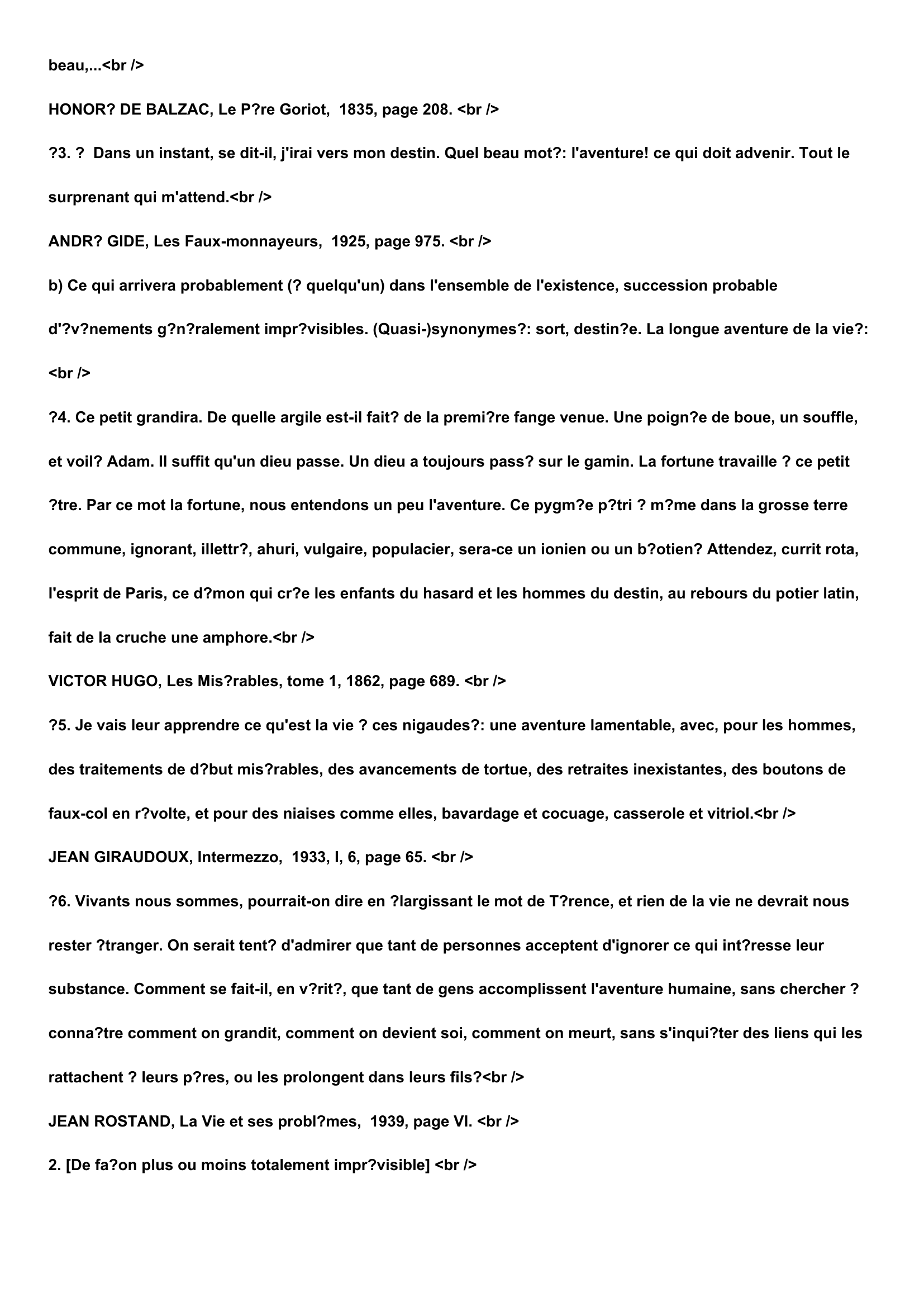AVENTURE, substantif féminin. Ce qui advient dans le temps, généralement à un individu ou à un groupe d'individus, d'une manière plus ou moins imprévue ou normalement imprévisible. A.— [Sans insistance sur la participation active de la personne intéressé, qui subit plus ou moins les événements] 1. [Avec une idée de haute probabilité] a) Ce qui arrivera probablement (à quelqu'un) dans l'avenir; événements futurs généralement inconnus sauf pour quelques soi-disant initiés. (Quasi-)synonyme : avenir : Ø 1.... vous vous êtes élevé, il y a quelques mois, avec autant de raison que de gaîté, contre cette folie endémique qui s'est tout-à-coup emparée du cerveau de nos dames, et a remis en crédit, chez le peuple le plus éclairé, dans la première ville du monde, les sorcières et les diseuses de bonne aventure; mais votre joyeuse critique n'a eu d'autre succès que de discréditer la pythonisse du faubourg Saint-Germain, sans désabuser sur son art nos belles et crédules concitoyennes. Cette maladie, comme toutes les autres, a ses paroxismes; nous voilà dans la crise. Ce n'est plus seulement à l'avenir dévoilé par les cartes que nos dames ajoutent foi, mais aux spectres, aux revenants, aux vampires, et sur-tout aux songes. VICTOR-JOSEPH ÉTIENNE, DIT DE JOUY, L'Hermite de la Chaussée d'Antin, tome 1, 1811, page 253. Ø 2. En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté, par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. Dieu est juste. Mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, Mademoiselle Victorine? Je me connais en chiromancie, j'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh! qu'aperçois-je? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau,... HONORÉ DE BALZAC, Le Père Goriot, 1835, page 208. Ø 3. — Dans un instant, se dit-il, j'irai vers mon destin. Quel beau mot : l'aventure! ce qui doit advenir. Tout le surprenant qui m'attend. ANDRÉ GIDE, Les Faux-monnayeurs, 1925, page 975. b) Ce qui arrivera probablement (à quelqu'un) dans l'ensemble de l'existence, succession probable d'événements généralement imprévisibles. (Quasi-)synonymes : sort, destinée. La longue aventure de la vie : Ø 4. Ce petit grandira. De quelle argile est-il fait? de la première fange venue. Une poignée de boue, un souffle, et voilà Adam. Il suffit qu'un dieu passe. Un dieu a toujours passé sur le gamin. La fortune travaille à ce petit être. Par ce mot la fortune, nous entendons un peu l'aventure. Ce pygmée pétri à même dans la grosse terre commune, ignorant, illettré, ahuri, vulgaire, populacier, sera-ce un ionien ou un béotien? Attendez, currit rota, l'esprit de Paris, ce démon qui crée les enfants du hasard et les hommes du destin, au rebours du potier latin, fait de la cruche une amphore. VICTOR HUGO, Les Misérables, tome 1, 1862, page 689. Ø 5. Je vais leur apprendre ce qu'est la vie à ces nigaudes : une aventure lamentable, avec, pour les hommes, des traitements de début misérables, des avancements de tortue, des retraites inexistantes, des boutons de faux-col en révolte, et pour des niaises comme elles, bavardage et cocuage, casserole et vitriol. JEAN GIRAUDOUX, Intermezzo, 1933, I, 6, page 65. Ø 6. Vivants nous sommes, pourrait-on dire en élargissant le mot de Térence, et rien de la vie ne devrait nous rester étranger. On serait tenté d'admirer que tant de personnes acceptent d'ignorer ce qui intéresse leur substance. Comment se fait-il, en vérité, que tant de gens accomplissent l'aventure humaine, sans chercher à connaître comment on grandit, comment on devient soi, comment on meurt, sans s'inquiéter des liens qui les rattachent à leurs pères, ou les prolongent dans leurs fils? JEAN ROSTAND, La Vie et ses problèmes, 1939, page VI. 2. [De façon plus ou moins totalement imprévisible] a) [L'aventure en général] Synonyme : hasard : Ø 7. On marche à la destruction de l'aventure et de la grâce du hasard, en toutes choses dans la société, l'architecture, le paysage. EDMOND DE GONCOURT, JULES DE GONCOURT, Journal, 1865, page 195. — Locutions. · À l'aventure. Au hasard, sans but. Errer à l'aventure : Ø 8. Je quitte mon église et mes murs jusqu'au soir, Et je vais par les champs m'égarer ou m'asseoir, Sans guide, sans chemin, marchant à l'aventure, Comme un livre au hasard feuilletant la nature; Mais partout recueilli; car j'y trouve en tout lieu Quelque fragment écrit du vaste nom de Dieu. ALPHONSE DE LAMARTINE, Jocelyn, 1836, page 742. Remarque : S'emploie au figuré : Ø 9.... On est tenté de croire qu'elle [l'oeuvre d'art] naît à l'aventure, sans règle ni raison, livrée à l'accident, à l'imprévu, à l'arbitraire :... HYPPOLYTE-ADOLPHE TAINE, Philosophie de l'Art, tome 1, 1865. · D'aventure, par aventure. Par hasard, sans intention précise : Ø 10. En apercevant Champavert, elle jeta un cri de surprise. — Vous, mon sauvage, à cette heure, quelle aventure!... — Amie, si je suis venu, ce n'est point par aventure, c'est tout à votre intention. PETRUS BOREL, Champavert, les contes immoraux, Champavert, Le Lycanthrope, 1833, page 234. Remarque : S'emploie au figuré : Ø 11.... j'y reviendrai, par bribes, au hasard, ou quand il faudra. Je dirai, si d'aventure mon récit l'exige ou seulement le souffre, cette longue passion de mon père pour s'élever — c'était son mot — par le savoir,... GEORGES DUHAMEL, Chronique des Pasquier, Vue de la Terre promise, 1934, page 69. b) [L'aventure appliquée à des personnes particulier] Une (des) aventure(s). Ce qui arrive (à quelqu'un) n'importe quand, n'importe où, comme par hasard, généralement avec quelque aspect singulier, frappant : Ø 12.... j'ai toujours le malheur d'oublier qu'une lettre n'est pas un traité de morale, mais une conversation gaie et vive où l'on dit ce qui peut désennuyer et amuser le lecteur. Mais d'un autre côté, comme je suis peu versé dans le monde, et que la vie régulière et retirée du collège ne me met pas dans le cas d'éprouver ces accidents singuliers, ces aventures plaisantes qu'on rencontre si souvent dans la société, je ne puis guère vous faire part que des réflexions qui m'occupent. MAURICE DE GUÉRIN, Correspondance, 1828, page 13. Ø 13. «... j'ai cru qu'on pouvait définir l'aventure : un événement qui sort de l'ordinaire, sans être forcément extraordinaire. On parle de la magie des aventures. Cette expression vous semble-t-elle juste? Je voudrais vous poser une question, Monsieur. » (...). Il se penche vers moi et demande, les yeux mi-clos : « Vous avez eu beaucoup d'aventures, Monsieur? » Je réponds machinalement : « Quelques-unes » (...). Même si c'était vrai que je n'ai jamais eu d'aventures, qu'est-ce que ça pourrait bien me faire? D'abord, il me semble que c'est pure question de mots. Cette affaire de Meknès, par exemple, à laquelle je pensais tout à l'heure : un Marocain sauta sur moi et voulut me frapper d'un grand canif. Mais je lui lançai un coup de poing qui l'atteignit au-dessous de la tempe... Alors il se mit à crier en arabe et un tas de pouilleux apparurent qui nous poursuivirent jusqu'au souk Attarin. Eh bien, on peut appeler ça du nom qu'on voudra, mais, de toute façon, c'est un événement qui m'est arrivé. (...). Je n'ai pas eu d'aventures. Il m'est arrivé des histoires, des événements, des incidents, tout ce qu'on voudra. Mais pas des aventures. Ce n'est pas une question de mots; je commence à comprendre. (...). (...) : autrefois, à Londres, à Meknès, à Tokio j'ai connu des moments admirables, j'ai eu des aventures. C'est ça qu'on m'enlève à présent. Je viens d'apprendre, brusquement, sans raison apparente, que je me suis menti pendant dix ans. Les aventures sont dans les livres. Et naturellement, tout ce qu'on raconte dans les livres peut arriver pour de vrai, mais pas de la même manière. (...). (...) : pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à le raconter. C'est ce qui dupe les gens : un homme, c'est toujours un conteur d'histoires, il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui, il voit tout ce qui lui arrive à travers elles; et il cherche à vivre sa vie comme s'il la racontait. JEAN-PAUL SARTRE, La Nausée, 1938, pages 56-58. Ø 14. Nous ne vivons vraiment que quelques heures de notre vie. Tout le reste, des milliers de jours, n'est que temps gâché, perdu, où nous sommes plus vécus que vivants. Ce sont mille aventures, mille tracas, mille anecdotes qui nous écartent de nous-mêmes, nous interdisent d'être nous-mêmes. Mais il est dans toute vie, et la plus humble, des heures d'une inexplicable harmonie où, par on ne sait quelle grâce, nous connaissons soudain, mais pour un seul instant seulement, ce que nous sommes, à la mesure du monde, à la mesure du ciel, à la mesure de Dieu. JEAN GUÉHENNO, Jean-Jacques, En marge des "Confessions", 1948, page 276. SYNTAXE : a) Aventure bizarre, étrange, personnelle, singulière, tragique; propre, sinistre, terrible aventure. b) Aventure de guerre, de voyage; dénouement, fin, récit, d'une (des) aventure(s). c) Connaître, conter, raconter une (des) aventure(s). Remarque : Aventure qui comporte dans cette acception une nuance parfois péjorative, peut être synonyme de désagrément, mésaventure (confer supra associations fréquentes avec des adjectifs de valeur dépréciative) : Ø 15.... la Présidente publia que c'était moi qui l'avais forcé à tirer vengeance d'un coup donné fort innocemment, et de là je fus regardée comme une femme d'un commerce dangereux. Six mois après cette aventure, mon malheur m'attira un autre désagrément encore plus sensible et plus fâcheux. GABRIEL SÉNAC DE MEILHAN, L'Émigré, 1797, page 1771. — Spécialement, vieilli. Mal d'aventure. Nom vulgaire du panaris. « Les appellations populaires (...) comme mal d'aventure, pour panaris » (RÉMY DE GOURMONT, Esthétique de la langue française, 1899, page 36 ). Remarque : Cette affection était autrefois considérée comme venant par hasard, « sans cause apparente » (confer Dictionnaire de l'Académie Française 1798). B.— [L'accent est mis sur la participation active de la personne intéressée, qui sollicite et conduit les événements, tout en les subissant partiellement dans leurs imprévus] 1. Entreprise remarquable par le grand nombre de ses difficultés et l'incertitude de son aboutissement. a) Domaine politique, idéologique, économique,administratif, juridique, etc. Expédition militaire, scientifique, etc., ou affaire financière tentée avec une intention de découverte, de profit, etc. : Ø 16. Dès qu'il eut gagné la frontière du royaume de Hilperik et celle de son ancien gouvernement, il annonça, dans le premier village, qu'il y avait un bon coup à faire, à une journée de marche, sur les terres du roi Gonthram, et que tout homme d'exécution qui voudrait courir cette aventure, serait généreusement récompensé. De jeunes paysans, et des vagabonds de tout état qui, alors, ne manquaient guère sur les routes, se rassemblèrent à cette nouvelle, et se mirent à suivre l'ex-comte de Tours, sans trop lui demander où il les menait. AUGUSTIN THIERRY, Récits des temps mérovingiens, tome 1, 1840, page 300. Ø 17. Je pousse les matelots aux voyages d'aventures; ils aperçoivent à travers la brume des îles merveilleuses, des dômes d'or, des pâturages, des fruits rouges, des femmes qui dansent, et, roulant dans la tempête, ils se délectent de toutes ces ivresses qui chantent à travers leur agonie, malgré le bruit des grands flots se refermant sur le navire sombré. GUSTAVE FLAUBERT, La Tentation de Saint Antoine, 1849, page 396. Ø 18. Les soucis de la haute politique n'empêchaient pas Clorindhe de mener de front toutes sortes de besognes, où elle semblait finir par se perdre elle-même. On la trouvait souvent assise sur son lit, son énorme portefeuille vidé au milieu de la couverture, et s'enfonçant jusqu'aux coudes dans le tas de papiers, (...). Lorsqu'elle partait pour terminer une affaire, elle entamait en chemin deux ou trois aventures. Ses démarches se compliquaient, elle vivait dans une excitation continue, s'abandonnant à un tourbillon d'idées et de faits, ayant sous elle des profondeurs et des complications d'intrigues inconnues, insondables. ÉMILE ZOLA, Son Excellence Eugène Rougon, 1876, page 298. Ø 19. Il se sentait comme baigné dans l'aventure, une vie plus large, plus libre... On eût dit que depuis ce matin il avait la révélation de ce qu'était la véritable existence, digne d'être vécue. Jamais plus il ne voudrait être ouvrier fondeur, maintenant qu'il avait goûté à ces choses, le voyage, l'air pur des matins et des soirs, la grande route, l'auberge, les amitiés de rencontre, l'aventure enfin... MAXENCE VAN DER MEERSCH, Invasion 14, 1935, page 54. Ø 20. En des lieux inconnus, on rencontrait des gens différents de tous les autres, et des choses arrivaient : des choses drôles, un peu tragiques, parfois très belles. (...). L'aventure, l'évasion, les grands départs : peut-être y avait-il là un salut! C'était celui que proposait Vasco de Marc Chadourne qui eut cet hiver-là un considérable succès et que je lus avec presque autant de ferveur que Le Grand Meaulnes. Jacques n'avait pas franchi les océans; mais quantité de jeunes romanciers — Soupault entre autres — affirmaient qu'on peut faire sans quitter Paris d'étonnants voyages;... SIMONE DE BEAUVOIR, Mémoires d'une jeune fille rangée, 1958, page 261. SYNTAXE : Aventure folle, belle aventure; esprit, vie d'aventure(s); bruit, démon, goût de l'aventure; risquer, tenter l'aventure; s'engager dans l'aventure. b) Spécialement. — COMMERCE MARINE. À la grosse aventure ou par ellipse à la grosse. Avec de gros risques de perte ou de profit, selon l'échec ou le succès d'une affaire maritime : Ø 21. À la fin du XVIIIe. siècle, le négoce intérieur et même la finance couraient moins de dangers, mais l'aléa demeurait notoire pour le commerce maritime et, en France par exemple, les fonds qu'on y engageait s'appelaient prêts « à la grosse aventure » : par compensation, il édifiait de grandes fortunes. GEORGES LEFEBVRE, La Révolution française, 1963, page 29. SYNTAXE : Contrat à la grosse aventure; donner, mettre, placer à la grosse aventure. — LITTÉRATURE (et autres ARTS). Aventure romanesque. · MYTHOLOGIE : Ø 22. Ils ont toujours vu dans Adonis, par exemple, le Soleil personnifié, et ils ont cru devoir rappeler à la physique et aux phénomènes annuels de la révolution de cet astre, toute l'aventure merveilleuse de l'amant de Vénus, mort et ressuscité. Les chants d'Orphée et de Théocrite sur Adonis indiquaient assez clairement qu'il s'agissait dans cette fiction, du dieu qui conduisait l'année et les saisons. Ces poëtes l'invitent à venir avec la nouvelle année, pour répandre la joie dans la Nature, et faire naître les biens que la terre fait éclore de son sein. CHARLES-FRANÇOIS DUPUIS, Abrégé de l'origine de tous les cultes, 1796, page 359. · HISTOIRE. Aventure(s) de chevalerie. Équipée de chevalier errant, en quête d'épreuves imprévues et difficiles, souvent rehaussées de merveilleux. (Quasi-)synonymes : exploit, prouesse : Ø 23. À peine le nouveau chevalier jouissoit-il de toutes ses armes, qu'il brûloit de se distinguer par quelques faits éclatans. Il alloit par monts et par vaux, cherchant périls et aventures; il traversoit d'antiques forêts, de vastes bruyères, de profondes solitudes. Vers le soir il s'approchoit d'un château dont il apercevoit les tours solitaires, espérant que son bras achèveroit dans ce lieu quelque terrible fait d'armes. Déjà il baissoit sa visière, et se recommandoit à la dame de ses pensées, lorsque le son d'un cor se faisoit entendre. FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND, Le Génie du christianisme, tome 2, 1803, page 488. Ø 24.... dans les naïfs récits des romanciers et des poëtes du Moyen Âge, on rencontre beaucoup d'aventures de princes et de chevaliers mélancoliques qui, fuyant les cours et les châteaux, se mettent un jour à courir le pays, cachant leur naissance et leur fortune, et, déguisés en pauvres trouvères, s'en vont, la guitare en main, chanter l'amour, et, parmi toutes les femmes, en cherchent une qui les aime pour eux-mêmes. HENRI MURGER, Scènes de la vie de jeunesse, 1851, page 30. · Moderne. Roman ou film, etc., d'aventures. Dont l'intrigue est riche en péripéties : Ø 25.... nous verrons le roman de la vie humaine conçue comme un ordre de chances inattendues, pittoresques, intéressantes, amusantes. Ainsi les romans de Dumas, les moins bons de ceux de Dickens, l'innombrable série des romans dits d'aventures. Il n'existe aucune raison intérieure aux personnages pour que leur vie soit ceci plutôt que cela, pour qu'il leur arrive telles aventures, pour qu'ils réalisent telle chance ou tombent dans telle malechance : aucune raison intérieure, précisément parce qu'ils n'ont à peu près aucun intérieur. Et pourtant on ne saurait assimiler la ligne de ces romans aux zigzags du pur hasard. Le mouvement d'intérêt qu'ils entretiennent dans l'esprit d'un honnête homme, d'un lecteur cultivé, est bien celui d'un intérêt déjà esthétique. Cette succession palpitante d'aventures suit, chez Dumas, une ligne de chance analogue à celles que tracent comme des étoiles filantes les belles rimes de Banville et de Rostand. ALBERT THIBAUDET, Réflexions sur la littérature, 1936, page 235. Remarque : Aventures figure souvent dans des titres d'ouvrages Les aventures de..., Les nouvelles aventures de... : Ø 26. On a publié beaucoup de livres sous ce titre : Les Aventures de celui-ci, de celui-là. Et ce livre-ci est encore une aventure. Peut-être dans quelques années pourra-t-on lui ajouter un chapitre pour que ce ne soit plus les Aventures du Nationalisme, mais la Victoire du Nationalisme. MAURICE BARRÈS, Mes cahiers, tome 2, 1901-02, page 236. 2. Au figuré. domaine moral. [En parlant d'une personne, de l'esprit, d'un concept, etc.] Poursuite généralement ardue, mais exaltante d'un idéal, d'une qualité, etc. Aventure spirituelle. (Quasi-)synonyme : quête. (L'aventure est en nous, titre d'un ouvrage de Maurice Genevoix, 1952) : Ø 27.... la Grèce a fondé la géométrie. C'était une entreprise insensée : nous disputons encore sur la possibilité de cette folie. Qu'a-t-il fallu faire pour réaliser cette création fantastique? — Songez que ni les Égyptiens, ni les Chinois, ni les Chaldéens, ni les Indiens n'y sont parvenus. Songez qu'il s'agit d'une aventure passionnante, d'une conquête mille fois plus précieuse et positivement plus poétique que celle de la Toison d'or. PAUL VALÉRY, Variété I, 1924, page 27. Ø 28. Devant les désagréments de la vie, la sagesse ne consiste pas dans la fuite mais dans la conquête. Et s'il faut des aventures, quelle plus surprenante et plus hardie que l'acceptation pratique d'un monde surnaturel et invisible, au prix duquel celui-ci est compté comme rien? Quels royaumes plus mystérieux et plus riches que ceux de la grâce? Ceux qui n'en savent rien sont comme un homme qui n'a pas vu les Tropiques ou comme un eunuque qui parle de l'amour. Qu'est le vent sur la face à côté du souffle intérieur? PAUL CLAUDEL, Correspondance [avec André Gide] , 1899-1926, page 83. Ø 29. Pour Baudelaire et Nerval, pour Hugo et pour Rimbaud, comme pour Novalis et Arnim et Hoffmann, le voyage au pays du rêve avait été une périlleuse aventure, une immense espérance ou parfois une redoutable épreuve, et toujours il s'était agi, pour chacun de ces poètes, de jouer un jeu où il risquait sa propre vie. ALBERT BÉGUIN, L'Âme romantique et le rêve, 1939, page 388. — Spécialement. [L'aventure considérée comme une valeur] : Ø 30. Le grand thème de Solange était « l'aventure ». Elle appelait ainsi la recherche d'événements inattendus et dangereux. Elle prétendait avoir horreur du « confort » moral ou physique. — Je suis heureuse d'être femme, — me dit-elle un soir, — parce qu'une femme a beaucoup plus de « possibles » devant elle qu'un homme. ÉMILE HERZOG, DIT ANDRÉ MAUROIS, Climats, 1928, page 205. Ø 31. L'Aventure, l'Ennui et le Sérieux sont trois manières dissemblables de considérer le temps. Ce qui est vécu, et passionnément espéré dans l'aventure, c'est le surgissement de l'avenir. L'ennui, par contre, est vécu plutôt au présent : (...) si l'aventure se place surtout au point de vue de l'instant, l'ennui et le sérieux considèrent le devenir surtout comme intervalle : c'est le commencement qui est aventureux, mais c'est la continuation qui est, selon les cas, sérieuse ou ennuyeuse. Il s'ensuit naturellement que l'aventure n'est jamais « sérieuse » et qu'elle est a fortiori recherchée comme un antidote de l'ennui. Dans le désert informe, dans l'éternité boursouflée de l'ennui, l'aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses jardins clos; mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux le principe de l'instant Redevenir sérieux, n'est-ce pas quitter pour la prose amorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses, ces condensations de durée qui forment le laps de temps aventureux? VLADIMIR JANKÉLÉVITCH, L'Aventure, l'ennui, le sérieux, Paris, Montaigne, 1963, page 7. Remarque : Plus rarement, aventure désigne moins ce qui advient dans le temps que ce qui vient dans l'espace — c'est-à-dire une progression, une évolution : Ø 32.... les espèces marines inférieures adoptent les anfractuosités des rochers pour s'y garer des risques possibles, pour cesser, avec le mouvement, la vie exposée, et se retirer de l'aventure évolutive sous quelque carapace protectrice. Ces espèces sont ou deviennent aveugles. L'élan vital les contrepasse et les abandonne à une existence sommeillante et restreinte. Ainsi se comportent avec l'aventure de l'esprit les hommes qui, très tôt, s'incrustent dans quelque simplification mortelle d'eux-mêmes et de leur vocation qu'ils nomment principe, conviction, ligne de vie,... EMMANUEL MOUNIER, Traité du caractère, 1946, page 645. Ø 33. Si la vie recherche un équilibre, celui-ci, comme elle, est perpétuellement en révision et en progression; il est dynamique. Il ne vise pas à un état, qui serait incompatible avec l'évolution continue de l'existence; il mène une aventure sans cesse recommencée parce que sans cesse poursuivie. La carrière accomplie par un homme forme cependant un tout par son orientation qui, à travers les mille détours des circonstances, tend sans arrêt à un certain accomplissement déterminé. Elle est comme la goutte d'eau dont les cent méandres et crochets sur la vitre dissimulent mal la force inexorable qui l'attire. Élaboration continue, elle connaît d'inévitables incertitudes, souvent des reculs, parfois des égarements qui la laissent inachevée ou manquée. RENÉ HUYGHE, Dialogue avec le visible, 1955, page 378. 3. Par analogie et par euphémisme, domaine amoureux. Liaison généralement de caractère charnel, frivole, passager : Ø 34.... — comme, en outre son unique occupation, durant ses années de stage au Quai d'Orsay, avait été de courtiser toutes les femmes et d'aller dans tous les mondes, il [Élie Laurence] avait rencontré l'occasion de beaucoup d'aventures, et il s'y était abandonné, sans réfléchir qu'un homme flétrit le meilleur de lui-même dans des plaisirs de passage. PAUL BOURGET, 2e. amour, 1884, page 144. Ø 35. J'étais un garçon vigoureux, et, ma foi, assez porté sur les femmes. J'avais, dans le voisinage, un tas de petites aventures; mais des aventures d'occasion, des amours de vingt minutes, sans lendemain. ROGER MARTIN DU GARD, Confidence africaine, 1931, page 1117. Ø 36. Je songe à des femmes sérieuses, qui n'hésiteraient pas à s'engager elles-mêmes pour toujours, si le destin le permettait. Mais comme le destin ne le permet pas, dans les cas dont je parle, elles se résignent. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'elles traitent la chose comme une aventure... (...). Nous nous donnons l'air d'accepter une aventure, et au fond, ce n'est pas cela du tout... Ce que nous acceptons, dans ces cas-là, c'est qu'un grand amour soit condamné d'avance à n'avoir que la durée d'une aventure... du moins pour sa période heureuse... Car rien ne nous empêche ensuite de le faire durer tant qu'il nous plaît, en nous-mêmes... et d'en souffrir. LOUIS FARIGOULE, DIT JULES ROMAINS, Les Hommes de bonne volonté, La Douceur de la vie, 1939, page 223. SYNTAXE : Aventure galante, scandaleuse; dernière, première, sotte, triste aventure; aventure de jeunesse, d'un soir; coureur d'aventure, femme/homme à aventures. — PARADIGMES. (Quasi-)synonymes : amourette, bonne fortune, caprice, passade, rencontre, toquade. Remarque : Souvent péjoratif en cette acception par affaiblissement sémantique dans des contextes où la facilité de la conquête est dévalorisante, aventure prend pourtant un caractère parfois favorable : Ø 37. Ce n'est pas à mon sens le véritable amour. Celui-ci implique le corps à corps. C'est une grande aventure à laquelle participe l'homme tout entier : tête, coeur et ventre. Il n'est rien de soi-même qui n'y soit engagé. (...). Pour la plupart des romanciers, l'aventure est terminée lorsque les deux antagonistes parviennent enfin à coucher ensemble : ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle commence. L'épreuve de vérité du nu à nue est nécessaire pour distinguer l'amour vrai des extravagances de l'imagination; (...) (...) Stendhal ne nous dit rien des nuits d'amour de Julien et de Mathilde : cent pages pour la séduction, une ligne pour dire sa réussite. Pour moi l'amour commence une fois la conquête achevée. C'est l'aventure du couple que je nomme amour. Je ne conçois pas un amour qui ne soit pas partagé. Si l'un des deux se refuse à l'aventure, l'amour ne se produit pas, — par définition. L'amour est ce qui se passe entre deux êtres qui s'aiment : comment ils s'approchent, se fuient, se rapprochent, se déchirent, se brûlent, parviennent ou échouent à faire un couple et ce qu'il advient de ce couple. ROGER VAILLAND, Drôle de jeu, 1945, pages 107-108. — Par métonymie : Ø 38. Tu dis : « Nous étions nés l'un pour l'autre. » Mais pense à ce qu'il dut falloir de chances, de concours, de causes, de coïncidences, pour réaliser ça, simplement, notre amour! Songe qu'avant d'unir nos têtes vagabondes, nous avons vécu seuls, séparés, égarés, et que c'est long, le temps, et que c'est grand, le monde, et que nous aurions pu ne pas nous rencontrer. As-tu jamais pensé, ma jolie aventure, aux dangers que courut notre pauvre bonheur quand l'un vers l'autre, au fond de l'infinie nature, mystérieusement gravitaient nos deux coeurs? PAUL GÉRALDY, Toi et Moi, 1913, page 31. STATISTIQUES : Fréquence absolue littéraire : 5 139. Fréquence relative littéraire : XIXe. siècle : a) 5 586, b) 6 215; XXe. siècle : a) 8 092, b) 8 895. Forme dérivée du verbe "aventurer" aventurer AVENTURER, verbe transitif. [Le sujet désigne généralement une personne] I.— Emploi transitif. [L'objet désigne généralement une chose concrète ou abstraite] A.— Rare. Laisser aller à l'aventure, au hasard : Ø 1. Alors qu'il glisse à la dérive, au fil des songes, alors qu'il erre, ivre, haletant parmi les créatures de la fantaisie souveraine, il arrive que le dormeur étende la main, aventure un doigt tâtonnant dans l'ombre et rencontre soudain quelque objet sévère et précis qui est un témoin de la vie véritable : le bois de la table de nuit, la grosse montre claudicante, le livre ou la tasse vide. GEORGES DUHAMEL, Chronique des Pasquier, Suzanne et les jeunes hommes, 1941, page 246. B.— Engager dans une aventure, dans une tentative difficile et périlleuse. 1. Domaine des entreprises, des affaires concret [Le complément d'objet direct désigne une (partie de la) personne, un bien matériel] : Ø 2.... mais je ne t'ai jamais vu si timoré, Maurice... — C'est que, Victor, je n'ai jamais aventuré si témérairement la fortune d'un de mes clients. — Tu lui escompteras l'intérêt de son argent. Est-ce que cela n'est pas établi de toute éternité? Les clients ignorent-ils que tu roules sur leurs fonds? N'est-ce pas la vie de l'argent, la circulation? Qui saurait mauvais gré d'imprimer à l'argent son mouvement naturel, sans compromettre les droits de personne? LÉON GOZLAN, Le Notaire de Chantilly, 1836, page 208. Ø 3. Il nous semblait que cent escadrilles, naviguant pendant cent années, n'eussent pas achevé d'explorer cet énorme massif dont les crêtes s'élèvent jusqu'à sept mille mètres. Nous avions perdu tout espoir. Les contrebandiers mêmes, des bandits qui, là-bas, osent un crime pour cinq francs, nous refusaient d'aventurer, sur les contreforts de la montagne, des caravanes de secours : « Nous y risquerions notre vie », nous disaient-ils. « Les Andes, en hiver, ne rendent point les hommes. » ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Terre des hommes, 1939, page 160. — Par analogie. [Le sujet désigne un élément naturel] : Ø 4. Sa chambre était un de ces taudis humides et obscurs dans lesquels le soleil n'ose pas aventurer un rayon, comme s'il craignait de rester prisonnier dans ces cachots aériens. HENRI MURGER, Scènes de la vie de jeunesse, 1851, page 32. 2. Par analogie et par euphémisme, domaine amoureux. [Le complément d'objet direct désigne une partie de la personne, une valeur morale] Aventurer sa réputation : Ø 5.... l'erreur c'est de ne considérer la femme que comme un instrument de plaisir. Pourtant, devant certains exemples, j'en viens à douter s'il n'y a pas plus de danger encore à ne mettre en enjeu que sa chair, et si celui qui se tire du piège de l'amour à moins de frais n'est pas précisément celui qui n'y aventure que la moindre et plus médiocre part de lui-même. ANDRÉ GIDE, Journal, 1928, page 887. 3. Au figuré, domaine de la recherche intellectuelle, spirituelle. [Le complément d'objet direct désigne une chose abstraite] : Ø 6. Senti spécialement mon impuissance. Toute ascension, toute entreprise, toute création me font peur maintenant Je ne puis plus rien oser, aventurer, tenter. HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL, Journal intime, 1866, page 381. Ø 7.... et maintenant Raboliot savait, sans une faute, ce qu'il pouvait oser et ce qu'il ne pouvait pas. À condition qu'il observât une maîtrise de soi vigilante, il était libre de vivre sans tristesse, et même, s'il le méritait, avec joie. Car c'est une joie, se possédant pleinement, d'aventurer sa vie aux frontières du péril, de le frôler à son vouloir, ou bien, d'un vif élan calculé juste, de bondir soudain au travers, comme on franchit d'un saut, à la saint-Jean d'été, les braises rouges des feux de joie. MAURICE GENEVOIX, Raboliot, 1925, page 145. II.— Emploi pronominal. S'aventurer. A.— Rare. Se laisser aller à l'aventure, au hasard : Ø 8. Le malheur fut qu'aux dons et legs une complication devait surgir. Là, pas de concierge!... (...), le courant d'air de la voûte le glaçant jusque dans les moelles, il prit une brusque résolution et s'aventura au hasard. Une muraille soubassée d'un ton de chocolat et où se succédaient, peints en noir sous la mention « gardiens de bureau », une série d'index allongés, l'amena à une sorte de chenil... GEORGES MOINAUX, DIT GEORGES COURTELINE, Messieurs les ronds de cuir, 1893, page 188. Remarque : On rencontre dans la documentation le néologisme aventurement, substantif masculin (Edmond et Jules DE GONCOURT, Journal, 1891, page 77; suffixe -ment1 *). Action de s'aventurer.Action de s'aventurer. B.— S'engager dans une aventure, se jeter dans un danger, courir un risque. Antonymes : s'assurer, se défier, prendre garde. 1. Domaine des entreprises, des affaires concret [Le complément circonstanciel désigne un lieu] Pouvoir s'aventurer : Ø 9. Vous ne me soupçonnerez pas de pusillanimité. Le premier, je vous ai entraînés à travers l'Amérique, à travers l'Australie. Mais ici, je le répète, tout vaut mieux que de s'aventurer dans ce pays perfide. — Tout vaut mieux que de s'exposer à une perte certaine sur un navire échoué, fit John Mangles. — Qu'avons-nous donc tant à redouter de la Nouvelle-Zélande? demanda Glenarvan. — Les sauvages, répondit Paganel. JULES VERNE, Les Enfants du capitaine Grant, tome 3, 1868, page 58. Ø 10.... le peuple besogneux de fileurs, de lamineurs, de puddleurs, d'ouvrières, semble avoir déserté les maisons d'un commun accord et s'être mis en route, rue Notre-Dame, vers quelque aventure. Lui aussi, souvent, avait erré par des nuits pareilles, cherchant il ne savait quelle mystérieuse joie à la mesure du ciel étendu sur sa tête comme un envoûtement. Il s'aventura jusqu'au bout du quai. GABRIELLE ROY, Bonheur d'occasion, 1945, page 347. — Par analogie. [Le sujet désigne un animal, une chose concrète] : Ø 11. Au moment d'aller porter le lait (...) la Péchina ne se hasarda point sans procéder à une enquête, comme une chatte qui s'aventure hors de sa maison. HONORÉ DE BALZAC, Les Paysans, 1844, page 203. Ø 12.... dès que, sous une forme quelconque, le travail s'engage et s'aventure dans cette nappe d'alluvions, les résistances souterraines abondent. Ce sont des argiles liquides, des sources vives, des roches dures, de ces vases molles et profondes que la science spéciale appelle moutardes. Le pic avance laborieusement dans des lames calcaires... VICTOR HUGO, Les Misérables, tome 2, 1862, page 524. 2. Au figuré, domaine de la recherche intellectuelle, spirituelle. [Le complément circonstanciel désigne une chose abstraite] : Ø 13. En vérité, je voyage, mais dans des pays inconnus et si, pour fuir la réalité torride, je me plais à évoquer des images froides, je te dirai que je suis depuis un mois dans les plus purs glaciers de l'esthétique — qu'après avoir trouvé le néant, j'ai trouvé le beau, — et que tu ne peux t'imaginer dans quelles altitudes lucides je m'aventure. STÉPHANE MALLARMÉ, Correspondance, 1866, page 221. Ø 14.... il est fort possible que pour pénétrer plus avant dans les régions où ils [nos oculistes] s'aventurent, les méthodes purement expérimentales, qui sont les plus sûres dans les autres sciences, soient insuffisantes. MAURICE MAETERLINCK, Le Grand secret, 1921, page 300. — Exceptionnellement, absolument : Ø 15. La partie est perdue, que je ne pouvais gagner qu'avec elle. Inconfiance de sa part, et présomption de la mienne. Rien ne sert de récriminer, ni de regretter même. Ce qui n'est pas, c'est ce qui ne pouvait pas être. Qui se dirige vers l'inconnu, doit consentir à s'aventurer seul. ANDRÉ GIDE, Journal, 1927, page 840. — Spécialement, domaine de l'expression verbale. S'aventurer à + infinitif, s'aventurer (beaucoup) en + participe présent, s'aventurer (beaucoup) que de + infinitif ou absolument : Ø 16. « (...) Mais dans des grandes machines comme ici, non, ça me passe que vous veniez. À moins que ce ne soit pour faire des études... », ajouta-t-elle d'un air de doute, de méfiance, et sans trop s'aventurer car elle ne savait pas très exactement en quoi consistait le genre d'opérations improbables auquel elle faisait allusion. MARCEL PROUST, Le Temps retrouvé, 1922, page 1026. 3. Par analogie et par euphémisme, domaine amoureux. [Le complément circonstanciel désigne une personne, (le degré d'avancement dans) une intrigue, etc.] : Ø 17. Il eut pitié de cette petite vivante qui était à son côté, (...) pitié d'elle, de la voir s'aventurer ainsi dans des mains telles que les siennes (et cependant, la moindre petite ruse ou seulement précaution qu'il eût décelée en elle, contre lui, il lui en eût fait grief). Pitié d'elle, de ne l'aimer pas davantage, de ne trouver pas davantage des raisons de l'aimer, — et qu'elle ne fût pour lui qu'une parmi d'autres, alors qu'il était le seul pour elle,... HENRI DE MONTHERLANT, Pitié pour les femmes, 1936, page 1159. — Exceptionnellement, absolument : Ø 18. Maintenant, elle savait où elle allait. Tout s'orientait vers cette lumière que la présence de Jean avait introduite dans son existence, la transfigurant Elle avait souvent l'impression de céder à un vertige, d'être aventurée au plus haut point; elle s'en souciait peu. Quand bien même ne serait-elle, entre les mains de Jean Paleyzieux, qu'un jouet, quand bien même son bonheur présent devrait-il la conduire à une plus affreuse solitude, elle préférait tout risquer et tout perdre, pour posséder du moins ces heures de bonheur,... HENRI PETIOT, DIT DANIEL-ROPS, Mort, où est ta victoire? 1934, page 164.