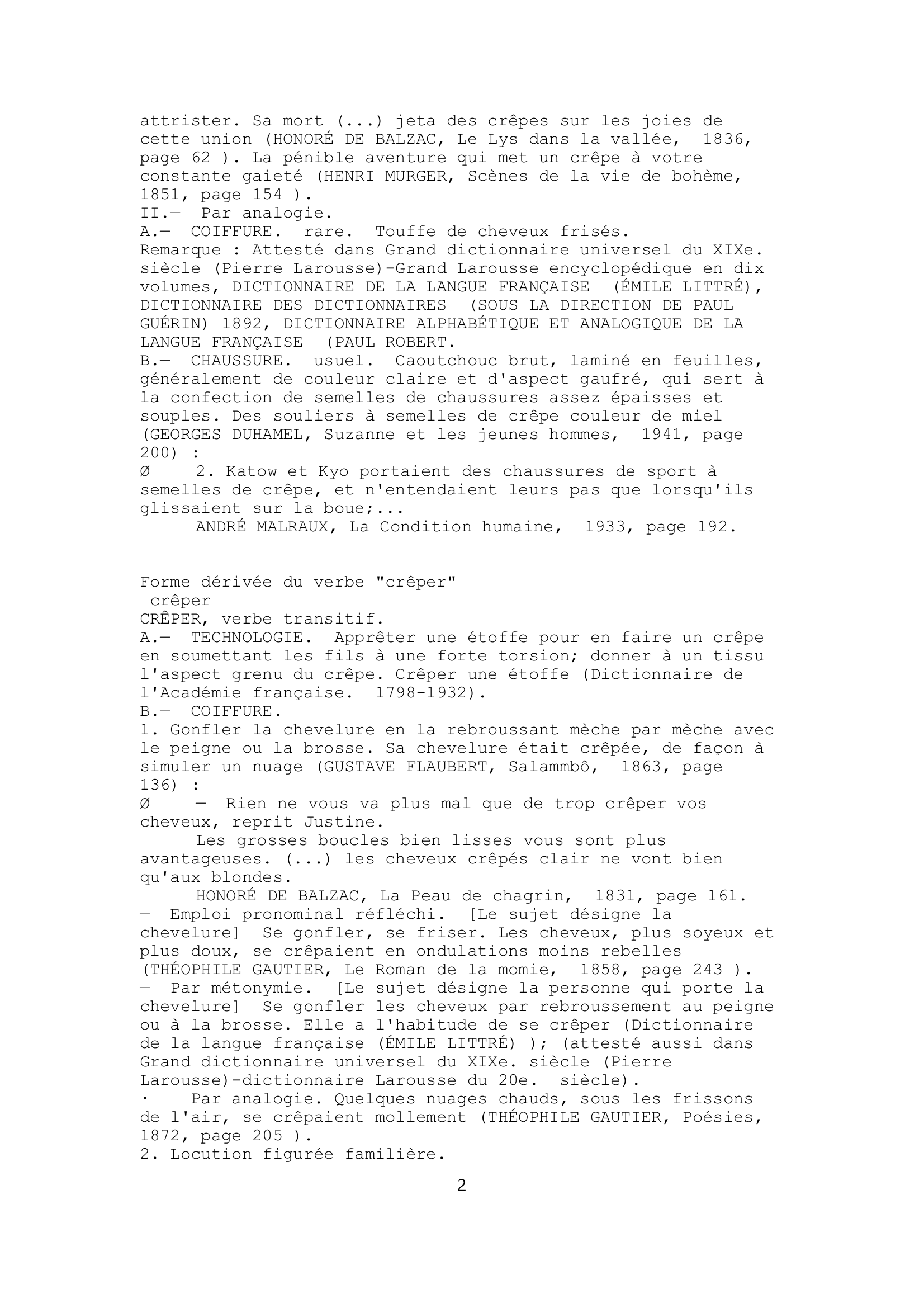Définition du terme: CRÊPE1, substantif masculin.
Publié le 04/12/2015

Extrait du document
«
attrister.
Sa mort (...) jeta des crêpes sur les joies de
cette union (HONORÉ DE BALZAC, Le Lys dans la vallée, 1836,
page 62 ).
La pénible aventure qui met un crêpe à votre
constante gaieté (HENRI MURGER, Scènes de la vie de bohème,
1851, page 154 ).
II.— Par analogie.
A.— COIFFURE.
rare.
Touffe de cheveux frisés.
Remarque : Attesté dans Grand dictionnaire universel du XIXe.
siècle (Pierre Larousse)-Grand Larousse encyclopédique en dix
volumes, DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE (ÉMILE LITTRÉ),
DICTIONNAIRE DES DICTIONNAIRES (SOUS LA DIRECTION DE PAUL
GUÉRIN) 1892, DICTIONNAIRE ALPHABÉTIQUE ET ANALOGIQUE DE LA
LANGUE FRANÇAISE (PAUL ROBERT.
B.— CHAUSSURE.
usuel.
Caoutchouc brut, laminé en feuilles,
généralement de couleur claire et d'aspect gaufré, qui sert à
la confection de semelles de chaussures assez épaisses et
souples.
Des souliers à semelles de crêpe couleur de miel
(GEORGES DUHAMEL, Suzanne et les jeunes hommes, 1941, page
200) :
Ø 2.
Katow et Kyo portaient des chaussures de sport à
semelles de crêpe, et n'entendaient leurs pas que lorsqu'ils
glissaient sur la boue;...
ANDRÉ MALRAUX, La Condition humaine, 1933, page 192.
Forme dérivée du verbe "crêper"
crêper
CRÊPER, verbe transitif.
A.— TECHNOLOGIE.
Apprêter une étoffe pour en faire un crêpe
en soumettant les fils à une forte torsion; donner à un tissu
l'aspect grenu du crêpe.
Crêper une étoffe (Dictionnaire de
l'Académie française.
1798-1932).
B.— COIFFURE.
1.
Gonfler la chevelure en la rebroussant mèche par mèche avec
le peigne ou la brosse.
Sa chevelure était crêpée, de façon à
simuler un nuage (GUSTAVE FLAUBERT, Salammbô, 1863, page
136) :
Ø — Rien ne vous va plus mal que de trop crêper vos
cheveux, reprit Justine.
Les grosses boucles bien lisses vous sont plus
avantageuses.
(...) les cheveux crêpés clair ne vont bien
qu'aux blondes.
HONORÉ DE BALZAC, La Peau de chagrin, 1831, page 161.
— Emploi pronominal réfléchi.
[Le sujet désigne la
chevelure] Se gonfler, se friser.
Les cheveux, plus soyeux et
plus doux, se crêpaient en ondulations moins rebelles
(THÉOPHILE GAUTIER, Le Roman de la momie, 1858, page 243 ).
— Par métonymie.
[Le sujet désigne la personne qui porte la
chevelure] Se gonfler les cheveux par rebroussement au peigne
ou à la brosse.
Elle a l'habitude de se crêper (Dictionnaire
de la langue française (ÉMILE LITTRÉ) ); (attesté aussi dans
Grand dictionnaire universel du XIXe.
siècle (Pierre
Larousse)-dictionnaire Larousse du 20e.
siècle).
· Par analogie.
Quelques nuages chauds, sous les frissons
de l'air, se crêpaient mollement (THÉOPHILE GAUTIER, Poésies,
1872, page 205 ).
2.
Locution figurée familière.
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Définition du terme: CYPRIPÈDE, CYPRIPEDIUM, substantif masculin.
- Définition du terme: CYPRIN, substantif masculin.
- Définition du terme: CYPRÈS, substantif masculin.
- Définition du terme: CYNOR(R)HODON, (CYNORHODON, CYNORRHODON) substantif masculin.
- Définition du terme: cynodonte extrait de l'article "CYN(O)-, (CYN-, CYNO-)" cynodonte (grec « dent »), substantif masculin , PALÉONTOLOGIE.