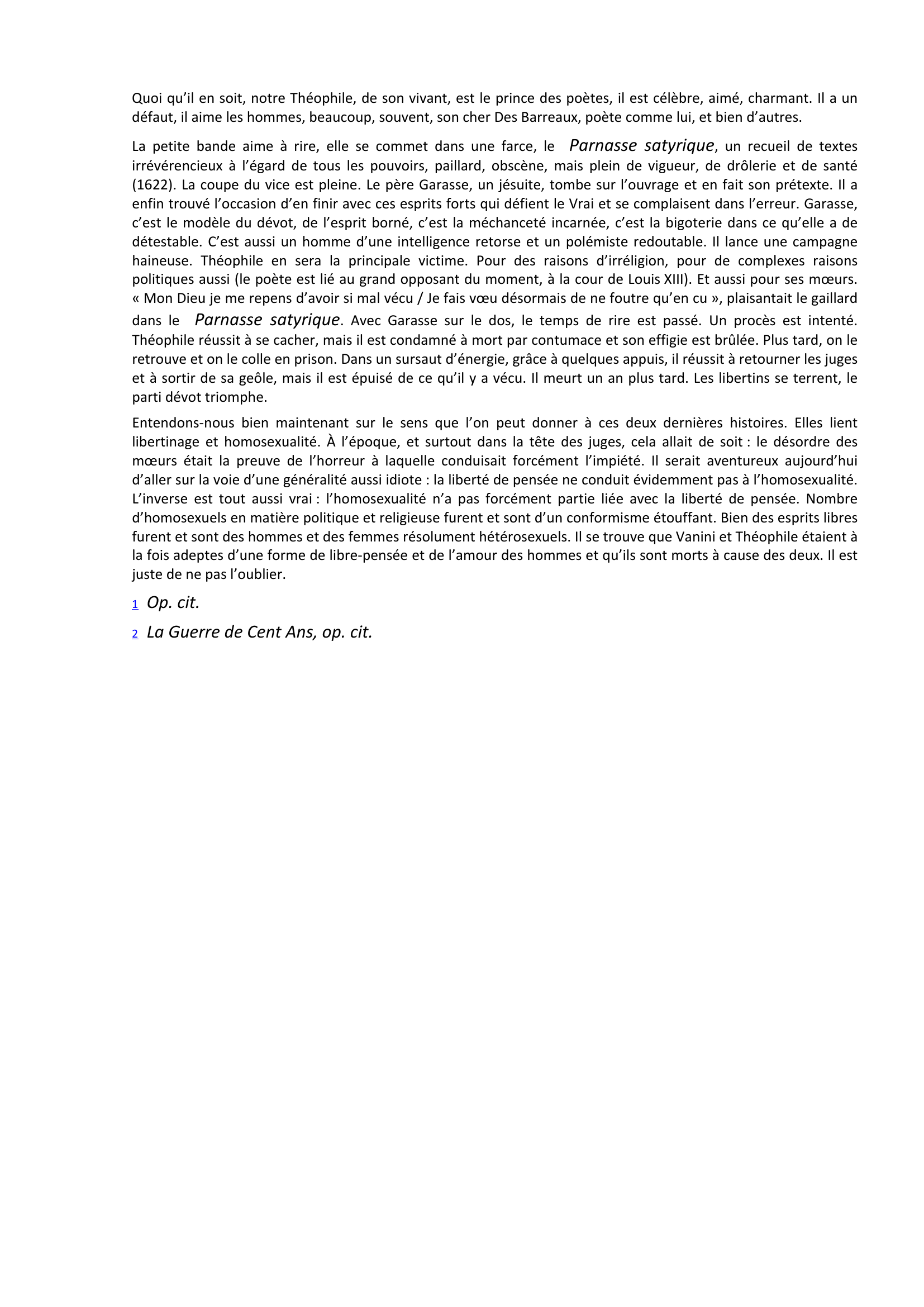entre gens de même sexe sont un péché, mais un péché parmi tous les autres, l'adultère, la zoophilie, etc.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
Quoi
qu’ilensoit, notre Théophile, deson vivant, estleprince despoètes, ilest célèbre, aimé,charmant.
Ilaun
défaut, ilaime leshommes, beaucoup, souvent,soncher DesBarreaux, poètecomme lui,etbien d’autres.
La petite bande aimeàrire, ellesecommet dansunefarce, le Parnasse
satyrique ,
un recueil detextes
irrévérencieux àl’égard detous lespouvoirs, paillard,obscène, maisplein devigueur, dedrôlerie etde santé
(1622).
Lacoupe duvice estpleine.
Lepère Garasse, unjésuite, tombesurl’ouvrage eten fait son prétexte.
Ila
enfin trouvé l’occasion d’enfiniravec cesesprits fortsquidéfient leVrai etse complaisent dansl’erreur.
Garasse,
c’est lemodèle dudévot, del’esprit borné,c’estlaméchanceté incarnée,c’estlabigoterie danscequ’elle ade
détestable.
C’estaussi unhomme d’uneintelligence retorseetun polémiste redoutable.
Illance unecampagne
haineuse.
Théophile ensera laprincipale victime.Pourdesraisons d’irréligion, pourdecomplexes raisons
politiques aussi(lepoète estliéau grand opposant dumoment, àla cour deLouis XIII).
Etaussi poursesmœurs.
« Mon Dieujeme repens d’avoir simal vécu /Je fais vœu désormais dene foutre qu’encu »,plaisantait legaillard
dans le Parnasse
satyrique .
Avec Garasse surledos, letemps derire estpassé.
Unprocès estintenté.
Théophile réussitàse cacher, maisilest condamné àmort parcontumace etson effigie estbrûlée.
Plustard, onle
retrouve eton lecolle enprison.
Dansunsursaut d’énergie, grâceàquelques appuis,ilréussit àretourner lesjuges
et àsortir desageôle, maisilest épuisé decequ’il ya vécu.
Ilmeurt unanplus tard.
Leslibertins seterrent, le
parti dévot triomphe.
Entendons-nous bienmaintenant surlesens quel’onpeut donner àces deux dernières histoires.Elleslient
libertinage ethomosexualité.
Àl’époque, etsurtout danslatête desjuges, celaallait desoit : ledésordre des
mœurs étaitlapreuve del’horreur àlaquelle conduisait forcément l’impiété.Ilserait aventureux aujourd’hui
d’aller surlavoie d’une généralité aussiidiote : laliberté depensée neconduit évidemment pasàl’homosexualité.
L’inverse esttout aussi vrai :l’homosexualité n’apas forcément partieliéeavec laliberté depensée.
Nombre
d’homosexuels enmatière politique etreligieuse furentetsont d’un conformisme étouffant.Biendesesprits libres
furent etsont deshommes etdes femmes résolument hétérosexuels.
Ilse trouve queVanini etThéophile étaientà
la fois adeptes d’uneforme delibre-pensée etde l’amour deshommes etqu’ils sontmorts àcause desdeux.
Ilest
juste denepas l’oublier.
1 Op.
cit.
2 La
Guerre deCent Ans,op.cit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéaire extrait Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir
- Analyse sociologique du travail du sexe
- Sujet : En quoi la socialisation est-elle un processus différencié selon le sexe ?
- détermination du sexe d'un embryon
- SEXE FAIBLE (le) d'Édouard Bourdet (résumé & analyse)