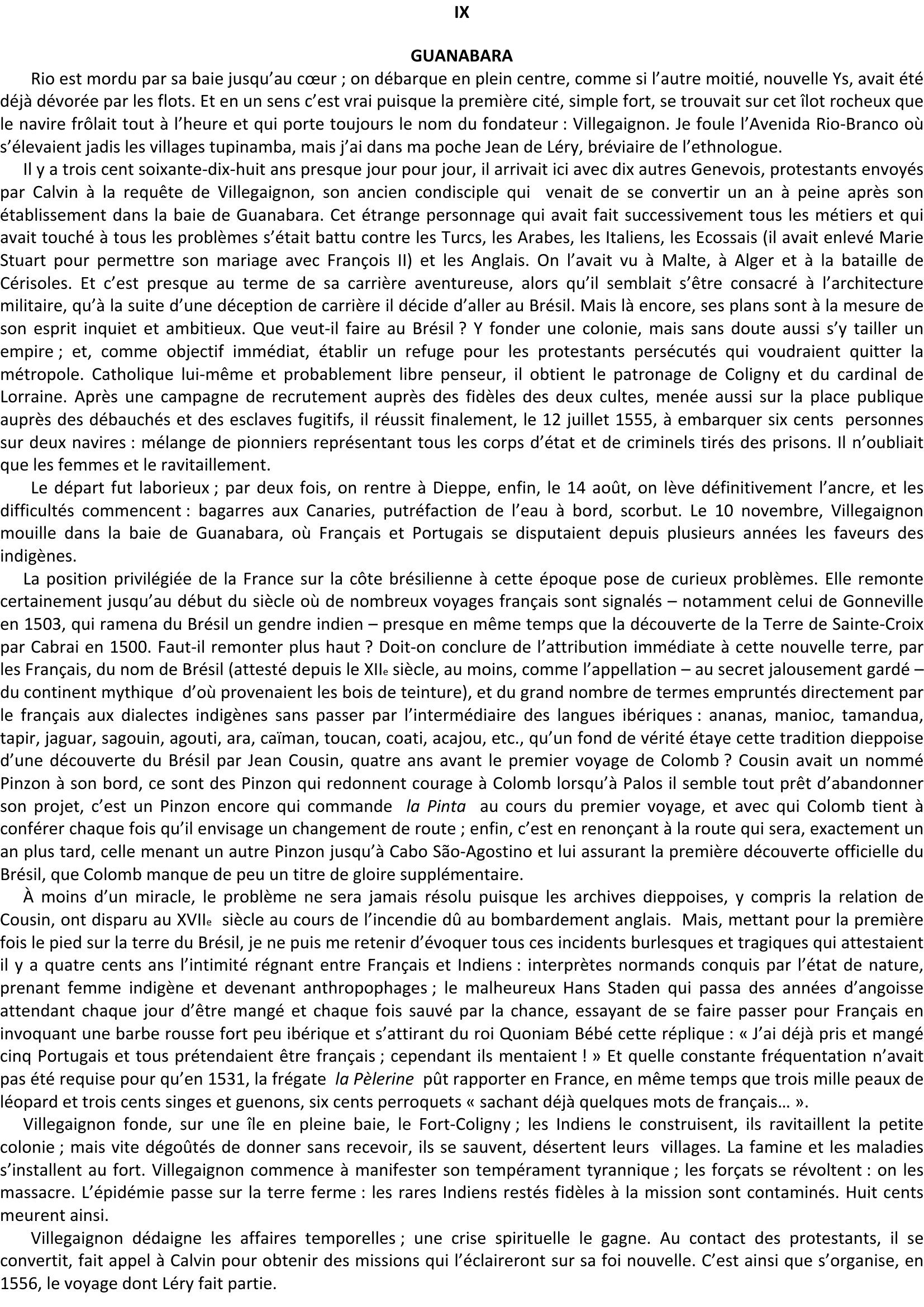illusion inverse de celle de New York, c'est la nature ici qui revêt l'aspect d'un chantier.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
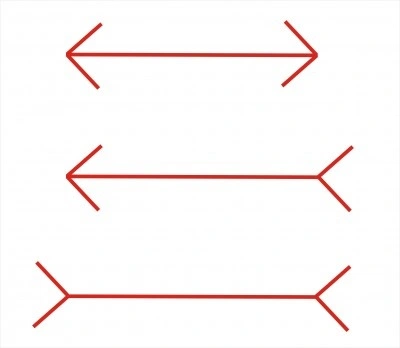
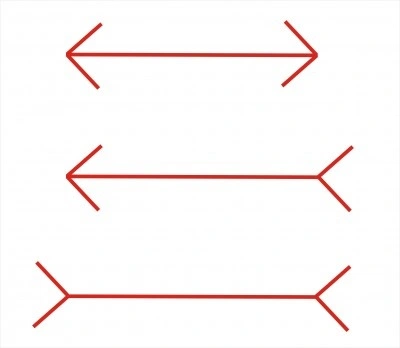
«
IX
GUANABARA Rio
estmordu parsabaie jusqu’au cœur ;ondébarque enplein centre, comme sil’autre moitié, nouvelle Ys,avait été
déjà dévorée parlesflots.
Eten un sens c’est vraipuisque lapremière cité,simple fort,setrouvait surcetîlot rocheux que
le navire frôlaittoutàl’heure etqui porte toujours lenom dufondateur : Villegaignon.
Jefoule l’Avenida Rio-Branco où
s’élevaient jadislesvillages tupinamba, maisj’aidans mapoche JeandeLéry, bréviaire del’ethnologue.
Il ya trois centsoixante-dix-huit anspresque jourpour jour,ilarrivait iciavec dixautres Genevois, protestants envoyés
par Calvin àla requête deVillegaignon, sonancien condisciple quivenait deseconvertir unanàpeine aprèsson
établissement danslabaie deGuanabara.
Cetétrange personnage quiavait faitsuccessivement touslesmétiers etqui
avait touché àtous lesproblèmes s’étaitbattucontre lesTurcs, lesArabes, lesItaliens, lesEcossais (ilavait enlevé Marie
Stuart pourpermettre sonmariage avecFrançois II)et les Anglais.
Onl’avait vuàMalte, àAlger etàla bataille de
Cérisoles.
Etc’est presque auterme desacarrière aventureuse, alorsqu’ilsemblait s’êtreconsacré àl’architecture
militaire, qu’àlasuite d’une déception decarrière ildécide d’allerauBrésil.
Maislàencore, sesplans sontàla mesure de
son esprit inquiet etambitieux.
Queveut-il faireauBrésil ? Yfonder unecolonie, maissansdoute aussis’ytailler un
empire ; et,comme objectif immédiat, établirunrefuge pourlesprotestants persécutésquivoudraient quitterla
métropole.
Catholiquelui-mêmeetprobablement librepenseur, ilobtient lepatronage deColigny etdu cardinal de
Lorraine.
Aprèsunecampagne derecrutement auprèsdesfidèles desdeux cultes, menée aussisurlaplace publique
auprès desdébauchés etdes esclaves fugitifs,ilréussit finalement, le12 juillet 1555,àembarquer sixcents personnes
sur deux navires : mélange depionniers représentant touslescorps d’état etde criminels tirésdesprisons.
Iln’oubliait
que lesfemmes etleravitaillement.
Le départ futlaborieux ; pardeux fois,onrentre àDieppe, enfin,le14 août, onlève définitivement l’ancre,etles
difficultés commencent : bagarresauxCanaries, putréfaction del’eau àbord, scorbut.
Le10 novembre, Villegaignon
mouille danslabaie deGuanabara, oùFrançais etPortugais sedisputaient depuisplusieurs annéeslesfaveurs des
indigènes.
Laposition privilégiée delaFrance surlacôte brésilienne àcette époque posedecurieux problèmes.
Elleremonte
certainement jusqu’audébutdusiècle oùdenombreux voyagesfrançaissontsignalés –notamment celuideGonneville
en 1503, quiramena duBrésil ungendre indien–presque enmême tempsqueladécouverte delaTerre deSainte-Croix
par Cabrai en1500.
Faut-il remonter plushaut ? Doit-on conclure del’attribution immédiateàcette nouvelle terre,par
les Français, dunom deBrésil (attesté depuisleXII e siècle, aumoins, comme l’appellation –au secret jalousement gardé–
du continent mythique d’oùprovenaient lesbois deteinture), etdu grand nombre determes empruntés directement par
le français auxdialectes indigènes sanspasser parl’intermédiaire deslangues ibériques : ananas,manioc, tamandua,
tapir, jaguar, sagouin, agouti,ara,caïman, toucan,coati,acajou, etc.,qu’un fonddevérité étayecettetradition dieppoise
d’une découverte duBrésil parJean Cousin, quatreansavant lepremier voyagedeColomb ? Cousinavaitunnommé
Pinzon àson bord, cesont desPinzon quiredonnent courageàColomb lorsqu’à Palosilsemble toutprêtd’abandonner
son projet, c’estunPinzon encore quicommande la
Pinta au
cours dupremier voyage,etavec quiColomb tientà
conférer chaquefoisqu’il envisage unchangement deroute ; enfin,c’estenrenonçant àla route quisera, exactement un
an plus tard, cellemenant unautre Pinzon jusqu’à CaboSão-Agostino etlui assurant lapremière découverte officielledu
Brésil, queColomb manque depeu untitre degloire supplémentaire.
À moins d’unmiracle, leproblème nesera jamais résolupuisque lesarchives dieppoises, ycompris larelation de
Cousin, ontdisparu auXVII esiècle aucours del’incendie dûaubombardement anglais.Mais,mettant pourlapremière
fois lepied surlaterre duBrésil, jene puis meretenir d’évoquer touscesincidents burlesques ettragiques quiattestaient
il ya quatre centsansl’intimité régnantentreFrançais etIndiens : interprètes normandsconquisparl’état denature,
prenant femmeindigène etdevenant anthropophages ; lemalheureux HansStaden quipassa desannées d’angoisse
attendant chaquejourd’être mangé etchaque foissauvé parlachance, essayant desefaire passer pourFrançais en
invoquant unebarbe rousse fortpeu ibérique ets’attirant duroi Quoniam Bébécette réplique : « J’aidéjàprisetmangé
cinq Portugais ettous prétendaient êtrefrançais ; cependant ilsmentaient ! » Etquelle constante fréquentation n’avait
pas étérequise pourqu’en 1531,lafrégate la
Pèlerine pût
rapporter enFrance, enmême tempsquetrois mille peaux de
léopard ettrois cents singes etguenons, sixcents perroquets « sachantdéjàquelques motsdefrançais… ».
Villegaignon fonde,surune îleen pleine baie,leFort-Coligny ; lesIndiens leconstruisent, ilsravitaillent lapetite
colonie ; maisvitedégoûtés dedonner sansrecevoir, ilsse sauvent, désertent leursvillages.
Lafamine etles maladies
s’installent aufort.
Villegaignon commenceàmanifester sontempérament tyrannique ;lesforçats serévoltent : onles
massacre.
L’épidémie passesurlaterre ferme : lesrares Indiens restésfidèles àla mission sontcontaminés.
Huitcents
meurent ainsi.
Villegaignon dédaignelesaffaires temporelles ; unecrise spirituelle legagne.
Aucontact desprotestants, ilse
convertit, faitappel àCalvin pourobtenir desmissions quil’éclaireront sursafoi nouvelle.
C’estainsiques’organise, en
1556, levoyage dontLéryfaitpartie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Procès Rosenberg I) Biographie à la première personne Je m'appelle Julius Rosenberg, je suis né à New York, aux États-Unis, en 1918, dans une famille juive.
- HISTOIRE DE NEW YORK PAR KNICKEBBOCKER (résumé)
- ALLER-RETOUR NEW YORK. (résumé)
- POÈTE A NEW YORK (Le) de Federico Garcia Lorca (résumé et analyse de l’oeuvre)
- eboy-New york