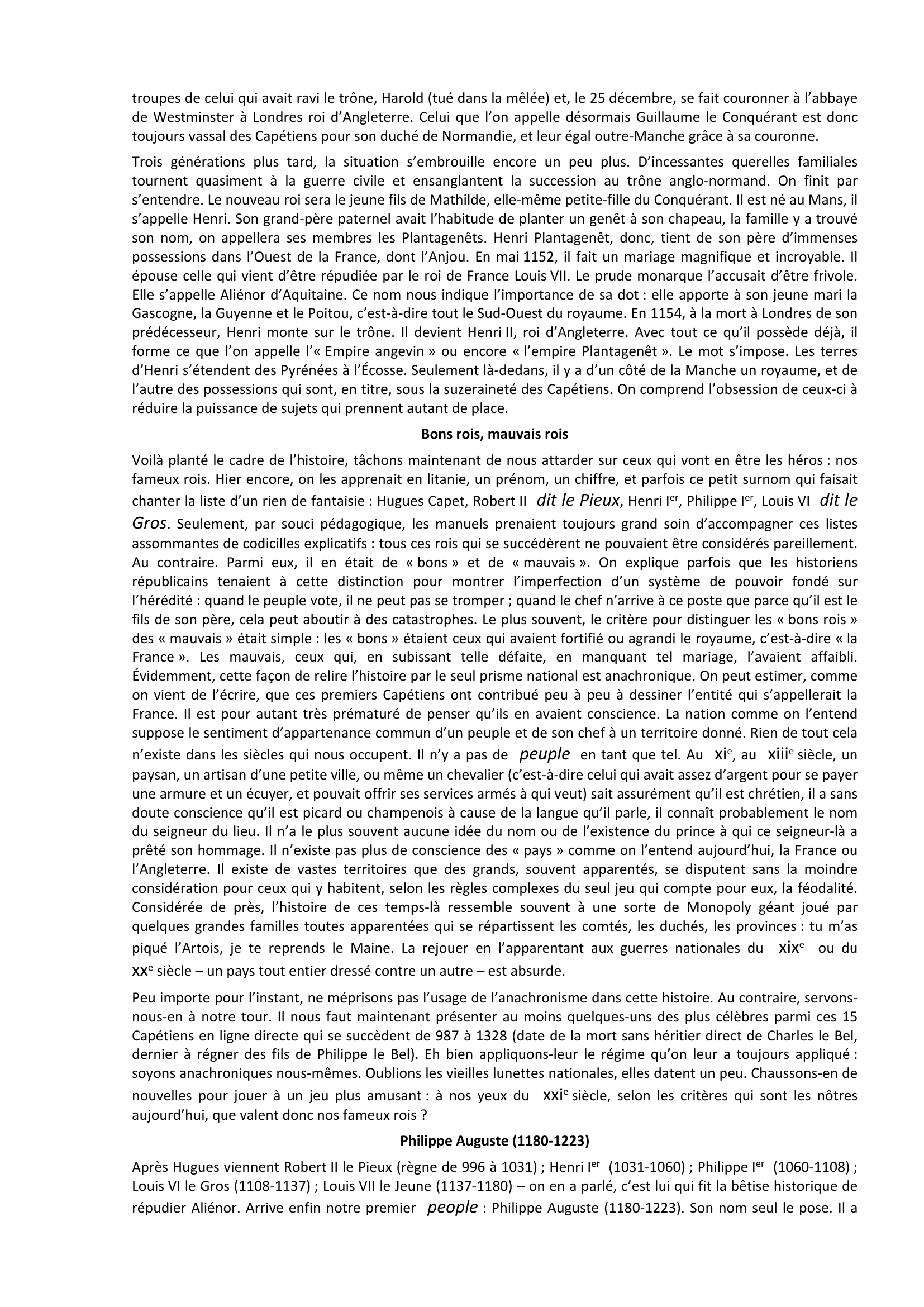La société féodale est aussi une société figée, où chacun est cloué dès la naissance à une place donnée comme éternelle.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
troupes
decelui quiavait raviletrône, Harold (tuédans lamêlée) et,le25 décembre, sefait couronner àl’abbaye
de Westminster àLondres roid’Angleterre.
Celuiquel’onappelle désormais GuillaumeleConquérant estdonc
toujours vassaldesCapétiens poursonduché deNormandie, etleur égal outre-Manche grâceàsa couronne.
Trois générations plustard, lasituation s’embrouille encoreunpeu plus.
D’incessantes querellesfamiliales
tournent quasiment àla guerre civileetensanglantent lasuccession autrône anglo-normand.
Onfinit par
s’entendre.
Lenouveau roisera lejeune filsdeMathilde, elle-même petite-filleduConquérant.
Ilest néau Mans, il
s’appelle Henri.Songrand-père paternelavaitl’habitude deplanter ungenêt àson chapeau, lafamille ya trouvé
son nom, onappellera sesmembres lesPlantagenêts.
HenriPlantagenêt, donc,tientdeson père d’immenses
possessions dansl’Ouest delaFrance, dontl’Anjou.
Enmai 1152, ilfait unmariage magnifique etincroyable.
Il
épouse cellequivient d’être répudiée parleroi deFrance Louis VII.
Leprude monarque l’accusaitd’êtrefrivole.
Elle s’appelle Aliénord’Aquitaine.
Cenom nous indique l’importance desadot : elleapporte àson jeune marila
Gascogne, laGuyenne etlePoitou, c’est-à-dire toutleSud-Ouest duroyaume.
En1154, àla mort àLondres deson
prédécesseur, Henrimonte surletrône.
Ildevient Henri II, roid’Angleterre.
Avectoutcequ’il possède déjà,il
forme ceque l’onappelle l’« Empire angevin »ouencore « l’empire Plantagenêt ».
Lemot s’impose.
Lesterres
d’Henri s’étendent desPyrénées àl’Écosse.
Seulement là-dedans,ilya d’un côtédelaManche unroyaume, etde
l’autre despossessions quisont, entitre, souslasuzeraineté desCapétiens.
Oncomprend l’obsession deceux-ci à
réduire lapuissance desujets quiprennent autantdeplace.
Bons
rois,mauvais rois Voilà
planté lecadre del’histoire, tâchonsmaintenant denous attarder surceux quivont enêtre leshéros : nos
fameux rois.Hierencore, onles apprenait enlitanie, unprénom, unchiffre, etparfois cepetit surnom quifaisait
chanter laliste d’un riendefantaisie : HuguesCapet,Robert II dit
lePieux ,
Henri I er
,Philippe I er
,Louis VI dit
le
Gros .
Seulement, parsouci pédagogique, lesmanuels prenaient toujoursgrandsoind’accompagner ceslistes
assommantes decodicilles explicatifs : touscesrois quisesuccédèrent nepouvaient êtreconsidérés pareillement.
Au contraire.
Parmieux,ilen était de« bons » etde « mauvais ».
Onexplique parfoisqueleshistoriens
républicains tenaientàcette distinction pourmontrer l’imperfection d’unsystème depouvoir fondésur
l’hérédité : quandlepeuple vote,ilne peut passetromper ; quandlechef n’arrive àce poste queparce qu’ilestle
fils deson père, celapeut aboutir àdes catastrophes.
Leplus souvent, lecritère pourdistinguer les« bons rois »
des « mauvais » étaitsimple : les« bons » étaientceuxquiavaient fortifiéouagrandi leroyaume, c’est-à-dire « la
France ».
Lesmauvais, ceuxqui,ensubissant telledéfaite, enmanquant telmariage, l’avaientaffaibli.
Évidemment, cettefaçon derelire l’histoire parleseul prisme national estanachronique.
Onpeut estimer, comme
on vient del’écrire, quecespremiers Capétiens ontcontribué peuàpeu àdessiner l’entitéquis’appellerait la
France.
Ilest pour autant trèsprématuré depenser qu’ilsenavaient conscience.
Lanation comme onl’entend
suppose lesentiment d’appartenance commund’unpeuple etde son chef àun territoire donné.Riendetout cela
n’existe danslessiècles quinous occupent.
Iln’y apas de peuple en
tant quetel.Au
xie
, au
xiiie
siècle, un
paysan, unartisan d’unepetite ville,oumême unchevalier (c’est-à-dire celuiquiavait assez d’argent poursepayer
une armure etun écuyer, etpouvait offrirsesservices armésàqui veut) saitassurément qu’ilestchrétien, ila sans
doute conscience qu’ilestpicard ouchampenois àcause delalangue qu’ilparle, ilconnaît probablement lenom
du seigneur dulieu.
Iln’a leplus souvent aucuneidéedunom oudel’existence duprince àqui ceseigneur-là a
prêté sonhommage.
Iln’existe pasplus deconscience des« pays » commeonl’entend aujourd’hui, laFrance ou
l’Angleterre.
Ilexiste devastes territoires quedesgrands, souvent apparentés, sedisputent sanslamoindre
considération pourceuxquiyhabitent, selonlesrègles complexes duseul jeuqui compte poureux,laféodalité.
Considérée deprès, l’histoire deces temps-là ressemble souventàune sorte deMonopoly géantjouépar
quelques grandesfamillestoutesapparentées quiserépartissent lescomtés, lesduchés, lesprovinces : tum’as
piqué l’Artois, jete reprends leMaine.
Larejouer enl’apparentant auxguerres nationales duxixe
ou du
xx e
siècle –un pays toutentier dressé contre unautre –est absurde.
Peu importe pourl’instant, neméprisons pasl’usage del’anachronisme danscette histoire.
Aucontraire, servons-
nous-en ànotre tour.Ilnous fautmaintenant présenteraumoins quelques-uns desplus célèbres parmices15
Capétiens enligne directe quisesuccèdent de987 à1328 (date delamort sanshéritier directdeCharles leBel,
dernier àrégner desfilsdePhilippe leBel).
Ehbien appliquons-leur lerégime qu’onleuratoujours appliqué :
soyons anachroniques nous-mêmes.Oublionslesvieilles lunettes nationales, ellesdatent unpeu.
Chaussons-en de
nouvelles pourjouer àun jeu plus amusant : ànos yeux duxxie
siècle, selonlescritères quisont lesnôtres
aujourd’hui, quevalent doncnosfameux rois ? Philippe
Auguste (1180-1223) Après
Hugues viennent Robert IIlePieux (règne de996 à1031) ; Henri Ier
(1031-1060) ; Philippe Ier
(1060-1108) ;
Louis VI leGros (1108-1137) ; Louis VIIleJeune (1137-1180) –on enaparlé, c’estluiqui fitlabêtise historique de
répudier Aliénor.Arriveenfinnotre premier people :
Philippe Auguste (1180-1223).
Sonnom seullepose.
Ila.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment la France met-elle en place un vaste empire colonial ? Comment émerge la société coloniale ?
- L'humour a-t-il encore un place libre dans notre société ?
- SOCIÉTÉ FÉODALE (La) de Marc Bloch (Résumé et analyse)
- Place de L'artiste dans la société
- Y a-t-il une place pour la philosophie dans une société qui accorde toute sa confiance à la raison scientifique et à la réussite technique?