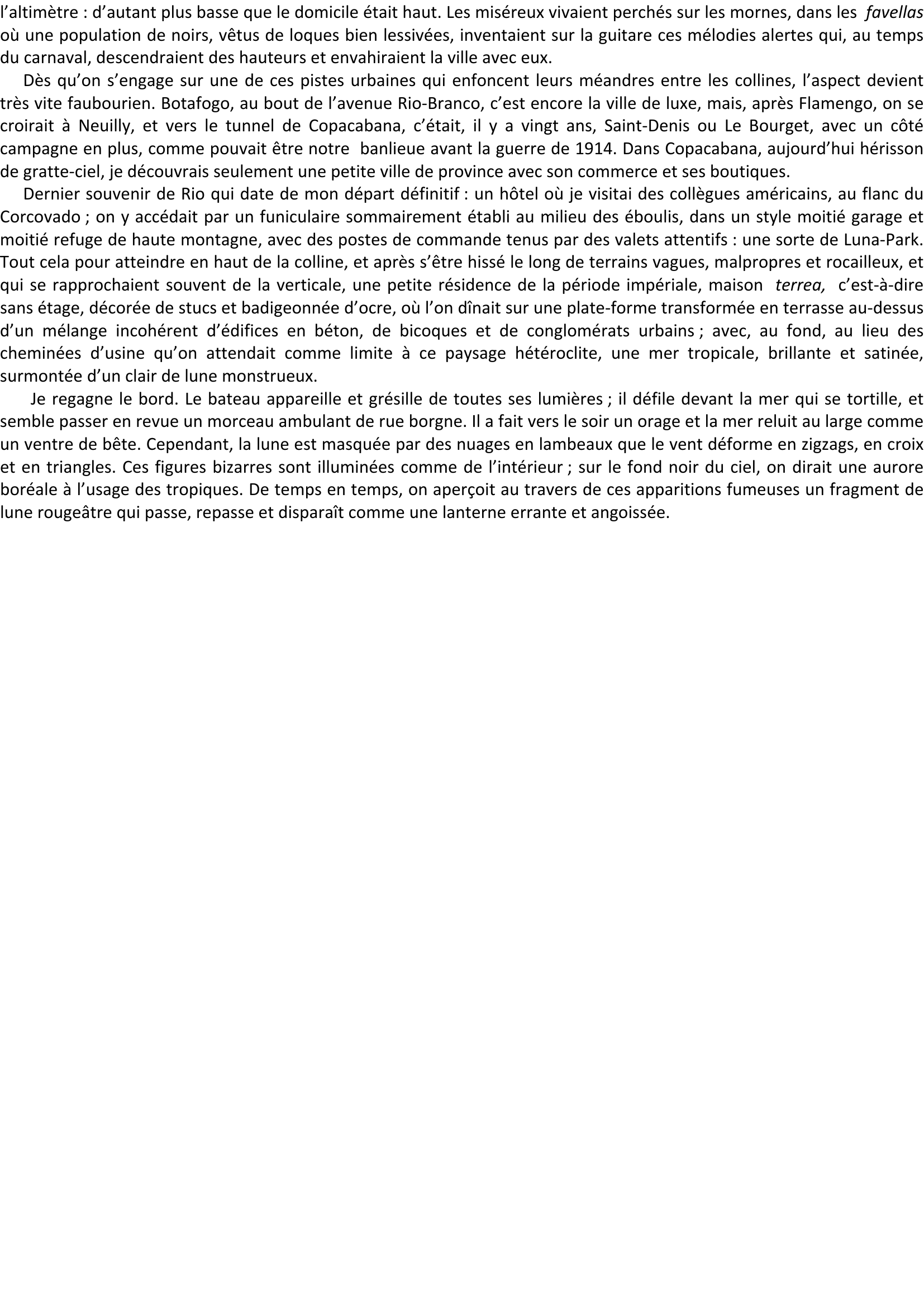rapportant solidairement à ces trois axes, et comme l'espace possède à lui seul trois dimensions, il en faudrait au moins inq pour se faire du voyage une représentation adéquate. Je l'éprouve tout de suite en débarquant au Brésil. Sans doute uis-je de l'autre côté de l'Atlantique et de l'équateur, et tout près du tropique. Bien des choses me l'attestent : cette haleur tranquille et humide qui affranchit mon corps de l'habituel poids de la laine et supprime l'opposition (que je écouvre rétrospectivement comme une des constantes de ma civilisation) entre la maison et la rue ; d'ailleurs, 'apprendrai vite que c'est seulement pour en introduire une autre, entre l'homme et la brousse, que mes paysages ntégralement humanisés ne comportaient pas ; il y a aussi les palmiers, des fleurs nouvelles, et, à la devanture des cafés, es amas de noix de coco vertes où l'on aspire, après les avoir décapitées, une eau sucrée et fraîche qui sent la cave. Mais j'éprouve aussi d'autres changements : j'étais pauvre et je suis riche ; d'abord parce que ma condition matérielle changé ; ensuite parce que le prix des produits locaux est incroyablement bas : cet ananas me coûterait vingt sous, ce régime de bananes deux francs, ces poulets qu'un boutiquier italien fait rôtir à la broche, quatre francs. On dirait le Palais de Dame Tartine. Enfin, l'état de disponibilité qu'instaure une escale, chance gratuitement offerte mais qui s'accompagne du sentiment de la contrainte d'en profiter, crée une attitude ambiguë propice à la suspension des contrôles les plus habituels et à la libération presque rituelle de la prodigalité. Sans doute le voyage peut-il agir de façon diamétralement opposée, j'en ai fait l'expérience quand je suis arrivé sans argent à New York après l'armistice ; mais, qu'il s'agisse en plus ou en moins, dans le sens d'une amélioration de la condition matérielle ou dans celui de sa détérioration, il faudrait un miracle pour que le voyage ne correspondît sous ce rapport à aucun changement. En même temps qu'il transporte à des milliers de kilomètres, le voyage fait gravir ou descendre quelques degrés dans l'échelle des statuts. Il éplace, mais aussi il déclasse - pour le meilleur et pour le pire - et la couleur et la saveur des lieux ne peuvent être issociées du rang toujours imprévu où il vous installe pour les goûter. Il y eut un temps où le voyage confrontait le voyageur à des civilisations radicalement différentes de la sienne et qui 'imposaient d'abord par leur étrangeté. Voilà quelques siècles que ces occasions deviennent de plus en plus rares. Que e soit dans l'Inde ou en Amérique, le voyageur moderne est moins surpris qu'il ne reconnaît. En choisissant des objectifs t des itinéraires, on se donne surtout la liberté de préférer telle date de pénétration, tel rythme d'envahissement de la ivilisation mécanique à tels autres. La quête de l'exotisme se ramène à la collection d'états anticipés ou retardés d'un éveloppement familier. Le voyageur devient un antiquaire, contraint par le manque d'objets à délaisser sa galerie d'art ègre pour se rabattre sur des souvenirs vieillots, marchandés au cours de ses promenades au marché aux puces de la erre habitée. Ces différences sont déjà perceptibles au sein d'une ville. Comme des plantes atteignant la floraison chacune à sa aison particulière, les quartiers portent la marque des siècles où se sont produits leur croissance, leur épanouissement et eur déclin. Dans ce parterre de végétation urbaine, il y a des concomitances et des successions. À Paris, le Marais était en leur au XVIIe siècle et la moisissure le ronge ; espèce plus tardive, le IXe arrondissement s'épanouissait sous le Second mpire, mais ses maisons aujourd'hui flétries sont occupées par une faune de petites gens qui, comme des insectes, y rouvent un terrain propice à d'humbles formes d'activité. Le XVIIe arrondissement reste figé dans son luxe défunt omme un grand chrysanthème portant noblement sa tête desséchée bien au-delà de son terme. Le XVIe était éclatant ier ; maintenant, ses fleurs brillantes se noient dans un taillis d'immeubles qui le confondent peu à peu avec un paysage e banlieue. Quand on compare entre elles des villes très éloignées par la géographie et l'histoire, ces différences de cycle se ompliquent encore de rythmes inégaux. Dès qu'on s'écarte du centre de Rio, qui fait alors très début de siècle, on tombe ans des rues tranquilles, de longues avenues plantées de palmiers, de manguiers et de palissandres taillés, où s'élèvent es villas désuètes dans des jardins. Je songe (comme je devais le faire plus tard dans les quartiers résidentiels de alcutta) à Nice ou à Biarritz sous Napoléon III. Les tropiques sont moins exotiques que démodés. Ce n'est pas la égétation qui les atteste, mais de menus détails d'architecture et la suggestion d'un genre de vie qui, plutôt que d'avoir ranchi d'immenses espaces, persuade qu'on s'est imperceptiblement reculé dans le temps. Rio de Janeiro n'est pas construite comme une ville ordinaire. Établie d'abord sur la zone plate et marécageuse qui orde la baie, elle s'est introduite entre les mornes abrupts qui l'enserrent de toutes parts, à la façon des doigts dans un ant trop étroit. Des tentacules urbains, longs parfois de vingt ou trente kilomètres, glissent au bas de formations ranitiques dont la pente est si raide que nulle végétation ne peut s'y accrocher ; parfois, sur une terrasse isolée ou dans ne cheminée profonde, un îlot de forêt s'est pourtant installé, d'autant plus véritablement vierge que l'endroit est naccessible malgré sa proximité : d'avion, on croirait frôler les branches, dans ces corridors frais et graves où l'on plane ntre des tapisseries somptueuses avant d'atterrir à leur pied. Cette ville si prodigue en collines les traite avec un mépris u'explique en partie le manque d'eau au sommet. Rio est, à cet égard, le contraire de Chittagong, sur le golfe du engale : dans une plaine marécageuse, des petites buttes coniques en glaise orangée, luisante sous l'herbe verte, y ortent chacune un bungalow solitaire, forteresse des riches qui se protègent de la chaleur pesante et de la pouillerie des as-fonds. À Rio, c'est l'inverse : ces calottes globuleuses, où le granit est pris en bloc comme une fonte, réverbèrent si iolemment la chaleur que la brise circulant au fond des défilés ne parvient pas à monter. Peut-être l'urbanisme a-t-il aintenant résolu le problème, mais en 1935, à Rio, la place occupée par chacun dans la hiérarchie sociale se mesurait à l'altimètre : d'autant plus basse que le domicile était haut. Les miséreux vivaient perchés sur les mornes, dans les favellas où une population de noirs, vêtus de loques bien lessivées, inventaient sur la guitare ces mélodies alertes qui, au temps u carnaval, descendraient des hauteurs et envahiraient la ville avec eux. Dès qu'on s'engage sur une de ces pistes urbaines qui enfoncent leurs méandres entre les collines, l'aspect devient rès vite faubourien. Botafogo, au bout de l'avenue Rio-Branco, c'est encore la ville de luxe, mais, après Flamengo, on se roirait à Neuilly, et vers le tunnel de Copacabana, c'était, il y a vingt ans, Saint-Denis ou Le Bourget, avec un côté ampagne en plus, comme pouvait être notre banlieue avant la guerre de 1914. Dans Copacabana, aujourd'hui hérisson e gratte-ciel, je découvrais seulement une petite ville de province avec son commerce et ses boutiques. Dernier souvenir de Rio qui date de mon départ définitif : un hôtel où je visitai des collègues américains, au flanc du orcovado ; on y accédait par un funiculaire sommairement établi au milieu des éboulis, dans un style moitié garage et oitié refuge de haute montagne, avec des postes de commande tenus par des valets attentifs : une sorte de Luna-Park. out cela pour atteindre en haut de la colline, et après s'être hissé le long de terrains vagues, malpropres et rocailleux, et ui se rapprochaient souvent de la verticale, une petite résidence de la période impériale, maison terrea, c'est-à-dire sans étage, décorée de stucs et badigeonnée d'ocre, où l'on dînait sur une plate-forme transformée en terrasse au-dessus 'un mélange incohérent d'édifices en béton, de bicoques et de conglomérats urbains ; avec, au fond, au lieu des heminées d'usine qu'on attendait comme limite à ce paysage hétéroclite, une mer tropicale, brillante et satinée, urmontée d'un clair de lune monstrueux. Je regagne le bord. Le bateau appareille et grésille de toutes ses lumières ; il défile devant la mer qui se tortille, et emble passer en revue un morceau ambulant de rue borgne. Il a fait vers le soir un orage et la mer reluit au large comme n ventre de bête. Cependant, la lune est masquée par des nuages en lambeaux que le vent déforme en zigzags, en croix et en triangles. Ces figures bizarres sont illuminées comme de l'intérieur ; sur le fond noir du ciel, on dirait une aurore boréale à l'usage des tropiques. De temps en temps, on aperçoit au travers de ces apparitions fumeuses un fragment de lune rougeâtre qui passe, repasse et disparaît comme une lanterne errante et angoissée. X PASSAGE DU TROPIQUE Le rivage entre Rio et Santos propose encore des tropiques de rêve. La chaîne côtière, qui dépasse en un point 2 000 ètres, dévale dans la mer et la découpe d'îlots et de criques ; des grèves de sable fin bordées de cocotiers ou de forêts umides, débordantes d'orchidées, viennent buter contre des parois de grès ou de basalte qui en interdisent l'accès, sauf e la mer. Des petits ports, distants l'un de l'autre d'une centaine de kilomètres, abritent les pêcheurs dans des demeures u XVIIIe siècle, maintenant en ruine et que jadis construisirent en pierres noblement taillées des armateurs, capitaines et ice-gouverneurs. Angra-dos-Reis, Ubatuba, Parati, São Sebastião, Villa-Bella, autant de points où l'or, les diamants, les opazes et les chrysolithes extraits dans les Minas Gérais, les « mines générales » du royaume, aboutissaient après des emaines de voyage à travers la montagne, transportés à dos de mulet. Quand on cherche la trace de ces pistes au long es espigões, lignes de crêtes, on a peine à évoquer un trafic si important qu'une industrie spéciale vivait de la écupération des fers perdus en route par les bêtes. Bougainville a raconté les précautions entourant l'exploitation et le transport. À peine extrait, l'or devait être remis à es Maisons de Fondation situées dans chaque district : Rio-das-Mortes, Sabara, Serro-Frio. On y percevait les droits de la ouronne, et ce qui revenait aux exploitants leur était remis en barres marquées de leur poids, leur titre, leur numéro et des armes du roi. Un comptoir central, situé à mi-chemin entre les mines et la côte, opérait un nouveau contrôle. Un lieutenant et cinquante hommes prélevaient le droit de quint, le droit de péage par tête d'homme et d'animal. Ce droit tait partagé entre le roi et le détachement ; aussi n'y avait-il rien de surprenant à ce que les caravanes, venant des mines t passant obligatoirement par ce registre, y fussent « arrêtées et fouillées avec la dernière rigueur ». Les particuliers portaient ensuite l'or en barres à la monnaie de Rio de Janeiro qui les échangeait contre des espèces monnayées, demi-doublons valant huit piastres d'Espagne, sur chacun desquels le roi gagnait une piastre par l'alliage et le droit de monnaie. Et Bougainville ajoute : « L'hôtel des monnaies... est un des plus beaux qui existent ; il est muni de toutes les commodités nécessaires pour y travailler avec la plus grande célérité. Comme l'or descend des mines dans le même temps où les flottes arrivent du Portugal, il faut accélérer le travail de la monnaie et elle s'y frappe avec une promptitude surprenante. » Pour les diamants, le système était plus strict encore. Les entrepreneurs, raconte Bougainville, « sont obligés de donner un compte exact des diamants trouvés et de les remettre entre les mains de l'intendant préposé par le roi à cet effet. Cet intendant les dépose aussitôt dans une cassette cerclée de fer et fermée avec trois serrures. Il a une des clefs, le vice-roi une autre et le provedor de l'Hacienda Reale, la troisième. Cette cassette est renfermée dans une seconde, où sont posés les cachets des trois personnes mentionnées ci-dessus, et qui contient les trois clefs de la première. Le vice-roi n'a pas le pouvoir de visiter ce qu'elle renferme. Il consigne seulement le tout à un troisième coffre-fort qu'il envoie à Lisbonne, après avoir apposé son cachet sur la serrure. L'ouverture s'en fait en présence du roi, qui choisit les diamants qu'il veut, et en paye le prix aux entrepreneurs sur le pied d'un tarif réglé par leur traité. » De cette intense activité qui, pour la seule année 1762, avait porté sur le transport, le contrôle, la frappe et l'expédition de cent dix-neuf arrobes d'or, c'est-à-dire plus d'une tonne et demie, rien ne subsiste au long de cette côte rendue à l'Éden, sinon quelques façades majestueuses et solitaires au fond de leur crique, murailles battues par les flots au pied desquelles abordaient les galions. Ces forêts grandioses, ces anses vierges, ces roches escarpées, on aimerait croire que seuls quelques indigènes aux pieds nus s'y sont laissé glisser du haut des plateaux, et non point qu'ils fournirent un site à des ateliers où, il y a deux cents ans encore, se forgeait la destinée du monde moderne. Après s'être repu d'or, le monde eut faim de sucre, mais le sucre consommait lui-même des esclaves. L'épuisement des mines - précédé d'ailleurs par la dévastation des forêts donnant le combustible aux creusets - l'abolition de l'esclavage, enfin une demande mondiale croissante orientent São Paulo et son port Santos vers le café. De jaune, puis blanc, l'or est devenu noir. Mais, malgré ces transformations qui ont fait de Santos un des centres du commerce international, le site reste d'une secrète beauté ; alors que le bateau pénètre lentement entre les îles, j'éprouve ici le premier choc des tropiques. Un chenal verdoyant nous enferme. En tendant la main, on pourrait presque saisir ces lantes que Rio retenait encore à distance, dans ses serres hautement accrochées. Sur une scène plus modeste, le contact avec le paysage s'établit. L'arrière-pays de Santos, plaine inondée, criblée de lagunes et de marais, sillonnée de rivières, de détroits et de canaux dont une buée nacrée estompe perpétuellement les contours, semble la terre même, émergeant au début de la création. Les bananeraies qui la couvrent sont du vert le plus jeune et le plus tendre qu'on puisse concevoir ; plus aigu que l'or vert des champs de jute dans le delta du Brahmapoutre avec quoi mon souvenir aime à les réunir : mais cette minceur même e la nuance, sa gracilité inquiète comparée à la paisible somptuosité de l'autre, contribuent à créer une ambiance primordiale. Pendant une demi-heure, on roule entre les bananiers, plantes mastodontes plutôt qu'arbres nains, troncs juteux qui s'achèvent dans un foisonnement de feuilles élastiques au-dessus d'une main aux cent doigts sortant d'un énorme lotus marron et rose. Puis, la route s'élève à huit cents mètres d'altitude jusqu'au sommet de la serra. Comme partout sur cette côte, des pentes abruptes ont protégé des atteintes de l'homme une forêt vierge si riche que, pour