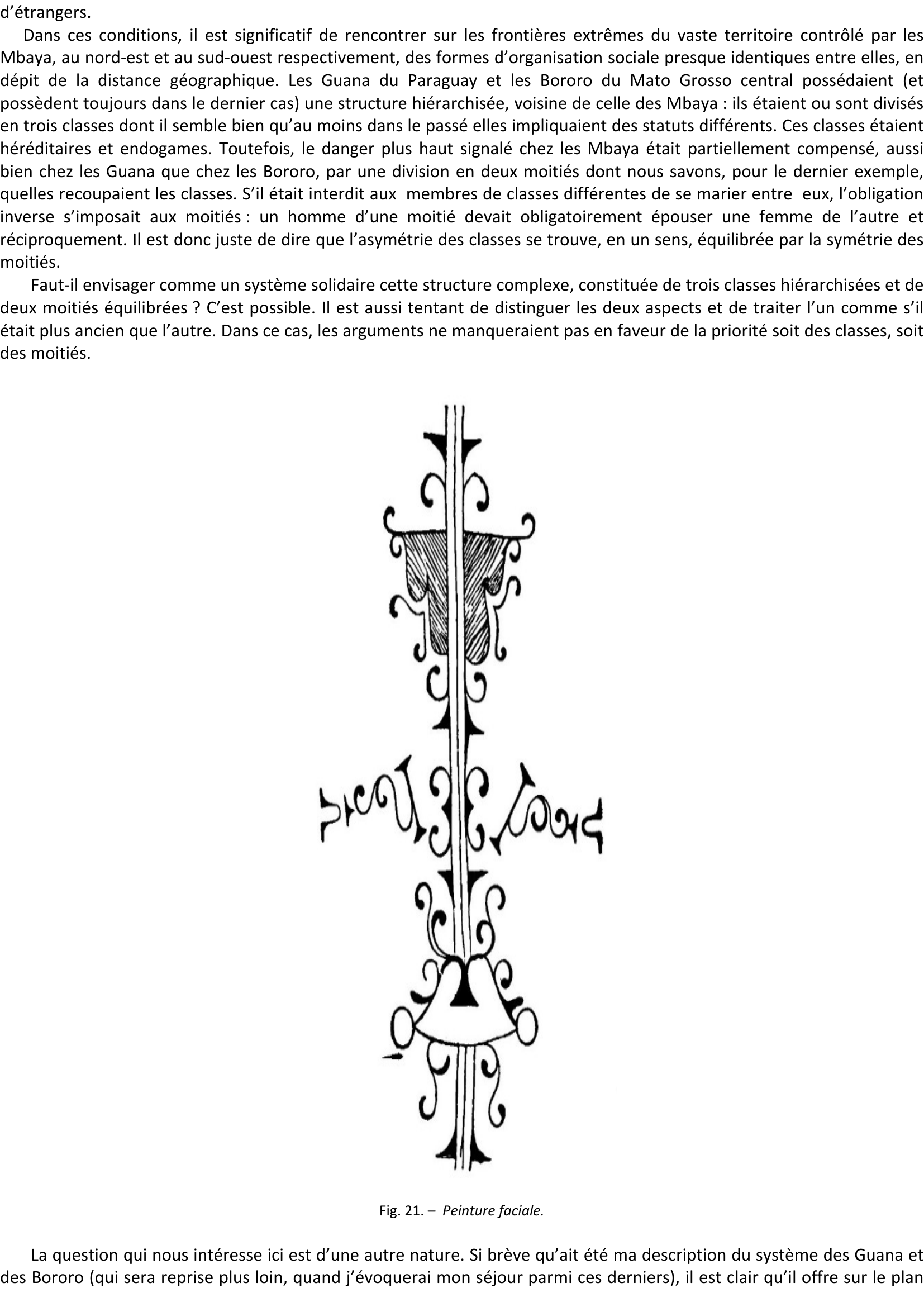tient à la fonction, et d'asymétrie qui répond au rôle.
Publié le 06/01/2014
Extrait du document
«
d’étrangers.
Dans cesconditions, ilest significatif derencontrer surlesfrontières extrêmesduvaste territoire contrôléparles
Mbaya, aunord-est etau sud-ouest respectivement, desformes d’organisation socialepresque identiques entreelles,en
dépit deladistance géographique.
LesGuana duParaguay etles Bororo duMato Grosso central possédaient (et
possèdent toujoursdansledernier cas)unestructure hiérarchisée, voisinedecelle desMbaya : ilsétaient ousont divisés
en trois classes dontilsemble bienqu’au moins danslepassé ellesimpliquaient desstatuts différents.
Cesclasses étaient
héréditaires etendogames.
Toutefois,ledanger plushaut signalé chezlesMbaya étaitpartiellement compensé,aussi
bien chez lesGuana quechez lesBororo, parune division endeux moitiés dontnous savons, pourledernier exemple,
quelles recoupaient lesclasses.
S’ilétait interdit auxmembres declasses différentes desemarier entreeux,l’obligation
inverse s’imposait auxmoitiés : unhomme d’unemoitié devaitobligatoirement épouserunefemme del’autre et
réciproquement.
Ilest donc justededire quel’asymétrie desclasses setrouve, enun sens, équilibrée parlasymétrie des
moitiés.
Faut-il envisager commeunsystème solidaire cettestructure complexe, constituée detrois classes hiérarchisées etde
deux moitiés équilibrées ? C’estpossible.
Ilest aussi tentant dedistinguer lesdeux aspects etde traiter l’uncomme s’il
était plusancien quel’autre.
Danscecas, lesarguments nemanqueraient pasenfaveur delapriorité soitdesclasses, soit
des moitiés.
Fig.
21.– Peinture
faciale.
La question quinous intéresse iciest d’une autrenature.
Sibrève qu’ait étémadescription dusystème desGuana et
des Bororo (quisera reprise plusloin, quand j’évoquerai monséjour parmicesderniers), ilest clair qu’il offre surleplan.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- 07/11/2011 Acides aminés et dérivés Définition : Dérivés bifonctionnels - fonction acide carboxylique - fonction amine Seulement 20 (21) amino acides naturels entrent dans la composition des protéines, traduits du code génétique supporté par les acides nucléiques Dans certains cas, des acides aminés pourront - après formation de la protéine - subir des modifications dites post translationnelles La composition en AA des protéines matures est donc un peu plus complexe 1 Structure
- Oméga vers lequel convergent les forces de l'Evolution doit, pour jouer son rôle de pôle attractif, être lui-même personnel et transcendant au Monde; aussi Teilhard écrira-t-il que « le Christ, hic et nunc, occupe pour nous, en position et en fonction, la place du Point Oméga ».
- Si l'expérimentation a une fonction dans les sciences de la nature qu'est-ce qui en tient lieu dans les sciences de l'homme ?
- Si l'expérimentation a une fonction dans les sciences de la nature, qu'est-ce qui en tient lieu dans les sciences de l'homme ?
- Quel rôle la pensée de la mort tient-elle dans l'existence ?