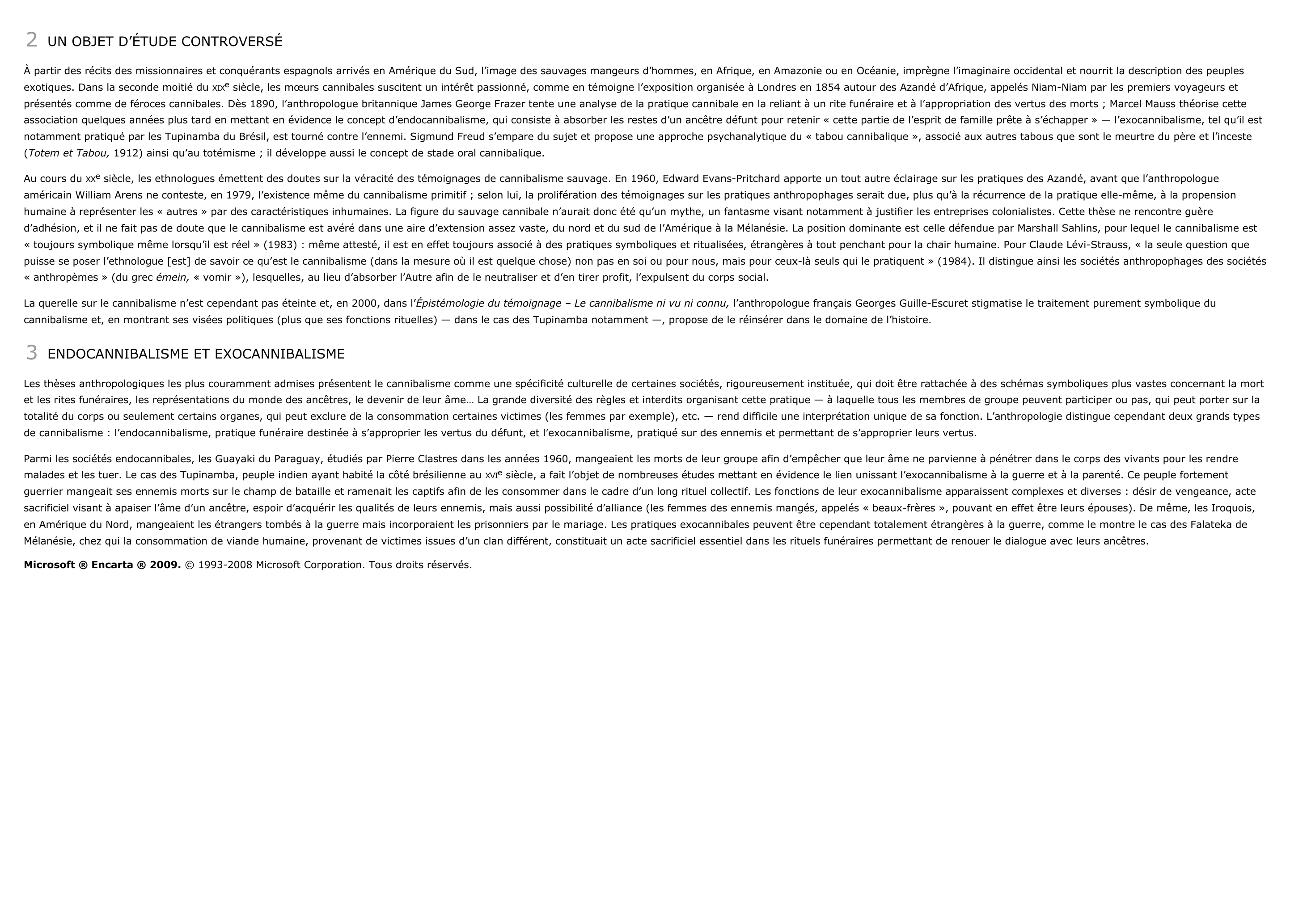cannibalisme - anthropologie.
Publié le 19/05/2013

Extrait du document
«
2 UN OBJET D’ÉTUDE CONTROVERSÉ
À partir des récits des missionnaires et conquérants espagnols arrivés en Amérique du Sud, l’image des sauvages mangeurs d’hommes, en Afrique, en Amazonie ou en Océanie, imprègne l’imaginaire occidental et nourrit la description des peuples
exotiques.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les mœurs cannibales suscitent un intérêt passionné, comme en témoigne l’exposition organisée à Londres en 1854 autour des Azandé d’Afrique, appelés Niam-Niam par les premiers voyageurs et
présentés comme de féroces cannibales.
Dès 1890, l’anthropologue britannique James George Frazer tente une analyse de la pratique cannibale en la reliant à un rite funéraire et à l’appropriation des vertus des morts ; Marcel Mauss théorise cette
association quelques années plus tard en mettant en évidence le concept d’endocannibalisme, qui consiste à absorber les restes d’un ancêtre défunt pour retenir « cette partie de l’esprit de famille prête à s’échapper » — l’exocannibalisme, tel qu’il est
notamment pratiqué par les Tupinamba du Brésil, est tourné contre l’ennemi.
Sigmund Freud s’empare du sujet et propose une approche psychanalytique du « tabou cannibalique », associé aux autres tabous que sont le meurtre du père et l’inceste
(Totem et Tabou, 1912) ainsi qu’au totémisme ; il développe aussi le concept de stade oral cannibalique.
Au cours du XXe siècle, les ethnologues émettent des doutes sur la véracité des témoignages de cannibalisme sauvage.
En 1960, Edward Evans-Pritchard apporte un tout autre éclairage sur les pratiques des Azandé, avant que l’anthropologue
américain William Arens ne conteste, en 1979, l’existence même du cannibalisme primitif ; selon lui, la prolifération des témoignages sur les pratiques anthropophages serait due, plus qu’à la récurrence de la pratique elle-même, à la propension
humaine à représenter les « autres » par des caractéristiques inhumaines.
La figure du sauvage cannibale n’aurait donc été qu’un mythe, un fantasme visant notamment à justifier les entreprises colonialistes.
Cette thèse ne rencontre guère
d’adhésion, et il ne fait pas de doute que le cannibalisme est avéré dans une aire d’extension assez vaste, du nord et du sud de l’Amérique à la Mélanésie.
La position dominante est celle défendue par Marshall Sahlins, pour lequel le cannibalisme est
« toujours symbolique même lorsqu’il est réel » (1983) : même attesté, il est en effet toujours associé à des pratiques symboliques et ritualisées, étrangères à tout penchant pour la chair humaine.
Pour Claude Lévi-Strauss, « la seule question que
puisse se poser l’ethnologue [est] de savoir ce qu’est le cannibalisme (dans la mesure où il est quelque chose) non pas en soi ou pour nous, mais pour ceux-là seuls qui le pratiquent » (1984).
Il distingue ainsi les sociétés anthropophages des sociétés
« anthropèmes » (du grec émein, « vomir »), lesquelles, au lieu d’absorber l’Autre afin de le neutraliser et d’en tirer profit, l’expulsent du corps social.
La querelle sur le cannibalisme n’est cependant pas éteinte et, en 2000, dans l’ Épistémologie du témoignage – Le cannibalisme ni vu ni connu, l’anthropologue français Georges Guille-Escuret stigmatise le traitement purement symbolique du
cannibalisme et, en montrant ses visées politiques (plus que ses fonctions rituelles) — dans le cas des Tupinamba notamment —, propose de le réinsérer dans le domaine de l’histoire.
3 ENDOCANNIBALISME ET EXOCANNIBALISME
Les thèses anthropologiques les plus couramment admises présentent le cannibalisme comme une spécificité culturelle de certaines sociétés, rigoureusement instituée, qui doit être rattachée à des schémas symboliques plus vastes concernant la mort
et les rites funéraires, les représentations du monde des ancêtres, le devenir de leur âme… La grande diversité des règles et interdits organisant cette pratique — à laquelle tous les membres de groupe peuvent participer ou pas, qui peut porter sur la
totalité du corps ou seulement certains organes, qui peut exclure de la consommation certaines victimes (les femmes par exemple), etc.
— rend difficile une interprétation unique de sa fonction.
L’anthropologie distingue cependant deux grands types
de cannibalisme : l’endocannibalisme, pratique funéraire destinée à s’approprier les vertus du défunt, et l’exocannibalisme, pratiqué sur des ennemis et permettant de s’approprier leurs vertus.
Parmi les sociétés endocannibales, les Guayaki du Paraguay, étudiés par Pierre Clastres dans les années 1960, mangeaient les morts de leur groupe afin d’empêcher que leur âme ne parvienne à pénétrer dans le corps des vivants pour les rendre
malades et les tuer.
Le cas des Tupinamba, peuple indien ayant habité la côté brésilienne au XVIe siècle, a fait l’objet de nombreuses études mettant en évidence le lien unissant l’exocannibalisme à la guerre et à la parenté.
Ce peuple fortement
guerrier mangeait ses ennemis morts sur le champ de bataille et ramenait les captifs afin de les consommer dans le cadre d’un long rituel collectif.
Les fonctions de leur exocannibalisme apparaissent complexes et diverses : désir de vengeance, acte
sacrificiel visant à apaiser l’âme d’un ancêtre, espoir d’acquérir les qualités de leurs ennemis, mais aussi possibilité d’alliance (les femmes des ennemis mangés, appelés « beaux-frères », pouvant en effet être leurs épouses).
De même, les Iroquois,
en Amérique du Nord, mangeaient les étrangers tombés à la guerre mais incorporaient les prisonniers par le mariage.
Les pratiques exocannibales peuvent être cependant totalement étrangères à la guerre, comme le montre le cas des Falateka de
Mélanésie, chez qui la consommation de viande humaine, provenant de victimes issues d’un clan différent, constituait un acte sacrificiel essentiel dans les rituels funéraires permettant de renouer le dialogue avec leurs ancêtres.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Anthropologie de l'habitat
- De l'anthropologie structurale au structuralisme
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- UE 1.1. S1 Psychologie, sociologie, anthropologie Les grands domaines de la psychologie
- ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE PRAGMATIQUE, Emmanuel Kant