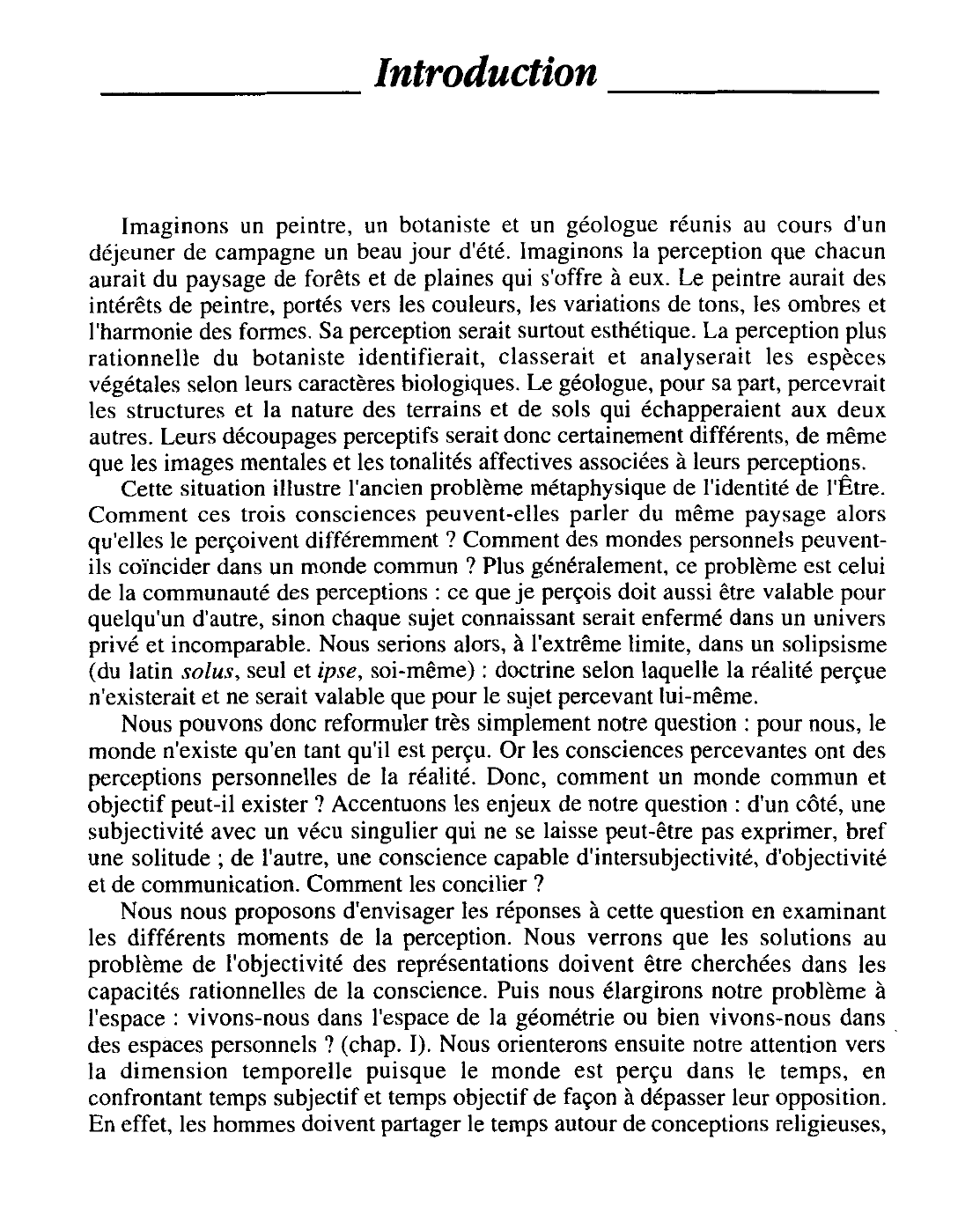Le temps, l'espace - La mémoire, la perception
Publié le 21/03/2015

Extrait du document

Le temps objectif est supra-individuel bien que du point de vue d'une conscience, la temporalité objective puisse à tout moment se remplir de subjectivité : la temporalité mathématique étant, comme l'espace abstrait, une temporalité pensée.
La physique relativiste nous apprend que le temps et l'espace sont relatifs à la vitesse du référent, à la masse et au champ de gravitation exercés sur le référent, bref que le temps n'est plus un absolu, ainsi que le croyait Newton dans les Principia mathématica (1687), mais une dimension composant avec l'espace une entité variable : l'espace-temps.
Cette révolution relativiste a creusé un écart important entre notre intuition naturelle du temps, accordée à nos expériences à l'échelle de notre expérience sensible, et la conception utilisée par les astrophysiciens.
Le temps a cessé d'être un th�me métaphysique relevant exclusivement de la philosophie puisque la physique, la thermodynamique, l'astrophysique traitent de sa réalité, de son infinité, et de son irréversibilité objective à travers les théories du chaos ou de celle du Big-Bang.
Nous pourrions appeler «temps anthropologiques� les syst�mes d'organisation sociale du temps : rythmes de la vie religieuse, rythmes du travail et de loisir, rythmes des fêtes.
Stephen W. Hawking, Une br�ve histoire du temps, chap.
D'un côté, les cycles éternels des astres et l'immortalité des dieux ; de l'autre, les affaires humaines et les existences fugitives des hommes se succédant de génération en génération.
Il est temps de revenir à notre question de départ : temps objectif ou temps subjectif?
Ainsi, nombre de philosophies voient dans les plaisirs de l'esprit, de la compréhension de soi et du monde, bref dans une sagesse, le véritable rem�de aux souffrances engendrées par le temps.
L'homme pourrait-il vivre sans la conscience du passé?
Imaginons la perception que chacun aurait du paysage de forêts et de plaines qui s'offre à eux.
Nous verrons que les solutions au probl�me de l'objectivité des représentations doivent être cherchées dans les capacités rationnelles de la conscience.
Puis nous élargirons notre probl�me à l'espace : vivons-nous dans l'espace de la géométrie ou bien vivons-nous dans des espaces personnels?
Il faut comprendre cette affirmation en ceci que la sensation brute est impossible à isoler dans une conscience percevante car l'objet perçu est déjà muni de propriétés : couleurs, formes, finalité etc. qui sont attribuées à l'objet.
Or le processus rationnel liant l'objet à ses propriétés n'est autre qu'un jugement : un acte rationnel consistant à lier un sujet logique (l'objet) à ses prédicats (ses propriétés).
Nous aurions donc tort de séparer la perception des processus rationnels de la conscience puisque la perception est englobée dans l'acte de conscience, et que cette derni�re est toujours conscience de quelque chose.
Naturellement, la perception peut isoler son objet et le structurer avant qu'il soit identifié rationnellement, dans la perception musicale ou dans la contemplation de peintures non figuratives.
Notre définition s'est efforcée de ne pas opposer temps vécu et temps pensé.
La raison est essentiellement une faculté de l'homo faber tournée vers l'usage.
L'intuition, au contraire, rév�le un moi profond, qui constitue la conscience de soi par une mémoire active et originale.
L'intuition nous rév�le donc la durée, c'est-à-dire la nature de la vie conçue comme dynamisme créateur ; elle se place en quelque sorte dans le mouvement vital.
Cette responsabilité individuelle, sociale, politique ou écologique, à l'égard du futur, exprime profondément notre condition d'êtres conscients et libres.
Le temps objectif est supra-individuel bien que du point de vue d'une conscience, la temporalité objective puisse à tout moment se remplir de subjectivité : la temporalité mathématique étant, comme l'espace abstrait, une temporalité pensée.
La physique relativiste nous apprend que le temps et l'espace sont relatifs à la vitesse du référent, à la masse et au champ de gravitation exercés sur le référent, bref que le temps n'est plus un absolu, ainsi que le croyait Newton dans les Principia mathématica (1687), mais une dimension composant avec l'espace une entité variable : l'espace-temps.
Cette révolution relativiste a creusé un écart important entre notre intuition naturelle du temps, accordée à nos expériences à l'échelle de notre expérience sensible, et la conception utilisée par les astrophysiciens.
Nous pourrions appeler «temps anthropologiques� les syst�mes d'organisation sociale du temps : rythmes de la vie religieuse, rythmes du travail et de loisir, rythmes des fêtes.
Stephen W. Hawking, Une br�ve histoire du temps, chap.
Ainsi, nombre de philosophies voient dans les plaisirs de l'esprit, de la compréhension de soi et du monde, bref dans une sagesse, le véritable rem�de aux souffrances engendrées par le temps.
I. Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement, § 1.

«
Introduction ~~~~~~~~~~-
Imaginons un peintre, un botaniste et un géologue réunis au cours d'un
déjeuner de campagne un beau jour d'été.
Imaginons
la perception que chacun
aurait du paysage de forêts et de plaines qui s'offre
à eux.
Le peintre aurait des
intérêts de peintre, portés vers les couleurs, les variations de tons, les ombres et
l'harmonie des formes.
Sa perception serait surtout esthétique.
La perception plus
rationnelle du botaniste identifierait, classerait et analyserait les espèces
végétales selon leurs caractères biologiques.
Le géologue, pour sa part, percevrait
les structures et la nature des terrains et de sols qui échapperaient aux deux
autres.
Leurs découpages perceptifs serait donc certainement différents, de même
que les images mentales et les tonalités affectives associées à leurs perceptions.
Cette situation illustre l'ancien problème métaphysique de l'identité de !'Être.
Comment ces trois consciences peuvent-elles parler du même paysage alors
qu'elles le perçoivent différemment ? Comment des mondes personnels peuvent
ils coïncider dans un monde commun ? Plus généralement, ce problème est celui
de la communauté des perceptions : ce que
je perçois doit aussi être valable pour
quelqu'un d'autre, sinon chaque sujet connaissant serait enfermé dans un univers
privé et incomparable.
Nous serions alors, à l'extrême limite, dans un solipsisme
(du latin solus, seul et ipse, soi-même): doctrine selon laquelle la réalité perçue
n'existerait et ne serait valable que pour
le sujet percevant lui-même.
Nous pouvons donc reformuler très simplement notre question : pour nous,
le
monde n'existe qu'en tant qu'il est perçu.
Or les consciences percevantes ont des
perceptions personnelles de la réalité.
Donc, comment un monde commun et
objectif peut-il
exister? Accentuons les enjeux de notre question: d'un côté, une
subjectivité avec un vécu singulier qui ne se laisse peut-être pas exprimer, bref
une solitude ; de l'autre, une conscience capable d'intersubjectivité, d'objectivité
et de communication.
Comment les concilier ?
Nous nous proposons d'envisager les réponses
à cette question en examinant
les différents moments de la perception.
Nous verrons que les solutions au
problème de l'objectivité des représentations doivent être cherchées dans les
capacités rationnelles de la conscience.
Puis nous élargirons notre problème
à
l'espace : vivons-nous dans l'espace de la géométrie ou bien vivons-nous dans
des espaces personnels? (chap.
I).
Nous orienterons ensuite notre attention vers
la dimension temporelle puisque le monde est perçu dans le temps, en
confrontant temps subjectif et temps objectif de façon à dépasser leur opposition.
En effet, les hommes doivent partager le temps autour de conceptions religieuses,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La perception dispose de l’espace dans l'exacte proportion où l’action dispose du temps. » Henri Bergson (1859-1941)
- Temps, espace et perception
- La perception dispose de l'espace dans l'exacte proportion où l'action dispose du temps. Matière et mémoire Bergson, Henri. Commentez cette citation.
- La perception dispose de l'espace dans l'exacte proportion où l'action dispose du temps. [ Matière et mémoire ] Bergson, Henri. Commentez cette citation.
- « Je ne suis pas dans l'espace et dans le temps, je ne pense pas l'espace et le temps; je suis à l'espace et au temps, mon corps s'applique à eux et les embrasse. » Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945. Commentez cette citation.