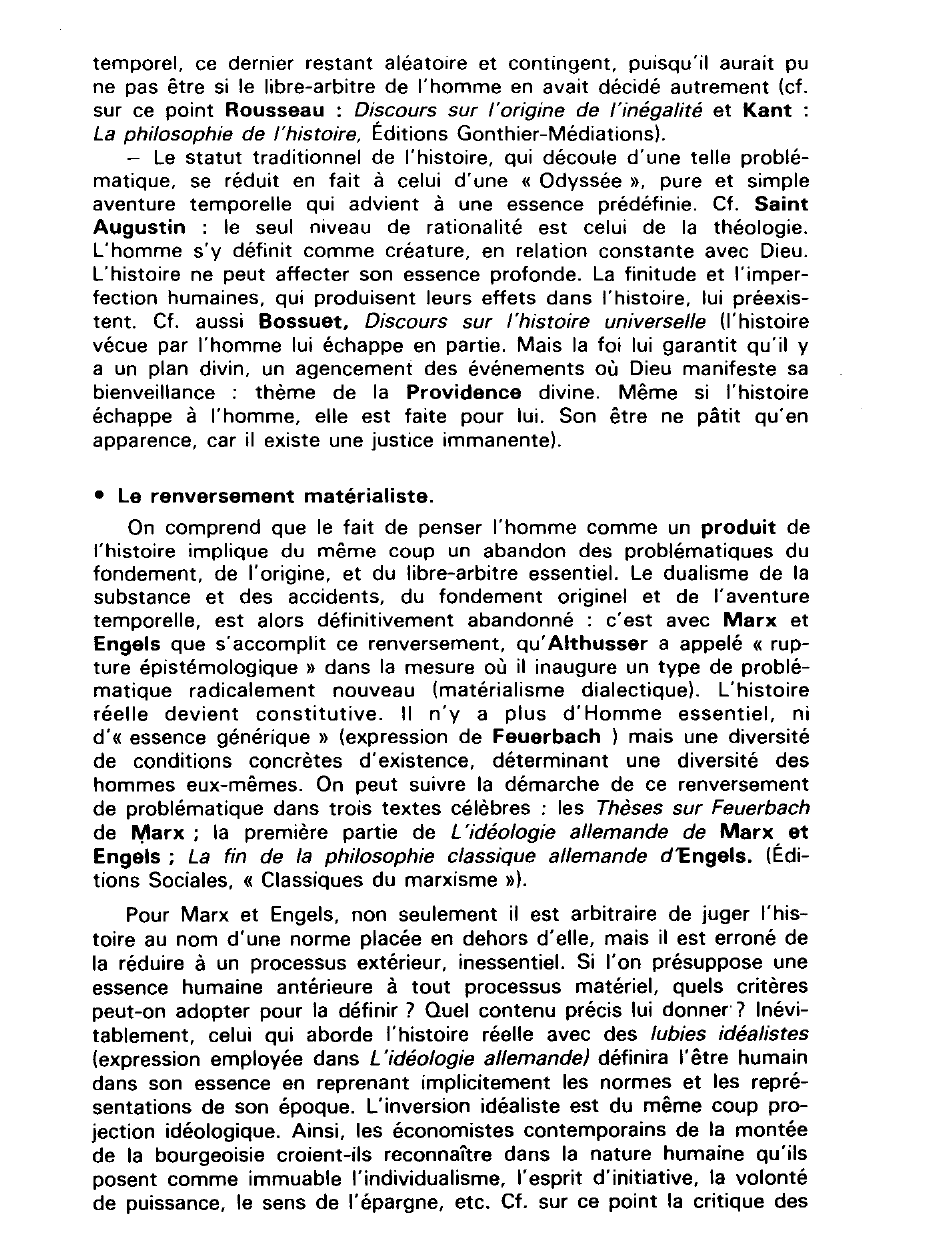L'HISTOIRE (processus réel).
Publié le 01/04/2014

Extrait du document

- L'homme n'est devenu que tardivement un objet de réflexion
pour lui-même. Si les interrogations philosophiques traditionnelles partent
de l'existence humaine saisie comme une donnée, pour évaluer son
statut dans l'univers, ses possibilités de connaissance ou d'action, elles
ne posent que tr�s rarement le probl�me de la formation de l'homme
lui-même, de sa gen�se historique. Indépendamment des représentations
religieuses qui substituent une théorie de la création à ce probl�me,
l'affirmation de l'existence d'une «nature humaine� prédéfinie
ne semble pas avoir été réellement mise en question jusqu'à une époque
récente. Le xviiie si�cle lui-même, que l'on prend souvent - et à
tort - pour le si�cle de l'histoire, continue à poser les probl�mes en
termes de «nature humaine�, même si les problématiques de l'origine
(Rousseau) s'efforcent de dissocier, en une démarche de déduction
théorique, la nature «premi�re� de l'homme et ce qu'elle est devenue
historiquement. Mais le statut de l'histoire réelle reste encore flou dans
cette perspective, dans la mesure où l'on tend à la ranger encore dans
lordre de laccidentel, de ce qui est extérieur

«
temporel, ce dernier restant aléatoire et contingent, puisqu'il aurait pu
ne pas être si le libre-arbitre de l'homme en avait décidé autrement (cf.
sur ce point Rousseau : Discours sur /'origine de /'inégalité et Kant : La philosophie de /'histoire, Éditions Gonthier-Médiations).
-Le statut traditionnel de l'histoire, qui découle d'une telle problé matique, se réduit en fait à celui d'une «Odyssée».
pure et simple aventure temporelle qui advient à une essence prédéfinie.
Cf.
Saint Augustin : le seul niveau de rationalité est celui de la théologie.
L'homme s'y définit comme créature, en relation constante avec Dieu.
L'histoire ne peut affecter son essence profonde.
La finitude et l'imper fection humaines, qui produisent leurs effets dans l'histoire, lui préexis tent.
Cf.
aussi Bossuet.
Discours sur /'histoire universelle (l'histoire vécue par l'homme lui échappe en partie.
Mais la foi lui garantit qu'il y
a un plan divin, un agencement des événements où Dieu manifeste sa bienveillance : thème de la Providence divine.
Même si l'histoire échappe à l'homme, elle est faite pour lui.
Son être ne pâtit qu'en apparence, car il existe une justice immanente).
• Le renversement matérialiste.
On comprend que le fait de penser l'homme comme un produit de l'histoire implique du même coup un abandon des problématiques du fondement, de lorigine, et du libre-arbitre essentiel.
Le dualisme de la substance et des accidents, du fondement originel et de laventure temporelle, est alors définitivement abandonné : c'est avec Marx et Engels que s'accomplit ce renversement, qu' Althusser a appelé « rup ture épistémologique » dans la mesure où il inaugure un type de problé matique radicalement nouveau (matérialisme dialectique).
L'histoire réelle devient constitutive.
Il n'y a plus d' Homme essentiel, ni d'« essence générique» (expression de Feuerbach ) mais une diversité de conditions concrètes d'existence, déterminant une diversité des hommes eux-mêmes.
On peut suivre la démarche de ce renversement de problématique dans trois textes célèbres : les Thèses sur Feuerbach de Marx ; la première partie de L'idéologie allemande de Marx et Engels ; La fin de la philosophie classique allemande d'Engels.
(Édi tions Sociales, « Classiques du marxisme »).
Pour Marx et Engels, non seulement il est arbitraire de juger l'his toire au nom d'une norme placée en dehors d'elle, mais il est erroné de la réduire à un processus extérieur, inessentiel.
Si lon présuppose une
essence humaine antérieure à tout processus matériel, quels critères peut-on adopter pour la définir ? Quel contenu précis lui donner·? Inévi tablement, celui qui aborde l'histoire réelle avec des lubies idéalistes (expression employée dans L'idéologie allemande) définira l'être humain dans son essence en reprenant implicitement les normes et les repré sentations de son époque.
L'inversion idéaliste est du même coup pro jection idéologique.
Ainsi, les économistes contemporains de la montée de la bourgeoisie croient-ils reconnaître dans la nature humaine qu'ils posent comme immuable l'individualisme, l'esprit d'initiative, la volonté de puissance, le sens de lépargne, etc.
Cf.
sur ce point la critique des
41.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation: Peut-on considérer que la métropolisation engendre à la fois un processus de concentration et d’accentuation des inégalités ?
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Histoire de l'esclavage
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer: Une histoire des mathématiques (résumé)
- Bill Bryson: Histoire de tout, ou presque ...