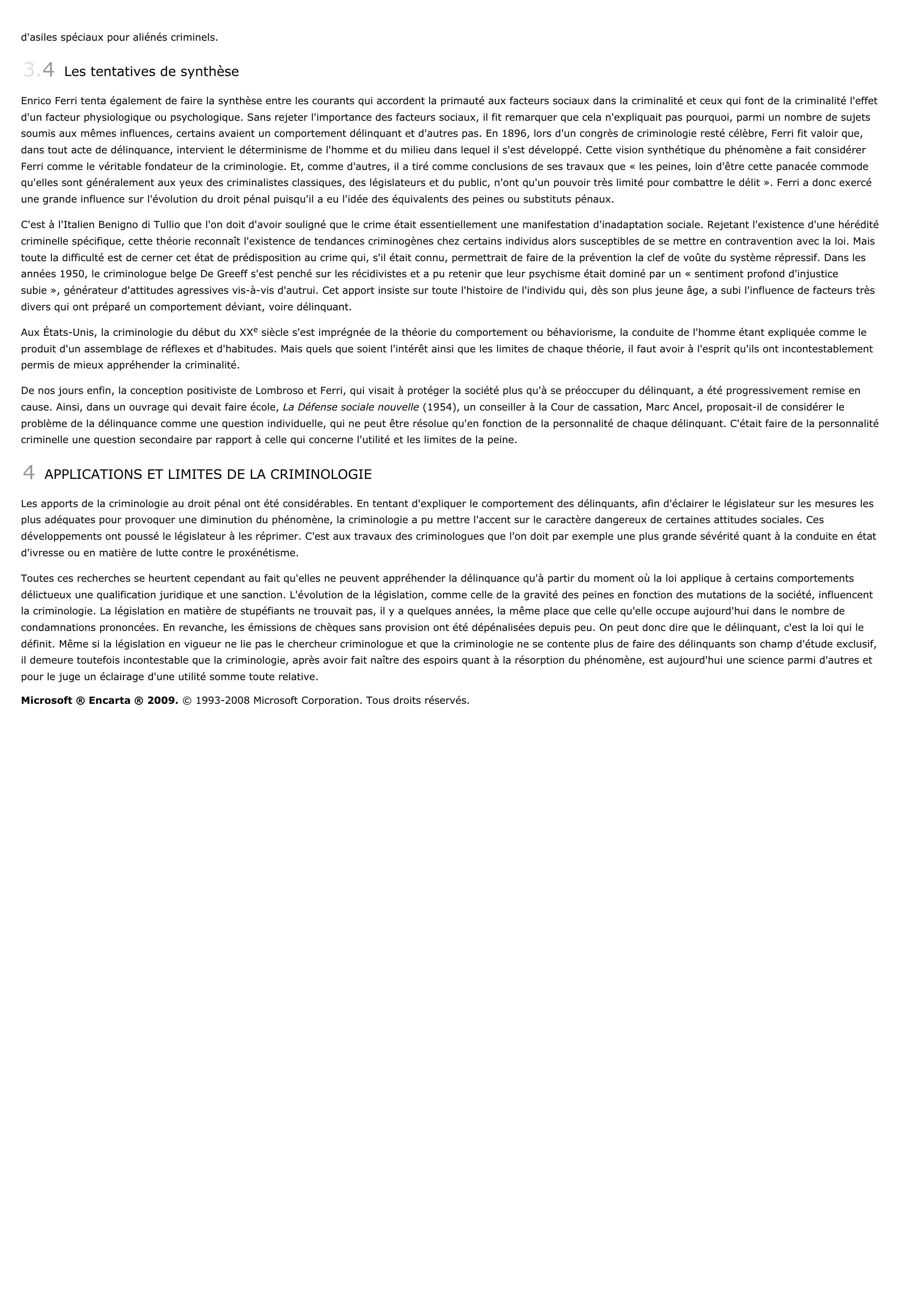criminologie (cours de droit pénal).
Publié le 20/05/2013

Extrait du document


«
d'asiles spéciaux pour aliénés criminels.
3.4 Les tentatives de synthèse
Enrico Ferri tenta également de faire la synthèse entre les courants qui accordent la primauté aux facteurs sociaux dans la criminalité et ceux qui font de la criminalité l'effetd'un facteur physiologique ou psychologique.
Sans rejeter l'importance des facteurs sociaux, il fit remarquer que cela n'expliquait pas pourquoi, parmi un nombre de sujetssoumis aux mêmes influences, certains avaient un comportement délinquant et d'autres pas.
En 1896, lors d'un congrès de criminologie resté célèbre, Ferri fit valoir que,dans tout acte de délinquance, intervient le déterminisme de l'homme et du milieu dans lequel il s'est développé.
Cette vision synthétique du phénomène a fait considérerFerri comme le véritable fondateur de la criminologie.
Et, comme d'autres, il a tiré comme conclusions de ses travaux que « les peines, loin d'être cette panacée commodequ'elles sont généralement aux yeux des criminalistes classiques, des législateurs et du public, n'ont qu'un pouvoir très limité pour combattre le délit ».
Ferri a donc exercéune grande influence sur l'évolution du droit pénal puisqu'il a eu l'idée des équivalents des peines ou substituts pénaux.
C'est à l'Italien Benigno di Tullio que l'on doit d'avoir souligné que le crime était essentiellement une manifestation d'inadaptation sociale.
Rejetant l'existence d'une héréditécriminelle spécifique, cette théorie reconnaît l'existence de tendances criminogènes chez certains individus alors susceptibles de se mettre en contravention avec la loi.
Maistoute la difficulté est de cerner cet état de prédisposition au crime qui, s'il était connu, permettrait de faire de la prévention la clef de voûte du système répressif.
Dans lesannées 1950, le criminologue belge De Greeff s'est penché sur les récidivistes et a pu retenir que leur psychisme était dominé par un « sentiment profond d'injusticesubie », générateur d'attitudes agressives vis-à-vis d'autrui.
Cet apport insiste sur toute l'histoire de l'individu qui, dès son plus jeune âge, a subi l'influence de facteurs trèsdivers qui ont préparé un comportement déviant, voire délinquant.
Aux États-Unis, la criminologie du début du XXe siècle s'est imprégnée de la théorie du comportement ou béhaviorisme, la conduite de l'homme étant expliquée comme le produit d'un assemblage de réflexes et d'habitudes.
Mais quels que soient l'intérêt ainsi que les limites de chaque théorie, il faut avoir à l'esprit qu'ils ont incontestablementpermis de mieux appréhender la criminalité.
De nos jours enfin, la conception positiviste de Lombroso et Ferri, qui visait à protéger la société plus qu'à se préoccuper du délinquant, a été progressivement remise encause.
Ainsi, dans un ouvrage qui devait faire école, La Défense sociale nouvelle (1954), un conseiller à la Cour de cassation, Marc Ancel, proposait-il de considérer le problème de la délinquance comme une question individuelle, qui ne peut être résolue qu'en fonction de la personnalité de chaque délinquant.
C'était faire de la personnalitécriminelle une question secondaire par rapport à celle qui concerne l'utilité et les limites de la peine.
4 APPLICATIONS ET LIMITES DE LA CRIMINOLOGIE
Les apports de la criminologie au droit pénal ont été considérables.
En tentant d'expliquer le comportement des délinquants, afin d'éclairer le législateur sur les mesures lesplus adéquates pour provoquer une diminution du phénomène, la criminologie a pu mettre l'accent sur le caractère dangereux de certaines attitudes sociales.
Cesdéveloppements ont poussé le législateur à les réprimer.
C'est aux travaux des criminologues que l'on doit par exemple une plus grande sévérité quant à la conduite en étatd'ivresse ou en matière de lutte contre le proxénétisme.
Toutes ces recherches se heurtent cependant au fait qu'elles ne peuvent appréhender la délinquance qu'à partir du moment où la loi applique à certains comportementsdélictueux une qualification juridique et une sanction.
L'évolution de la législation, comme celle de la gravité des peines en fonction des mutations de la société, influencentla criminologie.
La législation en matière de stupéfiants ne trouvait pas, il y a quelques années, la même place que celle qu'elle occupe aujourd'hui dans le nombre decondamnations prononcées.
En revanche, les émissions de chèques sans provision ont été dépénalisées depuis peu.
On peut donc dire que le délinquant, c'est la loi qui ledéfinit.
Même si la législation en vigueur ne lie pas le chercheur criminologue et que la criminologie ne se contente plus de faire des délinquants son champ d'étude exclusif,il demeure toutefois incontestable que la criminologie, après avoir fait naître des espoirs quant à la résorption du phénomène, est aujourd'hui une science parmi d'autres etpour le juge un éclairage d'une utilité somme toute relative.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit international).
- rébellion (cours de droit pénal).
- vol (cours de droit pénal).
- viol (cours de droit pénal).
- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit pénal).