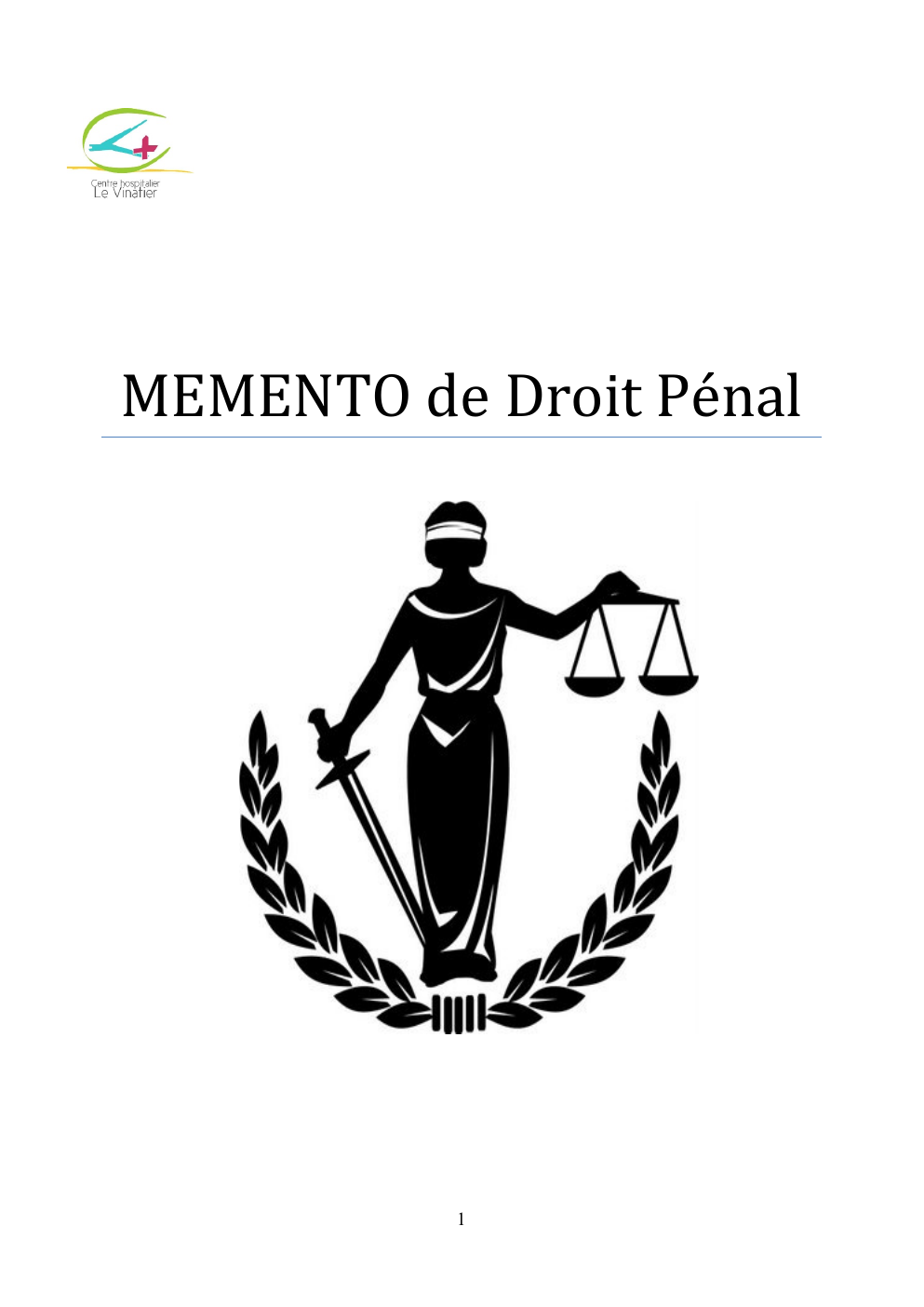Droit Pénal Cours
Publié le 15/07/2025
Extrait du document
«
MEMENTO de Droit Pénal
1
Table des matières
INTRODUCTION ......................................................................................................................
3
PARTIE 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire français ........................................................
4
1)
Les différents degrés de juridiction .............................................................................
4
2)
Les différentes juridictions de première instance ........................................................
5
PARTIE 2 : La distinction Droit civil / Droit pénal ...................................................................
6
1)
Le droit civil : arbitrer des litiges entre particuliers ....................................................
7
2)
Le droit pénal : punir les comportements nuisibles à la société ..................................
7
PARTIE 3 : Les infractions ........................................................................................................
9
PARTIE 4 : La procédure pénale avant jugement....................................................................
11
PARTIE 5 : Les peines .............................................................................................................
13
1)
Les peines principales ................................................................................................
13
2)
Les peines alternatives ...............................................................................................
14
3)
Les peines complémentaires ......................................................................................
14
PARTIE 6 : L’application des peines .......................................................................................
15
1)
Les autorisations de sortir ..........................................................................................
16
2)
Les réductions de peine : un régime unique ..............................................................
16
3)
Les libérations conditionnelles ..................................................................................
17
4)
La suspension et le fractionnement de la peine .........................................................
17
5)
Les aménagements des courtes peines .......................................................................
17
PARTIE 7 : Le soin des détenus ..............................................................................................
19
PARTIE 8 : Petit droit pénitentiaire .........................................................................................
21
1)
Les différents types d’établissements pénitentiaires .................................................
21
2)
Le parcours du détenu................................................................................................
22
PARTIE 9 : Grands principes de la justice pénale des mineurs ...............................................
23
GLOSSAIRE ............................................................................................................................
25
2
INTRODUCTION
Robinson Crusoë, seul sur son île déserte, ne vit pas en société, il n’a donc pas besoin de Loi.
La Loi devient une nécessité à partir du moment où l’on partage des espaces communs entre
personnes, où l’on vit en groupe.
Ces interactions entre personnes se doivent d’être régulées
afin que tous puissent vivre ensemble.
« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des
autres ».
Il existe différents types de Droits, chacun édicté par son propre Code, régissant différentes
formes de contentieux correspondant aux différentes interactions sociales.
On peut citer le Droit
Civil (cf.
Partie 2), le Droit du Travail, le Droit Commercial, le Droit de la chasse et de la
pêche…
Le Droit Pénal est une branche du Droit régissant les actes qui portent atteinte aux valeurs de
la société, définis par des Lois.
Il s’agit d’un droit répressif, édictant des peines privatives de
libertés (exemple : emprisonnement) ou non (exemple : bracelet électronique).
Les personnes condamnées à ce type de peines deviennent des personnes placées sous main de
justice.
On peut ainsi être placé sous main de justice sans nécessairement être en prison
(exemple : semi-liberté, sursis probatoire…).
Au 1er décembre 2021, cela concernait en France 84 022 personnes, dont 69 992 étaient
écrouées détenues1.
Les 14 7030 personnes restant étaient soit en placement extérieur, soit
placées sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (cf.
partie 6).
Ceci représente 0,1% de la population française, ce qui signifie qu’une personne sur 1000, en
France, est sous écrou2.
L’objet de ce mémento est de vous éclairer sur les parcours judiciaires que suivent les patients
pris en charge au sein du pôle SMD-PL.
1
Source : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mensuelle_mai_2015.pdf
2
Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5225246#tableau-figure1
3
PARTIE 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire français
1) Les différents degrés de juridiction
La cour de Cassation
1 seule située à Paris
Plus haute juridiction de
l'ordre judiciaire français
Les Cours d'appel
34 réparties sur le territoire français
Chacune est divisée en plusieurs chambres en
fonction de la nature de l'affaire qui lui est
présentée
(2ème degré de juridiction)
Les juridictions de 1ère instance
Tribunaux recevant les affaires pour la première fois, ils sont
specialisés suivant le type de contentieux (TC, TP, Cour d’assises)
Lorsqu’une affaire requiert un juge, elle est portée devant une juridiction de première
instance.
Il peut s’agir du Tribunal de Police, du Tribunal Correctionnel ou de la Cour d’Assises
pour les affaires pénales (selon le type d’infraction, cf.
partie 3).
Cette juridiction rend un
jugement.
Si une des parties concernées par l’affaire n’est pas satisfaite de ce jugement, elle peut
« interjeter appel », c’est-à-dire porter l’affaire devant la Cour d’Appel qui réexaminera les
faits et rendra un nouveau jugement (jugement sur le fond).
Ensuite, si une partie n’est toujours pas satisfaite, elle peut « se pourvoir en cassation », c’està-dire soumettre l’affaire à la plus haute juridiction française : la Cour de Cassation.
Cette
4
dernière ne réexamine pas les faits, elle se contente de vérifier que le droit a été correctement
appliqué par la Cour d’Appel ; on dit alors qu’elle juge en droit et non en faits.
2) Les différentes juridictions de première instance
Les juridictions civiles :
-
Les Tribunaux judiciaire (TJ) sont compétents pour les différends de nature civile.
Les juridictions pénales :
-
les Tribunaux de police (TP) jugent les infractions les moins graves que sont les
contraventions des 4 premières classes ;
-
les Tribunaux correctionnels (TC) jugent les contraventions de 5ème classe et les
délits ;
-
les Cours d’Assises jugent les crimes (composées de 3 juges professionnels et de 9 jurés
populaires) ;
-
les Cours criminelles départementales composées de 5 juges professionnels.
Elles
sont compétentes pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (instituées
à titre expérimentales, elles sont généralisées en janvier 2023).
Les instances d’application des peines (cf.
Partie 6) :
-
le Juge d’application des peines (JAP) décide de l’octroi d’aménagements de peine.
-
le Tribunal d’application des peines (TAP) décide de l’octroi des aménagements de
peine pour les peines d’emprisonnement de plus de 10 ans.
5
PARTIE 2 : La distinction Droit civil / Droit pénal
Droit civil
-
Droit pénal
Entre qui et qui?
Entre l’accusé et la société
représentée par le Ministère
public (ou «parquet »)
Entre des personnes
privées: d’un côté le
plaignant, de l’autre le
défenseur
Pour quoi ?
Sanctionner et prévenir la
violation des normes de
conduite sociale nommées
« infractions » (crimes,
délits, contravention)
Arbitrer un différend de
droit dans des domaines
variés (famille, contrats,
successions…)
Quels tribunaux ?
• Tribunal de police
• Tribunal de proximité
(contraventions)
• Tribunal judiciaire
• Tribunal correctionnel
• Juridictions spécialisés:
(délits)
Commerce, Conseil des
Prud-hommes…
• Cour d’assises, Cours
criminelles
départementales
Quelles sanctions ?
• Amende versée au Trésor
• Dommages-intérêts
public
• Prison: « emprisonnement
pour les délits,
« réclusion » pour les
crimes
versés à la partie adverse
• Exécution d’une
obligation
6
1) Le droit civil: arbitrer des litiges entre particuliers
Le droit civil s’occupe de régler les différends entre les particuliers.
Afin de mieux traiter
chaque affaire, il s’agit d’un droit très spécialisé et compartimenté : il regroupe le droit de la
famille (mariage, divorce…), le droit des contrats (vente, bail…), des successions …
L’idée, c’est que les relations entre les personnes créent des obligations réciproques,
conscientes ou non.
Par exemple, la vente d'une baguette de pain suppose que le client paie le
prix, et que le boulanger lui remette effectivement le produit.
Quand les différentes parties n’arrivent pas à s’entendre, ou que l’une d’elles s’estime lésée,
le juge civil peut intervenir pour arbitrer le conflit.
La personne qui a pris l’initiative de saisir le tribunal est appelée le « demandeur », celle qui
est attaquée le « défendeur » : toutes deux sont égales devant la justice.
Le juge arbitre le conflit au regard du droit, mais il ne prononce pas de peine (de punition).
La
personne en tort peut simplement être condamnée à réparer le dommage causé à
autrui (corporel, matériel ou moral), en versant des dommages-intérêts ou en exécutant une
obligation à laquelle il s’était engagé (comme effectuer une livraison ou rembourser une dette).
2) Le droit pénal : punir les comportements nuisibles à la société
Le droit pénal a, quant à lui, pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des
personnes et des biens.
L’idée, c’est que pour fonctionner, une société doit s’assurer du respect
de certaines règles et valeurs.
Le droit pénal est un droit répressif, qui vient punir les actions répréhensibles, appelées en
langage juridique « infractions ».
Il existe trois catégories d’infractions, selon leur degré de
gravité (cf.partie 3).
Le procès met face à face l'accusé et la société (représentée par le Ministère public ou
« parquet »), non la victime.
Dans une affaire pénale, la victime peut toutefois intervenir pour mettre en mouvement l’action
publique contre le présumé coupable, au cas où le Ministère public ne l’aurait pas fait lui-même.
7
Le juge est chargé de vérifier que la personne a effectivement commis les faits qui lui sont
reprochés, puis le cas échéant de fixer une peine en fonction des circonstances de l’infraction
et de la personnalité de l’accusé.
Pour certaines affaires, des poursuites peuvent être menées à la fois au civil et au pénal.
Par exemple, la victime d’un vol avec violences peut se constituer partie civile : cela lui permet
de faire partie du procès pénal (d’être informée et auditionnée, d’obtenir la condamnation de
son agresseur) et d’intenter une action au civil pour obtenir des dommages-intérêts (pour le bien
volé, les blessures…).3
Le procès pénal suit ce cheminement :
Enquête de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit international).
- rébellion (cours de droit pénal).
- vol (cours de droit pénal).
- viol (cours de droit pénal).
- Tribunal pénal international [TPI] (cours de droit pénal).