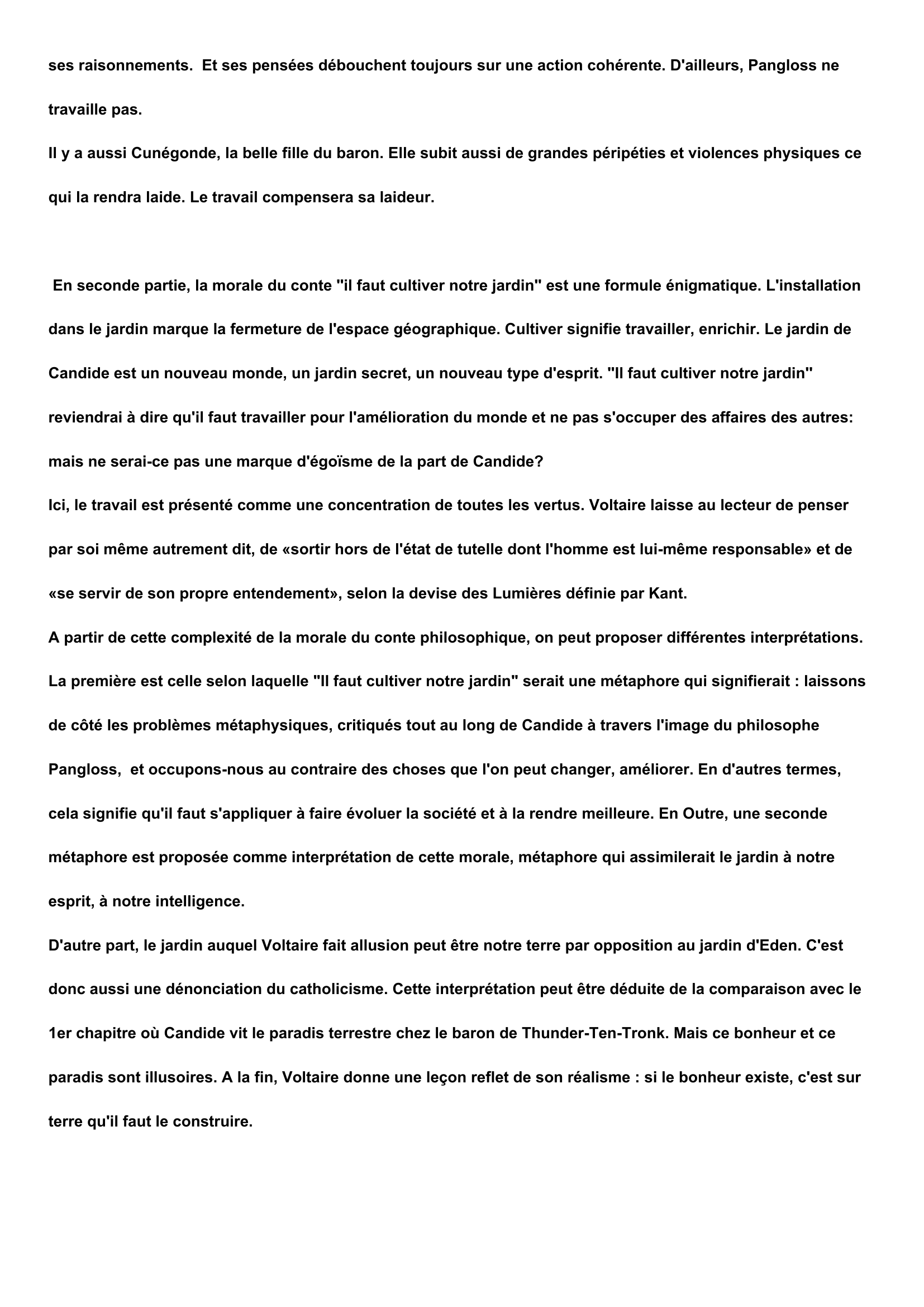Candide ou l'optimisme, Conclusion
Publié le 19/05/2013

Extrait du document
«
ses raisonnements.
Et ses pensées débouchent toujours sur une action cohérente.
D'ailleurs, Pangloss ne
travaille pas.
Il y a aussi Cunégonde, la belle fille du baron.
Elle subit aussi de grandes péripéties et violences physiques ce
qui la rendra laide.
Le travail compensera sa laideur.
En seconde partie, la morale du conte ''il faut cultiver notre jardin'' est une formule énigmatique.
L'installation
dans le jardin marque la fermeture de l'espace géographique.
Cultiver signifie travailler, enrichir.
Le jardin de
Candide est un nouveau monde, un jardin secret, un nouveau type d'esprit.
''Il faut cultiver notre jardin''
reviendrai à dire qu'il faut travailler pour l'amélioration du monde et ne pas s'occuper des affaires des autres:
mais ne serai-ce pas une marque d'égoïsme de la part de Candide?
Ici, le travail est présenté comme une concentration de toutes les vertus.
Voltaire laisse au lecteur de penser
par soi même autrement dit, de «sortir hors de l'état de tutelle dont l'homme est lui-même responsable» et de
«se servir de son propre entendement», selon la devise des Lumières définie par Kant.
A partir de cette complexité de la morale du conte philosophique, on peut proposer différentes interprétations.
La première est celle selon laquelle "Il faut cultiver notre jardin" serait une métaphore qui signifierait : laissons
de côté les problèmes métaphysiques, critiqués tout au long de Candide à travers l'image du philosophe
Pangloss, et occupons-nous au contraire des choses que l'on peut changer, améliorer.
En d'autres termes,
cela signifie qu'il faut s'appliquer à faire évoluer la société et à la rendre meilleure.
En Outre, une seconde
métaphore est proposée comme interprétation de cette morale, métaphore qui assimilerait le jardin à notre
esprit, à notre intelligence.
D'autre part, le jardin auquel Voltaire fait allusion peut être notre terre par opposition au jardin d'Eden.
C'est
donc aussi une dénonciation du catholicisme.
Cette interprétation peut être déduite de la comparaison avec le
1er chapitre où Candide vit le paradis terrestre chez le baron de Thunder-Ten-Tronk.
Mais ce bonheur et ce
paradis sont illusoires.
A la fin, Voltaire donne une leçon reflet de son réalisme : si le bonheur existe, c'est sur
terre qu'il faut le construire.
.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CANDIDE, ou l’Optimisme, Voltaire (François Marie Arouet, dit), (résumé)
- candide ou l'optimisme
- Candide ou l'Optimisme (résumé)
- CANDIDE OU L’OPTIMISME Voltaire. Conte - résumé de l'oeuvre
- CANDIDE ou l'Optimisme (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)