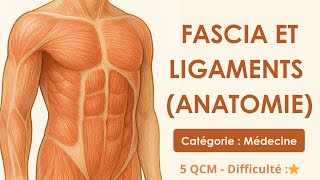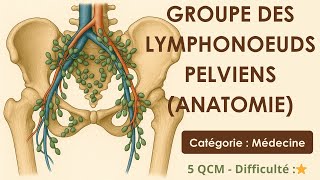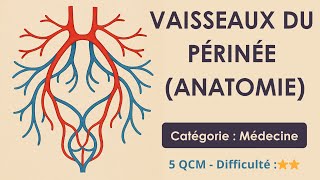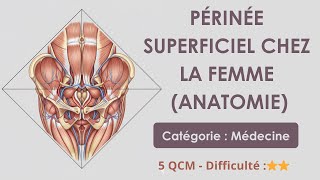le théâtre instruit et plait
Publié le 12/01/2011

Extrait du document
Pour argumenter, de nombreux auteurs ont eut recours à la fiction. C’est notamment le cas de Jean de La Fontaine qui l’énonça explicitement pour la première fois dans son œuvre Le Lion et le Chasseur en affirmant qu’une morale nue apporte de l’ennui et le compte fait passer l’éducation avec celui-ci. Ainsi, il introduit le livre I des Fables en s’adressant à Monsieur le Dauphin en ces termes : « Je ne doute point, Monseigneur, que vous ne regardiez favorablement des inventions si utiles et tout ensembles si agréables. » On retrouve ici le principe fondamental du Classicisme : plaire tout en instruisant. Le plaisir est-il compatible avec l’enseignement et est-ce que l’emploi d’une forme divertissante ne porterait-elle pas préjudice à la visée didactique ? Ainsi, si divertir et instruire sont une combinaison fort prisée, cette dimension peut constituer un obstacle à la réception de l’œuvre. Instruire consiste à faire acquérir des connaissances, amener quelqu'un à se modifier en lui faisant trouver des raisons de le faire et plaire désigne le fait de ressentir une attirance, un intérêt. En ce sens la, les auteurs utilise une dimension divertissante pour capter l’attention du lecteur. Pour montrer le monde tel qu’il est, il convient de persuader le lecteur en l’amusant et en l’intéressant à une histoire riche en rebondissements plutôt qu’en lui tenant des discours sérieux. Ainsi tout d’abord, l’apologue (fable visant à illustrer un enseignement) peut sembler être un moyen efficace pour défendre ses idées. En effet, il présente un atout de taille : il plaît. Le lecteur peut être séduit par le récit présenté et sera donc plus réceptif au message que l’on cherche à lui transmettre. Afin de plaire et d’enseigner, voire de convaincre ou de persuader, La Fontaine utilise le genre de la fable car elle appartient au genre de l’apologie capable de plaire et d’instruire. La fiction rend l’histoire plus divertissante et lui assure un aspect ludique : le rôle actif demandé au lecteur est source de plaisir, de deviner, d’interpréter, d’imaginer,… Par ailleurs, une des fonctions du conte est de nous dépaysé grâce à un différent cadre spatio-temporel rendant le récit attrayant. Ainsi, Voltaire fait varier son cadre spatio-temporel dans Candide et au fil de sa lecture le lecteur a l’impression de voyager. En effet, Candide peint des cadres idylliques et exotiques qui font rêver. Cependant la complexité des moyens mis en œuvre peut être un frein. La recherche de l’instruction peut néanmoins être délaissée pour la recherche du plaisir : on s’axe que sur la recherche du plaisir pour trouver des phrases, répliques, situations qui plaisent que sur le message que l’on veut faire passer. De plus, l’implicite n’est pas assez objectif : les destinataires peuvent interpréter le message reçu de différentes manières dés qu’il est raconté autours d’une histoire. L’attention du destinataire peut être retenue sur un détail raconté bien plus « intéressant » que le reste de l’enseignement qu’il marquera. Par ailleurs, nous avons évoqué comme un avantage le plaisir de deviner : l'apologue exige une certaine culture commune, une certaine complicité entre l'auteur et le lecteur. Mais cette culture commune n'existe pas nécessairement. Par exemple, on peut parfaitement lire "La ferme des animaux" de George Orwell, sans comprendre qu'il y a là une réflexion sur le destin de l'idée communiste dans la première moitié du XXème siècle, à partir de l'expérience de la révolution russe. Le plaisir est donc compatible avec l’enseignement, cette particularité explique sans doute la permanence du genre et son renouvellement. Mais il faut en reconnaître les limites, les dangers, et savoir en tenir compte, en tant qu’auteur autant qu’en tant que lecteur.
Liens utiles
- Le Théâtre Classique et la règle de trois unités.
- Critique d'Artemisia Gentileschi Théâtre
- Dm de spé théâtre: Tartuffe de Molière
- Le théâtre n'est-il l'art que de la parole?
- ► À quelles conditions un récit devient-il un moment de théâtre ?