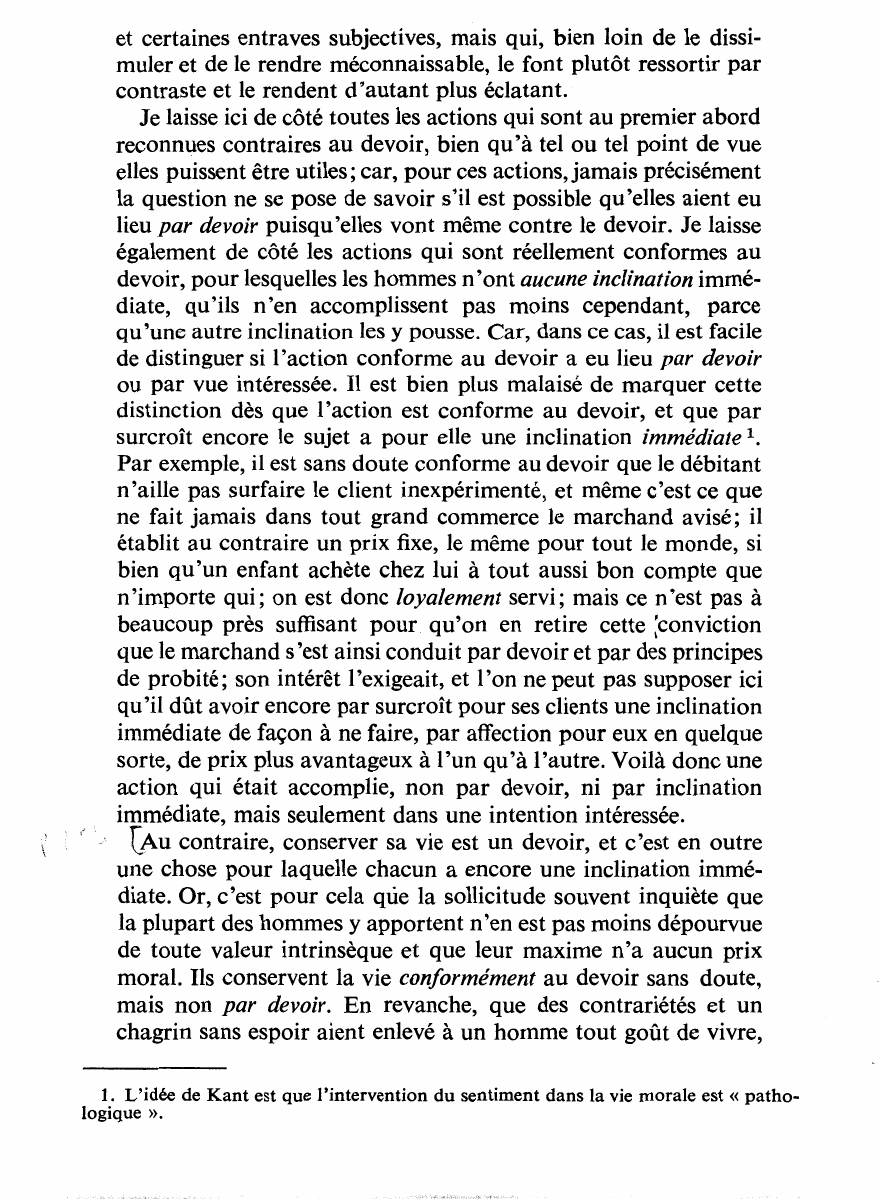pourrait être accompli par elle uniquement en faveur de quelque inclination et même, si l'on veut, de la somme de toutes les inclinations.
Publié le 22/10/2012

Extrait du document
«
La loi morale
et certaines entraves subjectives, mais qui, bien loin de le dissi muler et de le rendre méconnaissable, le font plutôt ressortir par contraste et le rendent d'autant plus éclatant.
Je laisse ici de côté toutes les actions qui sont au premier abord
reconnues contraires au devoir, bien
qu'à tel ou tel point de vue
elles puissent être utiles; car, pour ces actions, jamais précisément
la question ne se pose de savoir s'il est possible qu'elles aient eu
lieu par devoir puisqu'elles vont même contre le devoir.
Je laisse
également de côté les actions qui sont réellement conformes au
devoir, pour lesquelles les hommes
n'ont aucune inclination immé diate, qu'ils n'en accomplissent pas moins cependant, parce
qu'une autre inclination les y pousse.
Car, dans ce cas, il est facile
de distinguer si l'action conforme au devoir a eu lieu par devoir ou par vue intéressée.
Il est bien plus malaisé de marquer cette
distinction dès que 1 'action est conforme au devoir, et que par surcroît encore le sujet a pour elle une inclination immédiate 1
.
Par exemple, il est sans doute conforme au devoir que le débitant
n'aille pas surfaire le client inexpérimenté, et même c'est ce que
ne fait jamais dans tout grand commerce le marchand avisé;
il établit au contraire un prix fixe, le même pour tout le monde, si
bien qu'un enfant achète chez lui à tout aussi bon compte que
n'importe qui; on est donc loyalement servi; mais ce n'est pas à
beaucoup près suffisant pour qu'on en retire cette :conviction
que le marchand s'est ainsi conduit par devoir et par des principes
de probité; son intérêt l'exigeait, et l'on ne peut pas supposer ici
qu'il dût avoir encore par surcroît pour ses clients une inclination
immédiate de façon à ne faire, par affection pour eux en quelque
sorte, de prix plus avantageux à l'un qu'à l'autre.
Voilà donc une
action qui était accomplie, non par devoir, ni par inclination
immédiate, mais seulement dans une intention intéressée.
(Au contraire, conserver sa vie est un devoir, et c'est en outre
une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immé diate.
Or, c'est pour cela qûe la sollicitude souvent inquiète que
la plupart des hommes y apportent n'en est pas moins dépourvue
de toute valeur intrinsèque et que leur maxime n'a aucun prix
moral.
Ils conservent la vie conformément au devoir sans doute,
mais non par devoir.
En revanche, que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un homme tout goût de vivre,
72
1.
L'idée de Kant est que l'intervention du sentiment dans la vie morale est>..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Titre» le Juge, Je viens de prendre acte de votre jugement rendu le 16/07/97 en faveur de Monsieur Pierre Saulat, 6, rue de Munich, Roubaix, et me condamnant à lui verser la somme de 6 600 FF.
- En Afrique, on pleure la mort d'un vieillard plus que la mort d'un nouveau-né. Le vieillard constituait une somme d'expériences qui pouvait profiter au reste de la tribu, tandis que le nouveau-né, n'ayant pas vécu, n'a même pas conscience de sa mort. En Europe, on pleure le nouveau-né, car on se dit qu'il aurait sûrement accompli des choses fabuleuses, s'il avait vécu. On porte par contre peu d'attention à la mort du vieillard. De toute façon, il avait déjà profité de la vie. Bernard W
- Le potier en veut au potier, le charpentier au charpentier, le pauvre au pauvre, et le chanteur au chanteur
- On loue plus que de raison la marchandise dont on veut se défaire
- Gare à la fourmi qui veut voler trop haut !