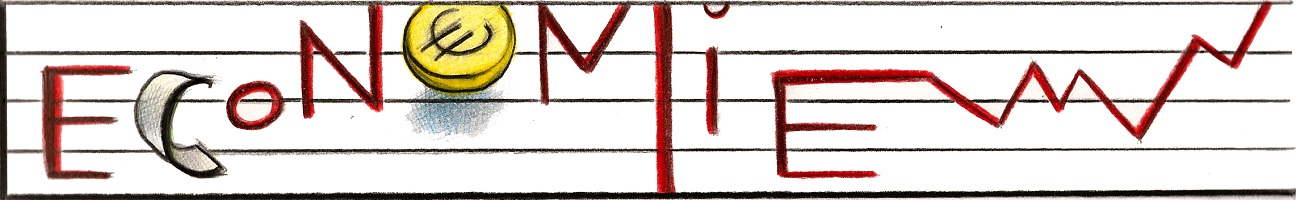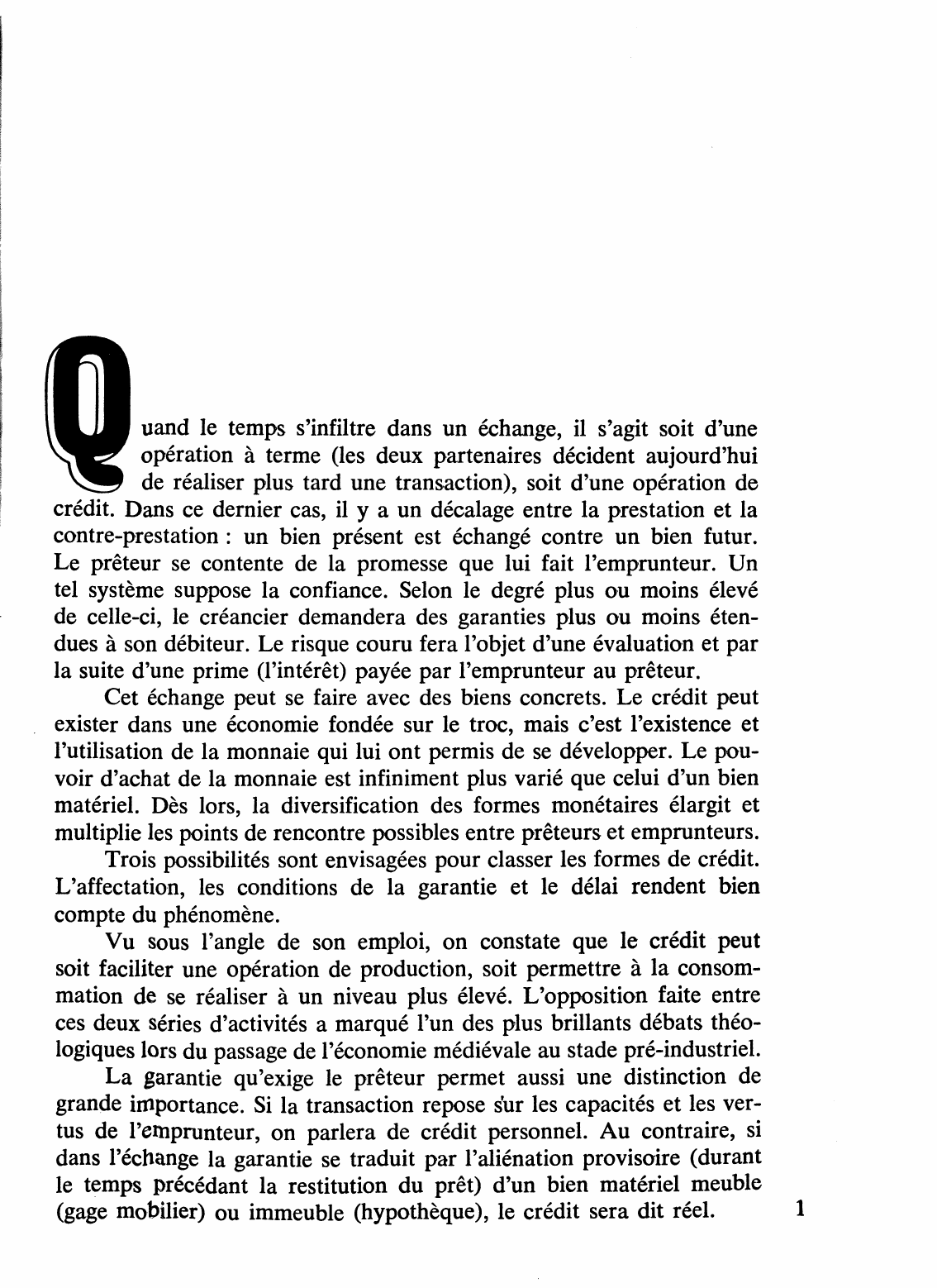L'histoire du crédit
Publié le 23/12/2011

Extrait du document

Les actions et les obligations sont des titres de crédit à long terme ; l'émission des secondes pouvant être soit publique, soit privée. Si l'on considère qu'un titre de crédit est une reconnaissance de dette vis-à-vis d'un prêteur, d'un épargnant, l'action ne devrait pas être considérée comme telle. Une action représente en principe un droit, un titre d'associé, et son produit est imprévisible, puisqu'il est lié aux résultats de l'entreprise qui a diffusé la propriété de son capital. En réalité, la grande majorité des actionnaires ne ressent pas cette qualité d'associé. La démarche de ces épargnants est beaucoup plus simple, ils entendent avant tout faire un placement pour promouvoir leurs revenus non consommés. On peut, de ce fait, assimiler l'action à un titre de crédit privé à long terme. Les comptables nationaux adoptent cette classification. Les obligations, remboursables à une date déterminée, produisent un intérêt fixe ; le souscripteur d'obligations renonce à l'incertitude dans la mesure où il sait à l'avance ce que lui rapportera son titre. Si par hasard la société émettrice est mise en faillite, le titulaire d'obligations sera considéré comme un créancier, à l'inverse de l'actionnaire qui, en tant qu'associé, aura beaucoup de difficultés pour se désolidariser de l'effondrement.

«
uand le temps s'infiltre dans un échange, il s'agit soit d'une
opération
à terme (les deux partenaires décident aujourd'hui
de réaliser plus tard une transaction), soit d'une opération de
crédit.
Dans ce dernier cas,
il y a un décalage entre la prestation et la
contre-prestation : un bien présent est échangé contre un bien futur.
Le prêteur
se contente de la promesse que lui fait l'emprunteur.
Un
tel système suppose la confiance.
Selon le degré plus ou moins élevé
de celle-ci, le créancier demandera des garanties plus ou moins éten
dues
à son débiteur.
Le risque couru fera l'objet d'une évaluation et par
la suite d'une prime (l'intérêt) payée par l'emprunteur au prêteur.
Cet échange peut
se faire avec des biens concrets.
Le crédit peut
exister dans une économie fondée sur le troc, mais c'est l'existence et
l'utilisation de la monnaie qui lui ont permis de
se développer.
Le pou
voir d'achat de la monnaie est infiniment plus varié que celui d'un bien
matériel.
Dès lors, la diversification des formes monétaires élargit et
multiplie les points de rencontre possibles entre prêteurs et emprunteurs.
Trois possibilités sont envisagées pour classer les formes de crédit.
L'affectation, les conditions de la garantie et le délai rendent bien
compte du phénomène.
Vu sous l'angle de son emploi, on constate que le crédit peut
soit faciliter une opération de production, soit permettre
à la consom
mation de
se réaliser à un niveau plus élevé.
L'opposition faite entre
ces deux séries d'activités a marqué l'un des plus brillants débats théo
logiques lors du passage de l'économie médiévale au stade pré-industriel.
La garantie qu'exige le prêteur permet aussi une distinction de
grande importance.
Si la transaction repose s'ur les capacités et les ver
tus de l'emprunteur, on parlera de crédit personnel.
Au contraire,
si
dans l'échange la garantie se traduit par l'aliénation provisoire (durant
le temps précédant la restitution du prêt) d'un bien matériel meuble
(gage mobilier) ou immeuble (hypothèque), le crédit sera dit réel.
1.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES BANQUES ET LE CRÉDIT (HISTOIRE).
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- Histoire de l'esclavage
- Amy Dahan-Dalmedico et Jeanne Peiffer: Une histoire des mathématiques (résumé)
- Bill Bryson: Histoire de tout, ou presque ...