KLEINIEN (psychanalyse)
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
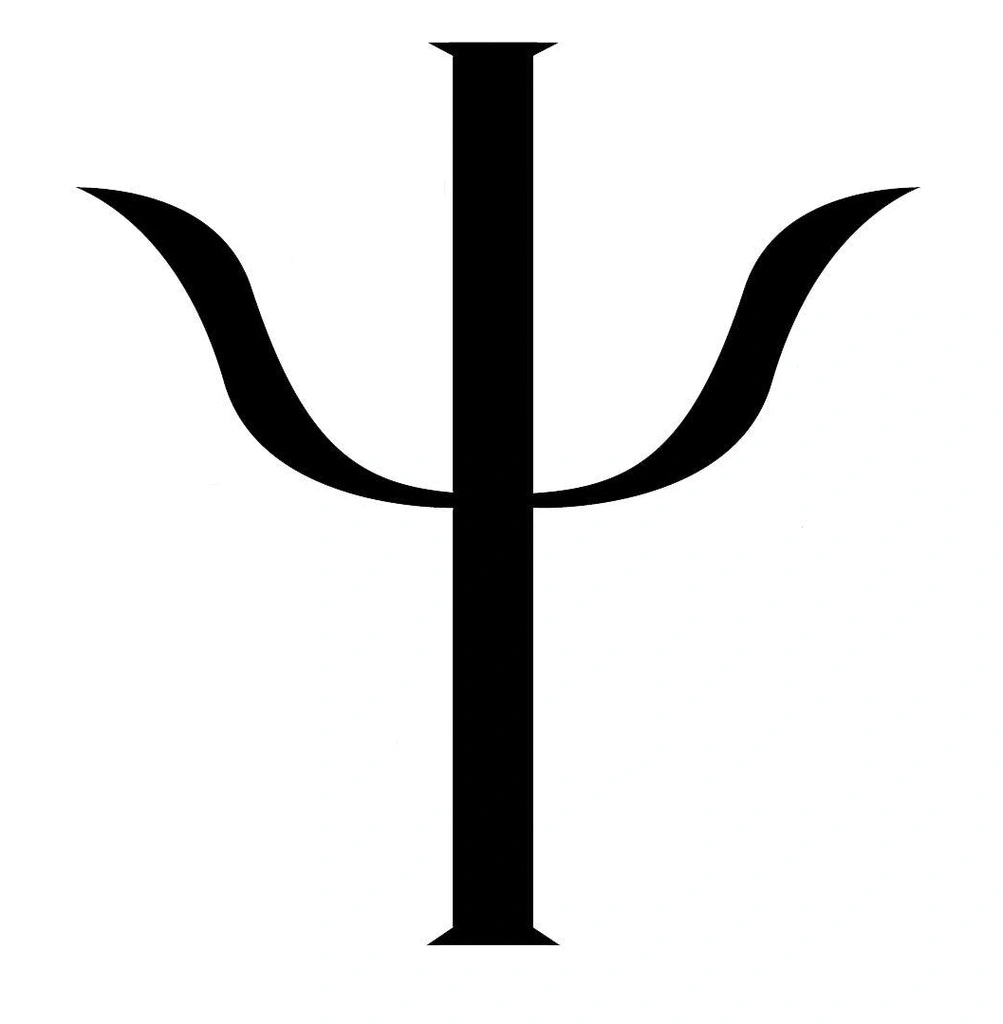
1. Nom donné aux disciples de Mélanie Klein (1882-1960), promotrice de l'ANALYSE DES ENFANTS et de la recherche centrée sur les états DÉPRESSIFS et SCHIZOIDES.
2. Adjectif qui se rapporte aux idées et aux théories formulées par Mélanie Klein. Quoique l'école kleinienne de psychanalyse demeure au sein de la ligne freudienne, ses théories s'écartent de la THÉORIE CLASSIQUE à propos de plusieurs aspects fondamentaux. Les principales différences sont les suivantes : (a) L'INSTINCT DE MORT est pris sérieusement comme concept clinique; l'AMBIVALENCE innée est admise en postulat, la composante destructive de l'ambivalence étant interprétée comme une PROJECTION défensive vers l'extérieur de l'instinct autodestructeur inné. (b) Le DÉVELOPPEMENT DU MOI est considéré comme un processus d'Introjection et de PROJECTION continuelles des objets et non comme la progression de la personnalité qui franchit plusieurs étapes où des défenses variées sont utilisées. (c) Les origines de la NÉVROSE se trouvent, selon Ces théories, au cours de la première année et non des premières années de la vie; elles proviendraient de ce que les tentatives faites pour passer la position dépressive ont échoué; elles ne se situeraient donc pas dans la FIXATION à des stades divers (points DE FIXATION) tout au long de l'enfance. En conséquence, la position dépressive joue le même rôle dans la théorie kleinienne que le COMPLEXE D'OEDIPE dans la théorie classique. (d) La théorie kleinienne est une THÉORIE OBJECTALE et non une THÉORIE DES INSTINCTS dans la mesure où elle attache une importance primordiale à la résolution de l'ambivalence envers la MÈRE, le SEIN et considère le développement du moi comme essentiellement fondé sur l'introjection de la mère et (ou) du sein. Elle se distingue cependant des théories objectales de Fairbairn FAIRBAIRN ET sa NOUVELLE CONCEPTION DE LA PSYCHOPATHOLOGIE) et de Winnicott car elle attache peu d'importance aux soins maternels effectivement vécus par le nourrisson; selon la vue kleinienne, cet aspect est éclipsé par les difficultés qu'éprouve le nourrisson à surmonter son ambivalence innée envers le sein. Le petit enfant, qui ressent à la fois l'ENVIE innée à l'égard du sein et la nécessité de l'utiliser pour recevoir la projection de son propre instinct de mort, doit d'abord surmonter la crainte et la défiance qu'il éprouve à l'égard du sein (POSITION PARANOIDE-SCHIZOIDE) pour en venir ensuite à la perlaboration de la découverte que le sein qu'il hait et le sein qu'il aime sont le même sein (POSITION DÉPRESSIVE). (e) Ces théories présument que le jeune enfant a une vie FANTASMATIQUE beaucoup plus vive et violente que ne le conçoit la théorie classique; la tâche principale de l'analyse serait d'interpréter des fantasmes inconscients plutôt que d'interpréter des DÉFENSES contre les impulsions inconscientes. Toutefois, les fantasmes sont considérés comme les représentants psychiques des instincts libidinaux et destructeurs et comme les processus contre lesquels les défenses se dressent. En résumé, l'analyse kleinienne ressemble à l'analyse classique en adhérant à la théorie des deux INSTINCTS et en étant en fait plus freudienne que les freudiens dans son usage de l'instinct de mort; mais elle en diffère en rejetant les concepts des stades du développement et les points de fixation et en attribuant une plus grande importance à la première année de la vie qu'à l'enfance tout entière. Voir Segal (1964) pour un exposé de la théorie kleinienne et Glover (1945) pour une critique acérée de cette théorie d'après un point de vue classique.
Liens utiles
- Résumé texte psychanalyse des ado
- Freud : Introduction à la Psychanalyse, explication de texte
- Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées (extrait) Dans Psychanalyse des contes de fées, publié en 1976, Bruno Bettelheim applique aux contes destinés aux enfants le filtre de l'analyse psychanalytique.
- Thorndike, Edward Lee - psychologie & psychanalyse.
- Rogers, Carl - psychologie & psychanalyse.
