La répétition en psychanalyse
Publié le 07/04/2015

Extrait du document
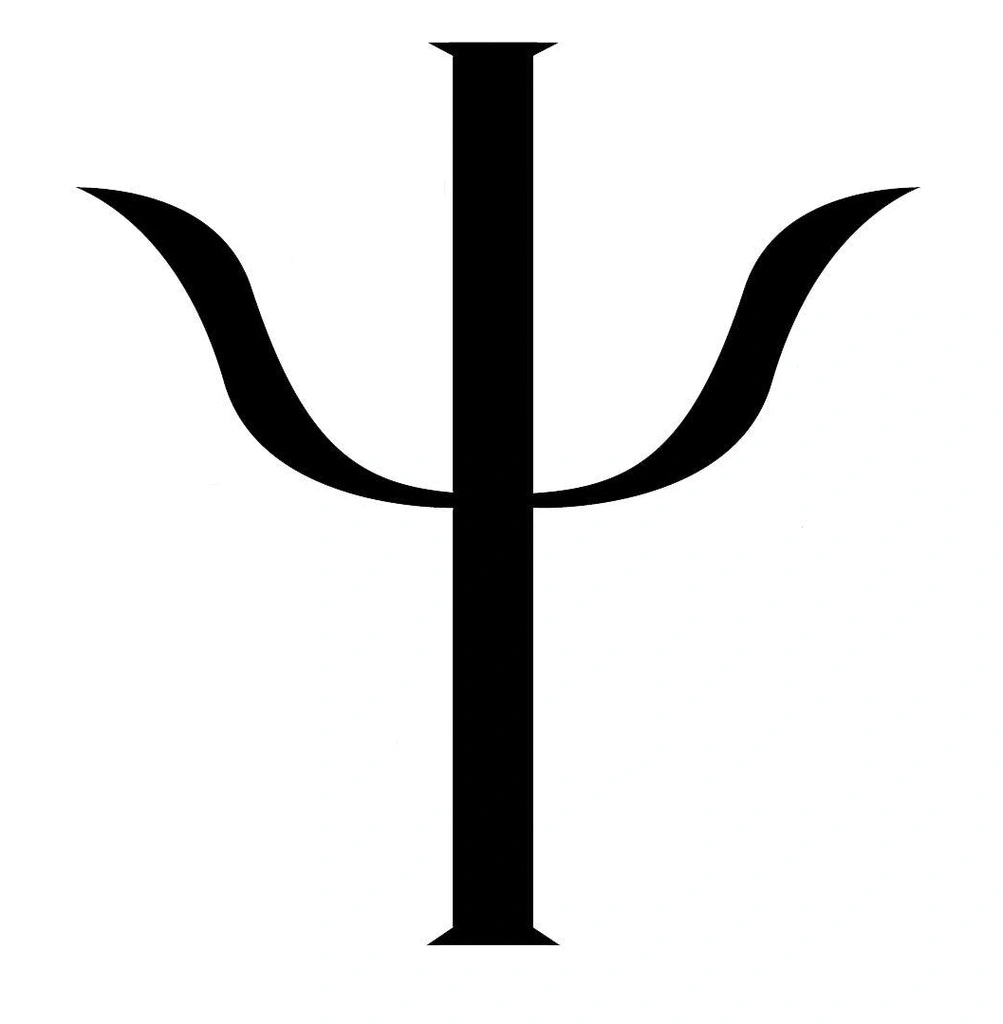
répétition n.f. (angl. Repetition; allem. Wiederholung). Dans les représentations du sujet, dans son discours, dans ses conduites, dans ses actes ou dans les situations qu'il vit, fait que quelque chose revienne sans cesse, le plus souvent à son insu et, en tout cas, sans projet délibéré de sa part.
Ce retour du même et cette insistance prennent volontiers valeur com‑
pulsive et apparaissent généralement sous la forme d'un automatisme; c'est d'ailleurs par les termes de compulsion de répétition ou d'automatisme de répétition que l'on traduit habituellement la formulation freudienne originale de Wiederholungszwang, contrainte de répétition.
D'un point de vue clinique, il est important de distinguer la répétition de la reproduction, puisque cette dernière est agie, mise en oeuvre volontairement par le sujet.
La compréhension du phénomène de répétition renvoie directement à celui du traumatisme; sa théorisation met en jeu des notions très diverses, entre autres celles d'échec (névrose d'échec, névrose de destinée) et de culpabilité, et dévoile un principe de fonctionnement psychique radicalement différent de celui, classiquement décrit, dominé par le principe de plaisir: aussi S. Freud l'appréhenda-t-il d'ailleurs comme au-delà du principe de plaisir.
D'un point de vue épistémologique, la répétition est l'un des concepts majeurs de la dernière partie de l'ceu-vre de Freud. Elle introduit la pulsion de mort, ouvre la voie de la deuxième topique et, accessoirement, signe un réajustement considérable de la clinique et de la technique analytiques.
Chez J. Lacan, la répétition constitue, avec l'inconscient, le transfert et la pulsion, l'un des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, notamment justement parce qu'elle est devenue une référence omniprésente de la clinique et qu'elle fait noeud des trois autres concepts : n'est-elle pas le point d'achoppement de l'inconscient, le pivot du transfert et le principe même de la pulsion?
C'est en 1914, dans l'article «Remémoration, répétition, perlaboration«, que
Freud commença à conceptualiser la notion de répétition. Le point de départ est d'ordre technique: l'efficacité des cures s'est émoussée. C'est que le discours analytique vieillit déjà, acquiert un début de légitimité sociale et perd par là même une partie de son tranchant. C'est aussi que les indications de l'analyse se sont étendues: les hystériques ne sont plus seuls à y venir et les « nouveaux « patients échappent pour une part plus grande au travail de la cure, centré sur la reconquête des notions refoulées, sur la prise en compte de l'inconscient. En un mot, Freud découvre qu'il y a une limite à la remémorisation. D'où un obstacle : comment avoir accès à ce qu'il y a au-delà? Autre difficulté, presque parallèle: il s'avère de plus en plus que les patients mettent en scène et mettent en acte, en dehors du cadre de la cure, dans leur vie, toutes sortes de choses qui pourtant s'y rapportent. Ce sera en fait la solution: ce qui ne peut se remémorer, découvre Freud, fait retour autrement: par la répétition, par ce qui se répète dans la vie du sujet et à son propre insu.
La nouvelle technique analytique va donc consister non seulement à explorer les formations de l'inconscient, mais aussi à prendre en compte la répétition et à exploiter le matériel qu'elle révèle. Et sa nouvelle efficacité va dépendre de sa capacité non seulement à faire disparaître tel ou tel symptôme, mais aussi à enrayer telle ou telle compulsion répétitive à laquelle le patient est assujetti.
À partir delà, la répétition va éclairer d'un jour nouveau le transfert: celui-ci n'apparaît désormais plus uniquement comme un phénomène passionnel, une énamoration, en grande partie induite par la position (de supposé savoir) occupée par l'analyste, mais davantage encore comme un phénomène répétitif — la reviviscence d'anciennes émotions. En tant que
répétition, le transfert constitue donc une résistance, la plus importante de toutes, susceptible de paralyser complètement les progrès de la cure. Mais il fournit aussi précisément la possibilité d'appréhender in situ le fonctionnement de la répétition et, grâce à son interprétation, peut amener au seul dénouement possible de la névrose et de la cure elle-même.
La répétition donne également accès à la compréhension des conduites d'échec, de ces scénarios répétitifs où les sujets se voient parfois pris et qui leur donnent le sentiment d'être les jouets d'une destinée perverse. Freud étudia le processus surtout dans le cadre des névroses obsessionnelles et dans le deuxième chapitre d'un petit article: «Ceux qui échouent devant le succès« in
C'était là dévoiler une fonction particulière de la répétition: payer pour une culpabilité subjective et en diminuer par là même la charge, mais sans pour autant la régler. Après la Première Guerre mondiale, Freud put mettre en lumière la fonction générale de la répétition, ce qui l'amena du même coup à discerner un autre mode de fonctionnement psychique, à supposer l'existence d'une pulsion de mort et à réorganiser finalement de fond en comble la théorie analytique. L'article princeps est: «Au-delà du principe de plaisir «, paru en 1920. Freud commence par y décrire certains exemples de
répétition — dans la littérature, dans les actes des sujets, dans les rêves, dans le cadre des névroses de guerre ou des névroses traumatiques; puis il s'attarde sur un exemple, celui de son petit-fils, alors âgé de dix-huit mois, s'amusant à lancer sous un meuble, c'est-à-dire hors de sa vue, une bobine attachée à un fil puis à la ramener à lui en accompagnant ces gestes d'un « 000h « pour la disparition de la bobine, d'un « haaa « pour son retour. Avec l'aide de la mère de l'enfant, il put établir que ces phénomènes — 000h pour
La question était d'autant plus délicate que ces manifestations avaient ceci de particulier de contredire radicalement le principe essentiel de la vie psychique que Freud avait établi depuis longtemps : que le fonctionnement du sujet, même si c'était souvent de manière apparemment paradoxale, ou de façon inconsciente, visait toujours à l'obtention de la satisfaction —obéissait toujours au principe de plaisir. Or, là, ce n'était plus le cas.
Aussi Freud fit-il l'hypothèse suivante. Lorsque chez un sujet un événement survient auquel il ne peut faire face — c'est-à-dire qu'il ne peut ni l'intégrer dans le cours de ses représentations ni l'abstraire du champ de sa conscience en le refoulant —, alors cet
événement a proprement valeur de traumatisme. Et ce trauma, bien sûr, pour laisser en paix le sujet, exige d'être réduit — d'être symbolisé. Son retour incessant — sous forme d'images, de rêves, de mises en acte — a précisément cette fonction: tenter de la maîtriser en l'intégrant à l'organisation symbolique du sujet. La fonction de la répétition est donc de réduire le trauma (comme on dit «réduire une fracture «). Mais il s'avère d'autre part que souvent cette fonction est inopérante. En fait, généralement, la répétition est vaine : elle n'arrive pas à remplir sa mission, sa tâche est sans cesse reconduite, sans cesse à refaire. Aussi a-t-elle ce caractère d'automatisme, ainsi finit-elle par se perpétuer à l'infini.
Pour Freud, la répétition est donc la conséquence du trauma, une vaine tentative pour l'annuler, une façon aussi de faire avec, qui amène le sujet dans un autre registre que celui du plaisir puisque ce qu'il répète ne répond en rien à un quelconque désir. Il restait à caractériser cet «autre registre«. Freud le fit en radicalisant la notion de trauma. Finalement, dit-il, le premier des traumas, c'est celui de la naissance, c'est celui qui est inhérent au fait même de vivre. Et vivre, c'est emprunter toutes sortes de détours pour revenir au point d'origine, à l'état inanimé — à la mort. Dans cette perspective, la répétition est bien la marque du trauma originel et structural et de l'impuissance du sujet à l'effacer. Aussi bien dire qu'elle constitue la signature de la pulsion de mort, qui se dévoile comme retour à l'origine, et qu'elle en est aussi l'annonce: le retour du même, c'est le contraire d'une avancée, le contraire d'une démarche vitale, c'est le retour à la mort.
Cette idée de l'au-delà du principe de plaisir, de la répétition comme sceau de la pulsion de mort, n'était au début pour Freud qu'une hypothèse méta-psychologique. Très vite, il reconnut
qu'elle prenait valeur de repère central de la théorie analytique; elle en devint finalement le corps.
LES THÈSES LACANIENNES
Lacan a le même point de vue. Une bonne partie du retour à Freud, qu'il a suscité, cherche d'ailleurs à rétablir cette perspective qu'une seule génération d'analystes avait réussi à estomper. Mais il n'en reste pas là et développe le concept de répétition selon deux axes différents.
Le premier est celui du symbolique. La répétition, expose-t-il, est en somme au principe de l'ordre symbolique en général et de la chaîne signifiante en particulier. Le Séminaire sur "la Lettre volée", prononcé en 1954-55
Le second axe est celui du réel. (—t imaginaire, réel, symbolique.) Dès 1964, dans
en compte sous les auspices de la pulsion de mort, Lacan va alors le conceptualiser sous le terme de réel —l'impossible, l'impossible à symboliser, l'impossible à affronter pour un sujet.
Aussi la répétition, pour lui, est-elle au noeud de la structure : indice et index du réel, elle produit et promeut l'organisation symbolique, et reste a l'arrière-plan de toutes les échappatoires imaginaires.
Liens utiles
- répétition - psychologie & psychanalyse.
- COMPULSION DE RÉPÉTITION (Psychanalyse)
- Résumé texte psychanalyse des ado
- Freud : Introduction à la Psychanalyse, explication de texte
- Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées (extrait) Dans Psychanalyse des contes de fées, publié en 1976, Bruno Bettelheim applique aux contes destinés aux enfants le filtre de l'analyse psychanalytique.
