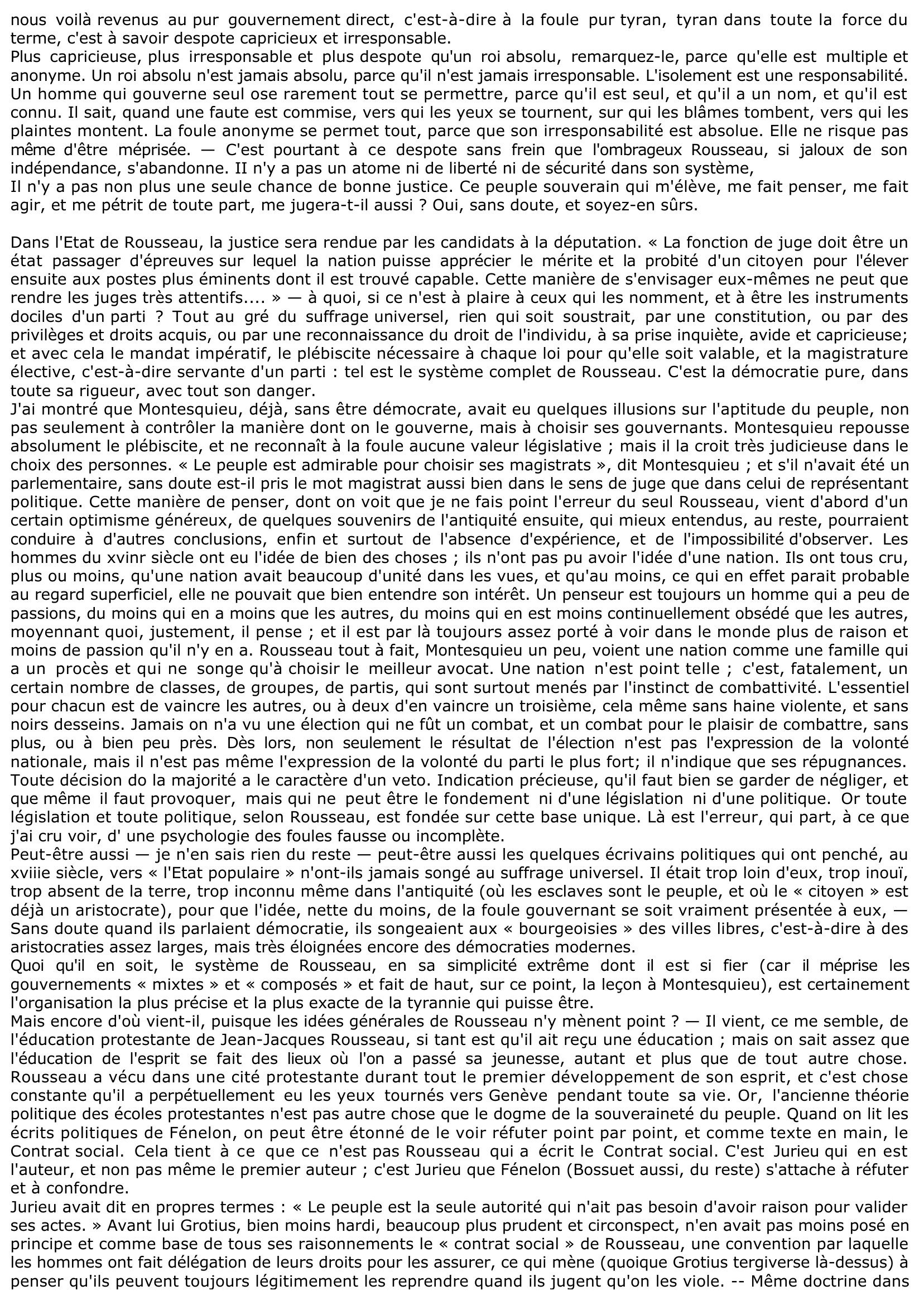ANALYSE DU « CONTRAT SOCIAL » DE ROUSSEAU
Publié le 25/06/2011

Extrait du document


«
nous voilà revenus au pur gouvernement direct, c'est-à-dire à la foule pur tyran, tyran dans toute la force duterme, c'est à savoir despote capricieux et irresponsable.Plus capricieuse, plus irresponsable et plus despote qu'un roi absolu, remarquez-le, parce qu'elle est multiple etanonyme.
Un roi absolu n'est jamais absolu, parce qu'il n'est jamais irresponsable.
L'isolement est une responsabilité.Un homme qui gouverne seul ose rarement tout se permettre, parce qu'il est seul, et qu'il a un nom, et qu'il estconnu.
Il sait, quand une faute est commise, vers qui les yeux se tournent, sur qui les blâmes tombent, vers qui lesplaintes montent.
La foule anonyme se permet tout, parce que son irresponsabilité est absolue.
Elle ne risque pasmême d'être méprisée.
— C'est pourtant à ce despote sans frein que l'ombrageux Rousseau, si jaloux de sonindépendance, s'abandonne.
II n'y a pas un atome ni de liberté ni de sécurité dans son système,Il n'y a pas non plus une seule chance de bonne justice.
Ce peuple souverain qui m'élève, me fait penser, me faitagir, et me pétrit de toute part, me jugera-t-il aussi ? Oui, sans doute, et soyez-en sûrs.
Dans l'Etat de Rousseau, la justice sera rendue par les candidats à la députation.
« La fonction de juge doit être unétat passager d'épreuves sur lequel la nation puisse apprécier le mérite et la probité d'un citoyen pour l'éleverensuite aux postes plus éminents dont il est trouvé capable.
Cette manière de s'envisager eux-mêmes ne peut querendre les juges très attentifs....
» — à quoi, si ce n'est à plaire à ceux qui les nomment, et à être les instrumentsdociles d'un parti ? Tout au gré du suffrage universel, rien qui soit soustrait, par une constitution, ou par desprivilèges et droits acquis, ou par une reconnaissance du droit de l'individu, à sa prise inquiète, avide et capricieuse;et avec cela le mandat impératif, le plébiscite nécessaire à chaque loi pour qu'elle soit valable, et la magistratureélective, c'est-à-dire servante d'un parti : tel est le système complet de Rousseau.
C'est la démocratie pure, danstoute sa rigueur, avec tout son danger.J'ai montré que Montesquieu, déjà, sans être démocrate, avait eu quelques illusions sur l'aptitude du peuple, nonpas seulement à contrôler la manière dont on le gouverne, mais à choisir ses gouvernants.
Montesquieu repousseabsolument le plébiscite, et ne reconnaît à la foule aucune valeur législative ; mais il la croit très judicieuse dans lechoix des personnes.
« Le peuple est admirable pour choisir ses magistrats », dit Montesquieu ; et s'il n'avait été unparlementaire, sans doute est-il pris le mot magistrat aussi bien dans le sens de juge que dans celui de représentantpolitique.
Cette manière de penser, dont on voit que je ne fais point l'erreur du seul Rousseau, vient d'abord d'uncertain optimisme généreux, de quelques souvenirs de l'antiquité ensuite, qui mieux entendus, au reste, pourraientconduire à d'autres conclusions, enfin et surtout de l'absence d'expérience, et de l'impossibilité d'observer.
Leshommes du xvinr siècle ont eu l'idée de bien des choses ; ils n'ont pas pu avoir l'idée d'une nation.
Ils ont tous cru,plus ou moins, qu'une nation avait beaucoup d'unité dans les vues, et qu'au moins, ce qui en effet parait probableau regard superficiel, elle ne pouvait que bien entendre son intérêt.
Un penseur est toujours un homme qui a peu depassions, du moins qui en a moins que les autres, du moins qui en est moins continuellement obsédé que les autres,moyennant quoi, justement, il pense ; et il est par là toujours assez porté à voir dans le monde plus de raison etmoins de passion qu'il n'y en a.
Rousseau tout à fait, Montesquieu un peu, voient une nation comme une famille quia un procès et qui ne songe qu'à choisir le meilleur avocat.
Une nation n'est point telle ; c'est, fatalement, uncertain nombre de classes, de groupes, de partis, qui sont surtout menés par l'instinct de combattivité.
L'essentielpour chacun est de vaincre les autres, ou à deux d'en vaincre un troisième, cela même sans haine violente, et sansnoirs desseins.
Jamais on n'a vu une élection qui ne fût un combat, et un combat pour le plaisir de combattre, sansplus, ou à bien peu près.
Dès lors, non seulement le résultat de l'élection n'est pas l'expression de la volonténationale, mais il n'est pas même l'expression de la volonté du parti le plus fort; il n'indique que ses répugnances.Toute décision do la majorité a le caractère d'un veto.
Indication précieuse, qu'il faut bien se garder de négliger, etque même il faut provoquer, mais qui ne peut être le fondement ni d'une législation ni d'une politique.
Or toutelégislation et toute politique, selon Rousseau, est fondée sur cette base unique.
Là est l'erreur, qui part, à ce quej'ai cru voir, d' une psychologie des foules fausse ou incomplète.Peut-être aussi — je n'en sais rien du reste — peut-être aussi les quelques écrivains politiques qui ont penché, auxviiie siècle, vers « l'Etat populaire » n'ont-ils jamais songé au suffrage universel.
Il était trop loin d'eux, trop inouï,trop absent de la terre, trop inconnu même dans l'antiquité (où les esclaves sont le peuple, et où le « citoyen » estdéjà un aristocrate), pour que l'idée, nette du moins, de la foule gouvernant se soit vraiment présentée à eux, —Sans doute quand ils parlaient démocratie, ils songeaient aux « bourgeoisies » des villes libres, c'est-à-dire à desaristocraties assez larges, mais très éloignées encore des démocraties modernes.Quoi qu'il en soit, le système de Rousseau, en sa simplicité extrême dont il est si fier (car il méprise lesgouvernements « mixtes » et « composés » et fait de haut, sur ce point, la leçon à Montesquieu), est certainementl'organisation la plus précise et la plus exacte de la tyrannie qui puisse être.Mais encore d'où vient-il, puisque les idées générales de Rousseau n'y mènent point ? — Il vient, ce me semble, del'éducation protestante de Jean-Jacques Rousseau, si tant est qu'il ait reçu une éducation ; mais on sait assez quel'éducation de l'esprit se fait des lieux où l'on a passé sa jeunesse, autant et plus que de tout autre chose.Rousseau a vécu dans une cité protestante durant tout le premier développement de son esprit, et c'est choseconstante qu'il a perpétuellement eu les yeux tournés vers Genève pendant toute sa vie.
Or, l'ancienne théoriepolitique des écoles protestantes n'est pas autre chose que le dogme de la souveraineté du peuple.
Quand on lit lesécrits politiques de Fénelon, on peut être étonné de le voir réfuter point par point, et comme texte en main, leContrat social.
Cela tient à ce que ce n'est pas Rousseau qui a écrit le Contrat social.
C'est Jurieu qui en estl'auteur, et non pas même le premier auteur ; c'est Jurieu que Fénelon (Bossuet aussi, du reste) s'attache à réfuteret à confondre.Jurieu avait dit en propres termes : « Le peuple est la seule autorité qui n'ait pas besoin d'avoir raison pour validerses actes.
» Avant lui Grotius, bien moins hardi, beaucoup plus prudent et circonspect, n'en avait pas moins posé enprincipe et comme base de tous ses raisonnements le « contrat social » de Rousseau, une convention par laquelleles hommes ont fait délégation de leurs droits pour les assurer, ce qui mène (quoique Grotius tergiverse là-dessus) àpenser qu'ils peuvent toujours légitimement les reprendre quand ils jugent qu'on les viole.
-- Même doctrine dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DU CONTRAT SOCIAL ou Principes du droit politique. Traité de Jean-Jacques Rousseau (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Analyse livre 1 Du contrat social rousseau
- Contrat social de Rousseau analyse
- LE CONTRAT SOCIAL ou PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE DE ROUSSEAU (ANALYSE DU LIVRE PREMIER).
- Analyse du Contrat Social de Jean-Jacques ROUSSEAU